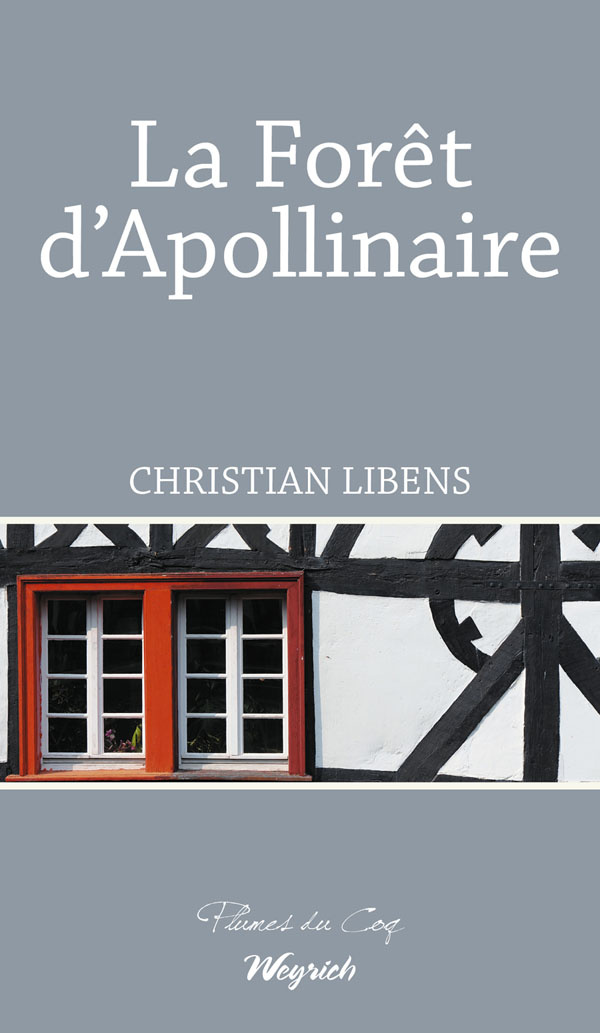
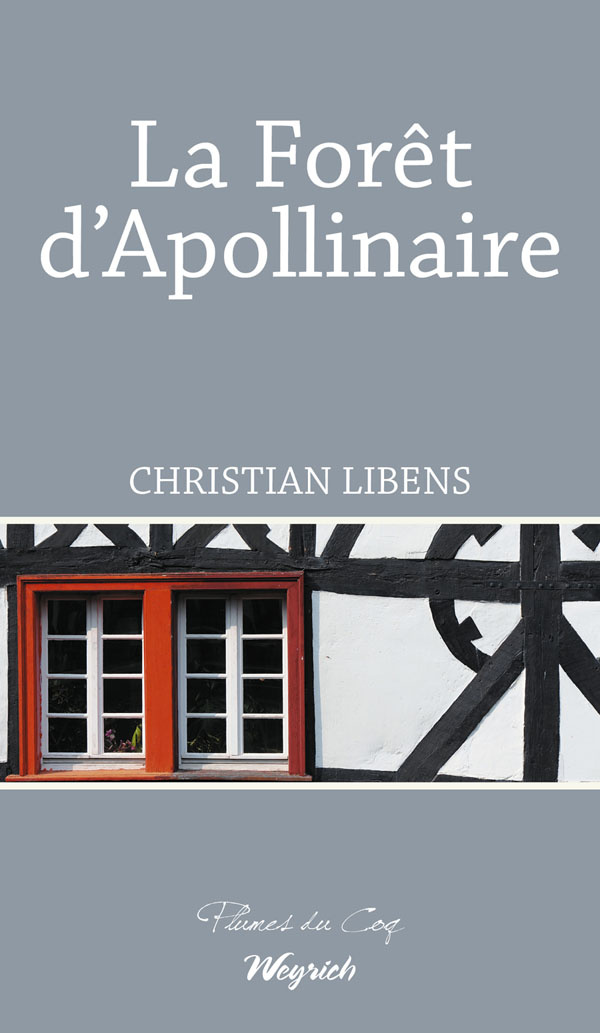
Quand, par un beau jour de juillet 1899, l’auteur du Pont Mirabeau arrive à Stavelot, en Ardenne liégeoise, il s’appelle encore Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky.
Il a dix-neuf ans et est accompagné par son frère Albert, de deux ans son cadet. Les jeunes « barons russes » s’installent chez les époux Constant, « charcutiers-restaurateurs », qui tiennent une modeste pension de famille, rue Neuve, c’est-à-dire au vieux cœur de la ci-devant capitale principautaire. Ils vont y séjourner trois mois. Une saison d’été qui sera comme une illumination pour le jeune poète.
Stavelot va immédiatement séduire Apollinaire. Ne se révèle-t-elle pas pour lui la cité de tant d’expériences, de tant de libertés nouvelles ? Wilhelm, le jeune Méditerranéen au regard saturé par les bleus et les ocres de la Côte d’Azur goûtera les richesses subtiles des verts et des gris ardennais en de longues courses à travers forêts et fagnes. Wilhelm, le vieil enfant romain, l’ancien adolescent monégasque, s’enchantera de découvrir, dans la langue wallonne, une mélodie cousine des parlers italiques. Wilhelm, le fils de la fantasque Angelika, tout à la fois mère oublieuse et possessive, Wilhelm, l’élève brillant et dissipé, si longtemps pensionnaire de bons pères et d’éducateurs emmurés, Wilhelm pourra enfin, sans autorisation ni avis de quiconque, regarder, toucher, parler, marcher, vivre. Et aimer. Aimer Marie…
On le sait, l’auteur de La chanson du Mal Aimé a été un amoureux sincère et un amant passionné. Pourtant, si chaque chapitre de sa biographie pourrait être désigné par un prénom féminin (dont les mieux connus sont Annie, Marie, Lou, Madeleine, Jacqueline), il n’a jamais porté le masque d’un don Juan cynique et triomphant. Bien au contraire, se sentant mal aimé et sans doute mal aimant, Apollinaire, peut-être plus que tout autre poète, a célébré la femme souveraine et chanté le malheur d’aimer.
Le premier de ces prénoms-titres serait incontestablement Marèye. (Marèye est bien sûr la forme wallonne de Marie.) Marie Dubois avait l’âge de Wilhelm. Avec ses parents et ses deux sœurs, elle habitait le petit café-friture tenu par sa mère près de l’église décanale, tandis que son père était ouvrier aux tanneries. Marie (ou, plus familièrement, Maria), qui passait pour être la plus jolie jeune fille de la ville, participait aux répétitions du cercle théâtral « La Fougère ». Cet été 1899, les réunions se tenaient à la Pension Constant, là où Wilhelm, un sympathique « baron russe »…
Marèye était très douce étourdie et charmante
Moi je l’aimais d’Amour m’aimait-elle, qui sait ?
Ainsi, Wilhelm « aimait d’Amour » Marèye ; c’est Apollinaire qui l’écrit ! Et s’il célèbre nommément sa muse stavelotaine dans ces vers qui ouvrent le poème intitulé Marèye (resté toutefois inédit du vivant de son auteur), il la chante encore dans Mareï (paru dans le recueil Le Guetteur mélancolique). Quant au poème Marie (repris dans Alcools), s’il parle bien sûr de Marie Laurencin, il évoque aussi le tendre souvenir d’une autre Marie, celle qui fut sans doute la première femme que Wilhelm a prise dans ses bras.
Marie Dubois est morte le 9 février 1919, trois mois jour pour jour après son amoureux, mystérieusement enfui depuis l’aube du 5 octobre 1899. Jamais Marèye ne se mariera, jamais elle ne saura qu’elle avait connu Guillaume Apollinaire…
Maria repose toujours au cimetière de Stavelot, non loin des grands étangs, là où un jeune baron russe l’emmenait en promenade.
Après tant d’années, on voudra bien pardonner à mon récit certaines imprécisions. Pourtant, je revois encore très distinctement mon frère assis au côté de notre mère dans la loge d’honneur, presque au bord de la piste. Elle est vêtue de son lourd manteau rouge. Guillaume, lui, s’est enveloppé dans une longue pèlerine de laine anglaise. Autour d’eux, chacune des six femmes est entièrement nue, les cheveux répandus sur les épaules.
Cet hiver-là, le froid immobilisa la Principauté abbatiale durant quarante jours et quarante nuits. Il nous fallut donc souffrir mille périls pour traverser les forêts et rejoindre la petite cité ardennaise. Le chapiteau rouge et or avait été dressé sur la place Saint-Remacle, et les belles roulottes sculptées entouraient la fontaine du Perron.
L’accueil de toute la troupe fut si chaleureux qu’il nous fit oublier un instant les rigueurs du temps. Livio, le directeur, s’empressait autour de notre mère, lui donnant du « Contessa Kostrowitzka » à chaque phrase, tandis que les jeunes écuyères n’avaient d’yeux que pour mon frère. C’étaient des soupirs de vierges et des rires d’amantes qui appelaient le poète :
— Wilhelm, moi aussi je me prénomme Marie…
— Monsieur de Kostrowitzky, aimez-vous mon visage ?
— Guillaume Apollinaire, voulez-vous m’épouser ?
Mais le signor Livio eut tôt fait de renvoyer les belles à leurs coulisses. Même dans une minuscule capitale pétrifiée, le spectacle ne devait prendre aucun retard.
Si j’ai gardé mémoire de l’ordonnancement des numéros, c’est qu’à chacun d’eux participait une amante de Guillaume, et que je me souviens toujours parfaitement de la chronologie de ses amours.
Ainsi donc Marèye ouvrit le spectacle. La toile du chapiteau calmait la bise polaire mais l’air restait glacial. Elle parut, vêtue d’un long manteau de laine gris bleu et coiffée d’une toque blanche à brandebourg. C’était une tenue plutôt incommode pour une dresseuse d’ours. Mais quand la bête l’eut rejointe sur la piste, elle se dévêtit, ne gardant sur elle que sa robe voilée d’organza. La respiration de l’ours créait un sfumato autour de sa grosse tête. Bonhomme, il avançait vers Marèye les bras ouverts, comme s’il voulait l’inviter à une danse villageoise. Guillaume me souffla :
— L’ours est amoureux de sa dompteuse, mais c’est un secret !
Quand Marèye vint s’asseoir à côté de mon frère, le numéro suivant avait déjà commencé. C’est pourquoi je ne m’étonnai pas tout de suite de sa totale nudité en pareil endroit et dans pareille température.
Annie exécuta un difficile exercice de voltige montée. Les naseaux du cheval au galop laissaient s’échapper une véritable fumée blanche, estompant la longue robe de tulle de sa cavalière. Guillaume s’exclama :
— Elle monte comme une vraie Texane !
Là encore, je ne m’étonnai guère, ni des habits incongrus de la jeune Anglaise durant son exploit ni de sa nudité quand elle nous rejoignit à son tour.
Marie arriva vêtue d’un bustier de soie dégageant ses blanches épaules. On aurait pu croire que c’était pour faciliter ses mouvements dans son numéro de lanceuse de couteaux. Il n’en fut rien : elle endossa un long manteau brun évasé avant de fendre l’air gelé de ses projectiles. Guillaume me glissa :
— Elle est aussi habile avec les couteaux qu’avec ses pinceaux !
Fidèle à elle-même, notre mère l’ignora lorsqu’elle s’assit pareillement nue à côté des deux autres jeunes femmes.
Monsieur Loyal vint alors annoncer que le numéro suivant serait modifié : la girafe souffrait d’un solide refroidissement, ce qui ne risquait pas d’affecter les quatre tigres de Sibérie qui accompagnaient Lou.
Le visage souligné par son col de fourrure, Lou avait le regard plus cruel que celui de ses fauves. Il me sembla que mon frère crispait les mâchoires. Mais c’est en souriant qu’il accueillit parmi nous une Lou dévêtue.
Bien qu’elle se livrât à un téméraire exercice de trapèze, Madeleine ne quitta pas un instant toque et manteau pour voler dans l’air glacial du chapiteau. Pourtant, elle aussi était entièrement nue quand elle s’installa à nos côtés.
Guillaume paraissait de plus en plus absent. Il est vrai que, malgré la qualité du programme et le charme de ses exécutantes, nous étions tous trois au bord de l’engourdissement. Pour ma part, je tentais de réfréner mes frissons en songeant à la chaleur du Mexique où j’avais longtemps résidé avant que d’y passer jadis de vie à trépas. Mais rien n’y faisait désormais. Le froid nous figeait peu à peu.
Enfin, le dernier numéro arriva. Il était l’œuvre de Jacqueline. Nu-tête, la Jolie Rousse s’était affublée d’un nez de clown. Elle commença par mimer une sorte de rimailleur jouant du luth, prenant la pose, faisant des mines, avant de feindre des grelottements spasmodiques. Son rire troua soudain l’air gelé et, quittant un à un ses habits, elle rejoignit nos compagnes.
Le Mal Aimé se leva alors pour applaudir un bref instant. Puis, sans un mot pour notre mère ni pour moi, sans un regard pour ces six corps éblouissants de tendre blancheur, il sortit dans la nuit métallique.
Cet homme sans véritable patrie disait : Je suis Romain.
(Lettre de Marie Laurencin à René-Guy Cadou)
Parfois il écrivait
Ma chère Maman
Parfois c’était
Cara Mamma
Toujours il racontait
Ses promenades avec Albert
Les sapins noirs les fagnes rousses
Toujours il racontait
Les pavées du Vinâve le soir
Les Stavelotains qui parlent lent
De Laetare de Blanc-Moussîs
Toujours il racontait
Ce Nord si différent
Ce monde nouveau
Revêtu pour un été
Comme déguisement de carnaval
Toujours il taisait
Ses promenades avec Maria
La bouche airelle de Marie
Les seins canneberge de Mareï
Les jambes drosera de Marèye
Toujours il taisait
Ses vies rêvées
Ses morts jouées
Ses ivresses de pèket et de bière
Ses vertiges de mots et de vers
Parfois il écrivait
Des mots français appris au collège
Pour dire aujourd’hui et demain
Parfois c’était
L’italien tendre d’hier
Pour tout garder encore un peu
Ma chère Maman
Cara Mamma
Cara Mamma
Et il signait
Tuo figlio
Wilhelm de Kostrowitzky
Mots ou expressions en wallon et en français régional
– avée (français régional) = trottoir.
– goutte (fr. rég.) = petit verre de genièvre.
– nosse novê maîsse di scole (wallon) = notre nouveau maître d’école.
– pèket (w.) = genièvre.
– cramique = pâtisserie (pain sucré aux raisins de Corinthe).
– sôlêye (w.) = ivrogne.
– qué novèle, m’fi ? (w.) = quelle nouvelle, mon garçon ?
– vos èstiz dèdja bê valèt (w.) = vous étiez déjà beau garçon.
– binamé valèt (w.) = gentil garçon.
– campinêr (w.) = toupie.
– bal’teû (w.) = plaisantin, farceur.
– barada (w.) = coiffe féminine à bavolet.
– grandiveux (fr. rég.) = hautain, prétentieux.
– gozète (w.) = pâtisserie, sorte de chausson aux fruits.
– bèle dame (w.) = « belle dame », autre appellation de la belladone.
– fricassèye (w.) = « fricassée », préparation culinaire à base d’œufs et de lard.
– plat-cou (w.) = petit verre à cul plat.
– rampe du hâye (w.) = chèvrefeuille.
– poû ! à Lîdje, nosse novê maîsse di scole èst div’nou on mwinde... i n’ pout pus beûre ! (w.) = peuh ! à Liège, notre nouveau maître d’école est devenu un « moindre » (une mauviette)... il ne peut plus boire !
– Vèkée (toponyme en wallon) = ancien chemin marquant au sud-est la frontière de la principauté de Liège.
– thier (fr. rég.) = côte raide, chemin escarpé.
– fé l’conteû al sîse (w.) = jouer au conteur à la veillée.
– clignette (fr. rég.) = clin d’oeil.
– mi, dji so d’comèrce (w.) = moi, je suis « de commerce ».
– cisse-chal, c’è-st-ine mâle ! (w.) = celle-là, c’est une mauvaise !
– troufleûr (fr. rég.) = ramasseur de tourbe.
– galant (fr. rég.) = amoureux, fiancé.
– bê valèt (w.) = beau garçon.
– que vlo-ve ? ( w. ) = que voulez-vous ?
Stavelot, juillet 1899
Enfin, me voilà maître d’école !
Je n’ai jamais mis autant de temps pour revenir de Liège. Premier exercice d’herborisme de l’instituteur, ou dernière fugue de l’étudiant ? Descendre à la petite gare de Roanne pour remonter vers Stavelot à travers les bois de Lancre m’aura permis de retrouver mes arbres pendant deux heures de marche.
Les arbres de mon enfance.
Il y a quelques minutes, du haut de Renardmont, j’ai aperçu les toits bleus de Stavelot, dans le dernier soleil de l’après-midi. J’ai ralenti le pas. De tendres images m’ont accompagné jusqu’à la grand-route.
Nombreuses sont les ménagères qui s’installent en vigies sur les trottoirs de la rue Neuve. Elles font mine d’arranger un pot de fleurs ou de rendre un petit coup de balai à leur « pavée ». Les vieux, eux, n’ont plus besoin de ces ruses pour goûter, assis sur le banc familial, le spectacle de la rue et le plaisir des lentes conversations.
Lorsque, petit garçon, je devais aller chez mon parrain, la rue Neuve était le passage redoutable. Tous ces regards, plus ou moins familiers, torturaient l’enfant farouche. Aujourd’hui, je salue ces gens, je les regarde droit dans les yeux. Je suis instituteur !
L’aîné des frères Solheid descend le perron de la Pension Constant.
— Pierre ! te voilà revenu, là, maintenant ?… Monte bien vite, on va fêter ton retour ! Jacques est ici aussi. Allez, viens ! on va te payer la goutte.
D’un bras raide, je balance mon sac pour montrer la direction de la maison.
— Tu es gentil, Hubert, mais je suis déjà en retard et mes parents…
— J’ai rencontré ton père hier, à la tannerie. On peut dire qu’il est fier de son fils, le papa !… Allez quoi, tu ne vas pas nous refuser la goutte, quand même !
Bien sûr, je ne peux pas refuser de trinquer avec d’anciens condisciples, le jour même de mon retour ; bien sûr, on ne comprendrait pas que je n’offre pas la tournée en pareille circonstance. Je l’avais d’ailleurs prévue, cette tournée chez Constant, mais seulement lundi prochain, après la première répétition de La Fougère.
Hubert m’a pris par l’épaule. Je me laisse entraîner dans la salle du café, le pas encore timide et le front déjà orgueilleux.
— Nosse novê maîsse di scole, annonce Hubert en martelant chaque syllabe.
Les exclamations en wallon sont les plus nombreuses, les plus chaleureuses aussi. Chacun me complimente. Puis les questions, les encouragements, les souvenirs… Certains réclament leur tournée et la mère Constant ne lâche plus sa bouteille de goutte.
Le pèket me tourne la tête. Au fond de mon verre d’alcool blanc, l’orgueilleux est en train de noyer le timide.
Puis, chaque habitué se réinstalle dans ses habitudes. Le bourdonnement des voix est revenu à la mesure de la petite salle et je retrouve pour moi seul Hubert et Jacques. Sans nous concerter, nous nous sommes assis sur la banquette du fond, notre préférée, celle qui permet de tout observer.
Les mots s’ajoutent aux mots, et l’alcool à l’alcool. Le bel avenir est retourné dans mon sac jusqu’à demain, jusqu’à la fin de l’été. Le pèket prend goût de souvenirs.
Si ce n’est notre regard, y a-t-il seulement quelque chose de changé dans le café-boutique du charcutier-restaurateur ? Dans son plat de faïence fleurie, le serpent de boudin noir a le même enroulement, et le jambon d’Ardenne entamé garde son cataplasme de papier d’argent. Alors, depuis quand les bocaux de sucreries alignés à la devanture ontils perdu leur séduction ? Et ces souris de gomme verte ? et ces lacets de jus noir ? et ces cuberdons rouges que le vicaire nous défendait d’appeler « chapeau de curé » ? Depuis quand ne suis-je plus remonté à la maison en suçant une « chique sur un bois » ?
— Ho ! Pierre… Tu ne vas quand même pas t’endormir ? marmonne Hubert en me secouant le coude.
— T’as perdu l’habitude de notre pèket ? ajoute Jacques, rigolard.
— Dormir ? sûrement pas ! Je rêvais un peu…
— Par hasard, ce n’est pas à Marèye que tu rêves ?
Je prends le ton le plus neutre pour demander :
— Marèye ?
— Mais écoute-moi ça, Jacques… Eh ben, quel faux cul il est devenu, notre Pierre !
Je m’apprête à contre-attaquer, quand je remarque deux garçons de notre âge. Ils traversent la salle avec un sourire pour la mère Constant, puis disparaissent dans la salle à manger.