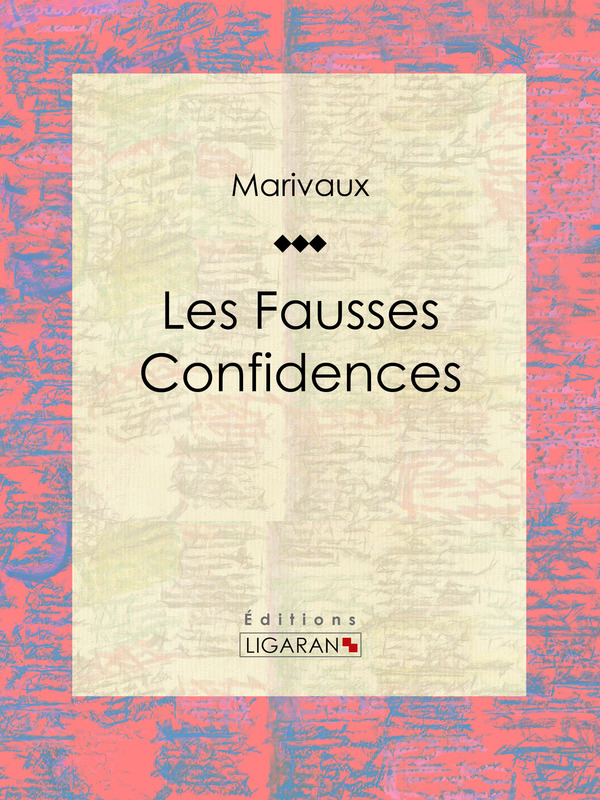
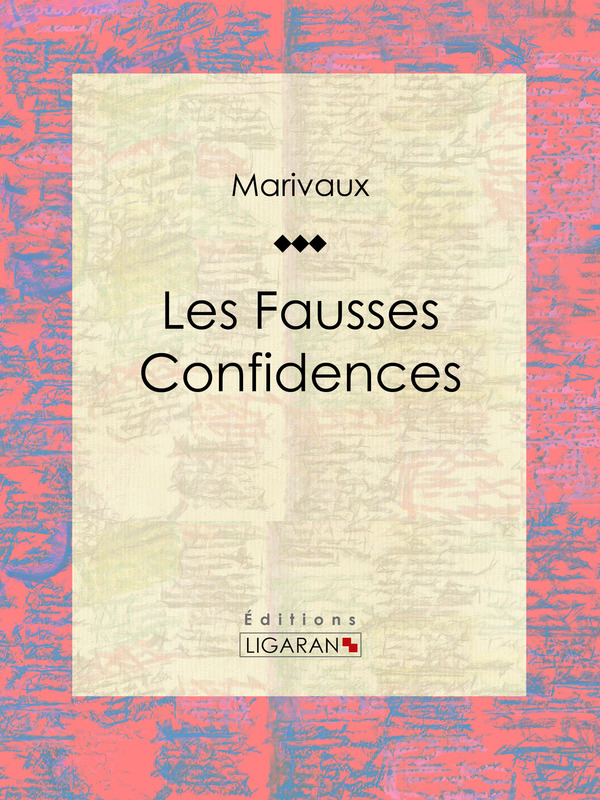

EAN : 9782335007701
©Ligaran 2014

ARAMINTE, fille de Madame Argante.
DORANTE, neveu de Monsieur Remy.
MONSIEUR REMY, procureur.
MADAME ARGANTE.
ARLEQUIN, valet d’Araminte.
DUBOIS, ancien valet de Dorante.
MARTON, suivante d’Araminte.
LE COMTE.
Un domestique parlant.
Un garçon joaillier.
La scène est chez Madame Argante.
Dorante, Arlequin.
Ayez la bonté, Monsieur, de vous asseoir un moment dans cette salle, Mademoiselle Marton est chez Madame et ne tardera pas à descendre.
Je vous suis obligé.
Si vous voulez, je vous tiendrai compagnie, de peur que l’ennui ne vous prenne ; nous discourrons en attendant.
Je vous remercie ce n’est pas la peine, ne vous détournez point.
Voyez, Monsieur, n’en faites pas de façon : nous avons ordre de Madame d’être honnête, et vous êtes témoin que je le suis.
Non, vous dis-je, je serai bien aise d’être un moment seul.
Excusez, Monsieur, et restez à votre fantaisie.
Dorante, Dubois.
Dubois, entrant avec un air de mystère.
Ah ! te voilà ?
Oui, je vous guettais.
J’ai cru que je ne pourrais me débarrasser d’un domestique qui m’a introduit ici, et qui voulait absolument me désennuyer en restant. Dis-moi, Monsieur Remy n’est donc pas encore venu ?
Non, mais voici l’heure à peu près qu’il vous a dit qu’il arriverait. (Il cherche et regarde.) N’y a-t-il là personne qui nous voie ensemble ? Il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que je vous connaisse.
Je ne vois personne.
Vous n’avez rien dit de notre projet à Monsieur Remy, votre parent ?
Pas le moindre mot. Il me présente de la meilleure foi du monde, en qualité d’intendant, à cette dame-ci dont je lui ai parlé, et dont il se trouve le procureur ; il ne sait point du tout que c’est toi qui m’as adressé à lui, il la prévint hier ; il m’a dit que je me rendisse ce matin ici, qu’il me présenterait à elle, qu’il y serait avant moi, ou que s’il n’y était pas encore, je demandasse une Mademoiselle Marton. Voilà tout, et je n’aurais garde de lui confier notre projet, non plus qu’à personne, il me paraît extravagant, à moi qui m’y prête. Je n’en suis pourtant pas moins sensible à ta bonne volonté, Dubois, tu m’as servi, je n’ai pu te garder, je n’ai pu même te bien récompenser de ton zèle ; malgré cela, il t’est venu dans l’esprit de faire ma fortune : en vérité, il n’est point de reconnaissance que je ne te doive !
Laissons cela, Monsieur ; tenez, en un mot, je suis content de vous, vous m’avez toujours plu ; vous êtes un excellent homme, un homme que j’aime ; et si j’avais bien de l’argent, il serait encore à votre service.
Quand pourrai-je reconnaître tes sentiments pour moi ? Ma fortune serait la tienne ; mais je n’attends rien de notre entreprise, que la honte d’être renvoyé demain.
Eh bien, vous vous en retournerez.
Cette femme-ci a un rang dans le monde ; elle est liée avec tout ce qu’il y a de mieux, veuve d’un mari qui avait une grande charge dans les finances ; et tu crois qu’elle fera quelque attention à moi, que je l’épouserai, moi qui ne suis rien, moi qui n’ai point de bien ?
Point de bien ! Votre bonne mine est un Pérou ! Tournez-vous un peu, que je vous considère encore ; allons, Monsieur, vous vous moquez, il n’y a point de plus grand seigneur que vous à Paris : voilà une taille qui vaut toutes les dignités possibles, et notre affaire est infaillible, absolument infaillible ; il me semble que je vous vois déjà en déshabillé dans l’appartement de Madame.
Quelle chimère !
Oui, je le soutiens. Vous êtes actuellement dans votre salle et vos équipages sont sous la remise.
Elle a plus de cinquante mille livres de rente, Dubois.
Ah ! vous en avez bien soixante pour le moins.
Et tu me dis qu’elle est extrêmement raisonnable ?
Tant mieux pour vous, et tant pis pour elle. Si vous lui plaisez, elle en sera si honteuse, elle se débattra tant, elle deviendra si faible, qu’elle ne pourra se soutenir qu’en épousant ; vous m’en direz des nouvelles. Vous l’avez vue et vous l’aimez ?
Je l’aime avec passion, et c’est ce qui fait que je tremble !
Oh ! vous m’impatientez avec vos terreurs : eh que diantre ! un peu de confiance ; vous réussirez, vous dis-je. Je m’en charge, je le veux, je l’ai mis là ; nous sommes convenus de toutes nos actions, toutes nos mesures sont prises ; je connais l’humeur de ma maîtresse, je sais votre mérite, je sais mes talents, je vous conduis, et on vous aimera, toute raisonnable qu’on est ; on vous épousera, toute fière qu’on est, et on vous enrichira, tout ruiné que vous êtes, entendez-vous ? Fierté, raison et richesse, il faudra que tout se rende. Quand l’amour parle, il est le maître, et il parlera : adieu ; je vous quitte ; j’entends quelqu’un, c’est peut-être Monsieur Remy ; nous voilà embarqués, poursuivons. (Il fait quelques pas, et revient.) À propos, tâchez que Marton prenne un peu de goût pour vous. L’Amour et moi nous ferons le reste.
Monsieur Remy, Dorante.
Bonjour, mon neveu ; je suis bien aise de vous voir exact. Mademoiselle Marton va venir, on est allé l’avertir. La connaissez-vous ?
Non, Monsieur ; pourquoi me le demandez-vous ?
C’est qu’en venant ici, j’ai rêvé à une chose… Elle est jolie, au moins.
Je le crois.
Et de fort bonne famille, c’est moi qui ai succédé à son père ; il était fort ami du vôtre ; homme un peu dérangé ; sa fille est restée sans bien ; la dame d’ici a voulu l’avoir, elle l’aime, la traite bien moins en suivante qu’en amie ; lui a fait beaucoup de bien, lui en fera encore, et a offert même de la marier. Marton a d’ailleurs une vieille parente asthmatique dont elle hérite, et qui est à son aise ; vous allez être tous deux dans la même maison ; je suis d’avis que vous l’épousiez : qu’en dites-vous ?
Eh !… mais je ne pensais pas à elle.
Eh bien, je vous avertis d’y penser ; tâchez de lui plaire. Vous n’avez rien, mon neveu, je dis rien qu’un peu d’espérance ; vous êtes mon héritier, mais je me porte bien, et je ferai durer cela le plus longtemps que je pourrai, sans compter que je puis me marier ; je n’en ai point d’envie, mais cette envie-là vient tout d’un coup, il y a tant de minois qui vous la donnent ; avec une femme on a des enfants, c’est la coutume, auquel cas, serviteur au collatéral ; ainsi, mon neveu, prenez toujours vos petites précautions, et vous mettez en état de vous passer de mon bien, que je vous destine aujourd’hui, et que je vous ôterai demain peut-être.
Vous avez raison, Monsieur, et c’est aussi à quoi je vais travailler.
Je vous y exhorte. Voici Mademoiselle Marton, éloignez-vous de deux pas, pour me donner le temps de lui demander comment elle vous trouve.
(Dorante s’écarte un peu.)
Monsieur Remy, Marton, Dorante.
Je suis fâchée, Monsieur, de vous avoir fait attendre ; mais j’avais affaire chez Madame.
Il n’y a pas grand mal, Mademoiselle, j’arrive. Que pensez-vous de ce grand garçon-là ?
(Montrant Dorante.)
Eh ! Par quelle raison, Monsieur Remy, faut-il que je vous le dise ?
C’est qu’il est mon neveu.
Eh bien ! Ce neveu-là est bon à montrer ; il ne dépare point la famille.
Tout de bon ? C’est de lui dont j’ai parlé à Madame pour intendant, et je suis charmé qu’il vous revienne : il vous a déjà vue plus d’une fois chez moi quand vous y êtes venue ; vous en souvenez-vous ?
Non je n’en ai point d’idée.
On ne prend pas garde à tout. Savez-vous ce qu’il me dit la première fois qu’il vous vit ? Quelle est cette jolie fille-là ? (Marton sourit.) Approchez, mon neveu. Mademoiselle, votre père et le sien s’aimaient beaucoup, pourquoi les enfants ne s’aimeraient-ils pas ? En voilà un qui ne demande pas mieux ; c’est un cœur qui se présente bien.
Il n’y a rien là de difficile à croire.
Voyez comme il vous regarde ; vous ne feriez pas là une si mauvaise emplette.
J’en suis persuadée ; Monsieur prévient en sa faveur, et il faudra voir.
Bon, bon ! Il faudra ! Je ne m’en irai point que cela ne soit vu.
Je craindrais d’aller trop vite.
Vous importunez Mademoiselle, Monsieur.
Je n’ai pourtant pas l’air si indocile.
Ah ! je suis content, vous voilà d’accord. Oh ! çà, mes enfants (Il leur prend les mains à tous deux.). Je vous fiance, en attendant mieux. Je ne saurais rester ; je reviendrai tantôt. Je vous laisse le soin de présenter votre futur à Madame. Adieu, ma nièce.
(Il sort.)
Adieu donc, mon oncle.
Marton, Dorante.
En vérité, tout ceci a l’air d’un songe. Comme Monsieur Remy expédie ! Votre amour me paraît bien prompt, sera-t-il aussi durable ?
Autant l’un que l’autre, Mademoiselle.
Il s’est trop hâté de partir. J’entends Madame qui vient, et comme, grâce aux arrangements de Monsieur Remy, vos intérêts sont presque les miens, ayez la bonté d’aller un moment sur la terrasse, afin que je la prévienne.
Volontiers, Mademoiselle.
J’admire le penchant dont on se prend tout d’un coup l’un pour l’autre.
Araminte, Marton.
Marton, quel est donc cet homme qui vient de me saluer si gracieusement, et qui passe sur la terrasse ? Est-ce à vous à qui il en veut ?
Non, Madame, c’est à vous-même.
Eh bien, qu’on le fasse venir, pourquoi s’en va-t-il ?
C’est qu’il a souhaité que je vous parlasse auparavant. C’est le neveu de Monsieur Remy, celui qu’il vous a proposé pour homme d’affaires.
Ah ! c’est là lui ! Il a vraiment très bonne façon.
Il est généralement estimé, je le sais.
Je n’ai pas de peine à le croire : il a tout l’air de le mériter. Mais, Marton, il a si bonne mine pour un intendant, que je me fais quelque scrupule de le prendre ; n’en dira-t-on rien ?
Et que voulez-vous qu’on dise ? Est-on obligé de n’avoir que des intendants mal faits ?
(Et puis revenant.)
Cela est inutile. Il n’y aura point de dispute là-dessus. Dès que c’est un honnête homme, il aura lieu d’être content. Appelez-le.
Oui, comme il voudra ; qu’il vienne.