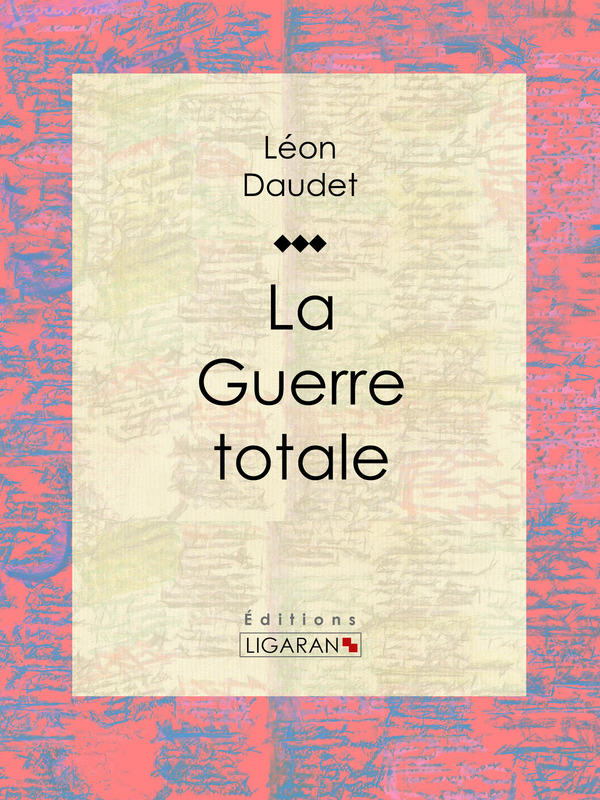
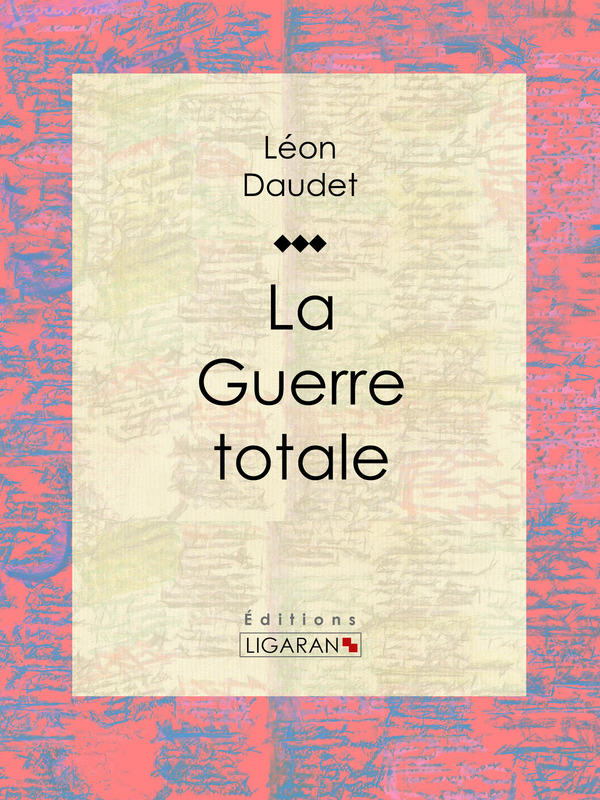

EAN : 9782335016383
©Ligaran 2015
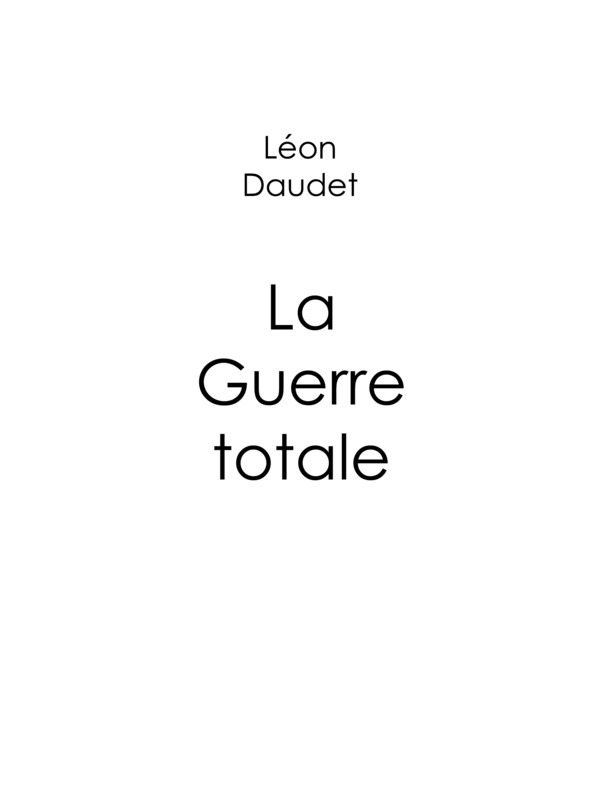
Nous sommes dans la quatrième année de la guerre européenne et l’on peut dire que les nations de l’Entente, gardiennes de la civilisation, commencent seulement à comprendre le caractère de la lutte sans merci engagée contre elles par la barbarie allemande. Sans doute, n’est-il jamais trop tard pour bien faire, mais je pense que nous aurions déjà, depuis plusieurs mois la victoire, si la conception de la guerre totale – telle que nous la font les Allemands, et que nous devrions la leur faire – avait été admise, puis réalisée par nos gouvernements respectifs.
Ce sera le mérite de Clemenceau d’avoir, dans son discours réquisitoire au Sénat du 22 juillet 1917, fait entrer enfin cette conception dans le domaine public. Je rappelle sans orgueil, mais aussi sans fausse modestie, que je lutte pour elle dans l’Action française, depuis le commencement des hostilités. De même que pour l’Avant-Guerre, les évènements m’ont donné raison. Je vais exposer la thèse et ses exemples, non en polémiste, mais en historien, soucieux d’une démonstration convaincante. Le journal convient à la polémique quotidienne. Au livre, la sérénité critique. D’ailleurs, au moment où j’écris, la preuve de ce que j’ai avancé et soutenu est faite presque sur tous les points.
Qu’est-ce que la guerre totale ? C’est l’extension de la lutte, dans ses phases aiguës comme dans ses phases chroniques, aux domaines politique, économique, commercial, industriel, intellectuel, juridique et financier. Ce ne sont pas seulement les armées qui se battent, ce sont aussi les traditions, les institutions, les coutumes, les codes, les esprits et surtout les banques. L’Allemagne a mobilisé dans tous ces plans, sur tous ces points. Elle s’est livrée à un débordement de propagande, toujours acharnée, parfois intelligente, parfois stupide, rarement inutile. Elle a constamment cherché, au-delà du front militaire, la désorganisation matérielle et morale du peuple qu’elle attaquait. Elle a poursuivi, pendant les hostilités, en l’intensifiant, son programme d’exploitation de l’espionnage et de la trahison, qui était celui de l’avant-guerre.
Prenons, par exemple, la Russie. Il appert aujourd’hui que le gouvernement allemand s’était ménagé des intelligences à la Cour, et dans les conseils du gouvernement – Stürmer et Protopopof – comme dans les hautes sphères militaires, comme dans les milieux révolutionnaires. La pénétration allemande antérieure à la guerre avait rendu cette tactique relativement aisée. Il y avait en Russie, dès le début, une germanisation par en haut, cherchant à compléter et à rejoindre une germanisation par en bas. Stürmer tendait les bras à Lénine. La défection russe n’a pas d’autre cause. Elle doit être, pour tous les alliés, un terrible enseignement.
La Russie n’est pas un pays d’ancienne unification comme la France. Elle n’a pas derrière elle des siècles de civilisation monarchique comme la France. Aussi l’ignorance de la nécessité de la guerre totale est-elle plus excusable et plus compréhensible de sa part que de la nôtre. Chez nous, les divers cabinets qui se sont succédé depuis le 3 août 1914, jusqu’à Clemenceau exclusivement, ont donné l’impression qu’ils considéraient la lutte actuelle comme un épisode plus ou moins rapide et tragique, après lequel les choses reprendraient leur cours normal. Un ministre âgé, académicien et qui devrait être expérimenté, a même pu exprimer à la Chambre cette idée fatale et dangereuse qu’il faudrait respecter après la guerre, « le libre développement économique de l’Allemagne ! » On sait où mène ce libre développement : à l’invasion et à l’occupation du territoire français. C’est là une erreur formidable et telle que celui qui l’énonce fait la preuve qu’il ne comprend absolument rien au conflit actuel. Je me suis frotté les yeux en lisant une telle déclaration et je me suis demandé : « Alors, à quoi auront servi tant d’héroïques sacrifices ? »… À laisser faire le barbare germain, à laisser passer ces incendiaires ! Funeste est le jargon du libéralisme, quand un grand peuple joue ses libertés et son avenir.
Quand on pense qu’à l’heure où j’écris, nos tribunaux français ne se sont pas encore mis d’accord sur la question de savoir s’il convient ou non d’accorder la capacité juridique à l’ennemi, de lui ouvrir l’accès de nos prétoires ! Il s’est trouvé des juges pour défendre cette thèse insensée qui, admise, permettrait à un officier allemand de poursuivre chez nous le recouvrement d’une créance contre la veuve d’un militaire français tué à la guerre. « La fôôôrme, messieurs, la fôôôrme », bêlait Bridoison. Tout ce que la presse française compte de journalistes patriotes et raisonnables a protesté contre cette conception trop juridique, à coup sûr inhumaine, et dont les Allemands pourraient largement profiter. De pays à pays en guerre, les avantages légaux équivalent aux avantages militaires. MM. Godefroy et Tronquoy ne s’en étaient pas rendu compte. Mais comment le Garde des Sceaux d’alors ne sut-il pas leur faire entendre que l’état de guerre est quelque chose de différent de l’état de paix ?
Sans la guerre totale, le blocus par lequel les nations alliées prétendaient à bon droit – du moins jusqu’à la défection russe – encercler et affamer l’Allemagne, n’était et ne pouvait être qu’un mot. Par les mailles relâchées de la non-surveillance administrative, policière et douanière, les objets de première et seconde nécessité parvenaient à la Germania en suffisance, sinon en abondance. Les neutres la ravitaillaient à qui mieux mieux, et elle trouvait jusque chez nous des complicités criminelles. Je ne veux alourdir cet exposé d’aucune documentation fatigante. Mais c’est par centaines que me parvenaient les lettres de dénonciation au sujet de telle ou telle personne qui faisait le commerce avec l’ennemi. Comment s’y reconnaître dans ce fatras ? Même en faisant aussi large que possible la part de la médisance et de la forgerie, il est évident que l’Allemagne a tenu à peu près pendant trois ans et demi et que, si le blocus avait été strict, elle n’eût pas dû ni pu tenir plus de deux ans.
Ne m’objectez pas que la conception de la guerre courte est responsable de cette défaillance, que nous eussions agi autrement, si nous avions prévu la guerre longue et chronique. L’Allemagne aussi croyait à la guerre courte, à la campagne « fraîche et joyeuse ». Néanmoins, dès le printemps, elle a mené la guerre comme il faut la mener, sur tous les plans ; ses mesures étaient prises de longue date pour l’offensive d’espionnage et de trahison derrière notre front. Sitôt après sa défaite de la Marne et la stabilisation de la lutte, elle s’efforça de les intensifier. Elle se dit que tout n’était pas perdu, qu’il fallait reprendre la tâche à pied d’œuvre et regagner patiemment une situation qu’avaient compromise, du 5 au 12 septembre 1914, le sort des armes et l’habileté de nos généraux.
Ici je suis forcé de supposer que vous avez lu l’Avant-Guerre ou suivi ‚ depuis le coup d’Agadir, les campagnes de l’Action Française. En deux mots, à l’ouverture des hostilités, notre situation était telle : la majorité des parlementaires de la Chambre – c’est-à-dire de la fraction la plus agissante du Parlement – ne croyait pas à l’imminence, ni même à la possibilité de la guerre. Dans cette majorité même, s’était constitué, autour de M. Joseph Caillaux, ce que j’appelais le clan des Ya : un groupement de personnalités du monde politique, industriel et surtout financier, adonnées à la besogne ingrate et périlleuse du « rapprochement franco-allemand ». C’est à cette besogne que s’applique l’axiome célèbre : Errare humanum est, perseverare diabolicum. La leçon d’Agadir, venant après tant d’autres alertes savamment échelonnées depuis quarante-quatre ans, n’avait pas ouvert les yeux de ces messieurs, ni dissous leur pernicieux entêtement. Pernicieux n’est pas un terme excessif, car l’Allemand augmente ses prétentions à mesure qu’on lui cède davantage et le meilleur et le plus sûr moyen d’exciter son insatiable convoitise est de le laisser s’installer chez soi.
C’est à vous d’en sortir, vous qui parlez en maître.
La maison est à moi, je le ferai connaître.
C’est ainsi que la concession, en pleine paix, du port et de la mine de Diélette au métallurgiste Thyssen, a été, j’en ai la conviction, pour beaucoup dans le changement d’attitude du Kaiser, noté au Livre Jaune par M. Cambon. Après la Normandie, pourquoi pas Paris ?
Là où M. Caillaux et ses amis s’imaginaient amadouer l’ogre, ils l’appâtaient. Le prétendu rapprochement franco-allemand semblait aux Allemands le rapprochement du chat et de la souris. La France étant à portée de leurs mâchoires industrielle et militaire, ils comptaient n’en faire qu’une bouchée.
Quand on tenait un pareil langage, qui est celui du bon sens le plus plat, en 1912 et 1913, on passait, aux yeux des gens rassis, pour un énergumène ou un visionnaire. M. Caillaux, dont la femme n’avait pas encore tué Calmette – tragique pendant de l’affaire Victor Noir – passait, aux yeux des mêmes gens, pour un politicien avisé et qui avait trouvé le filon. Nul ne songeait à s’étonner des étranges fréquentations auxquelles il s’adonnait dès cette époque, et qui allaient de l’Allemand naturalisé Emil Ullmann, directeur du Comptoir National d’Escompte de Paris, au journal le Gil Blas, qu’administraient les « gebrüder Merzbach », banquiers franco-berlinois, au Courrier Européen dirigé par un certain Paix-Séailles, associé de l’Allemand Emmel, avec Vigo dit « Almereyda » comme secrétaire de la rédaction.
Si je cite ici le nom de M. Caillaux, ce n’est point pour accabler un accusé, c’est parce que ce nom est devenu un symbole. Il représente l’aboutissement d’une expérience politique de quelque vingt années – résumée par Maurras dans son admirable et prophétique ouvrage Kiel et Tanger– et qui nous a plutôt coûté cher. Les faits sont là. Jamais nous n’avons eu plus de prévenances pour le commerce allemand, l’industrie allemande, la finance allemande, l’art allemand que de 1909 à 1914. On voit le résultat. Non seulement le caillautisme ne nous a pas épargné les horreurs de la guerre et de l’invasion, – ce qui eût été sa seule raison d’être, sa seule excuse – mais il les a au contraire facilitées et précipitées. C’est ainsi qu’un faux point de vue au pouvoir peut engendrer les pires catastrophes. La méfiance de Madame Edmond Adam et de Paul Déroulède vis-à-vis de l’Allemagne, méfiance maintenue par la Nouvelle Revue et la Ligue des Patriotes, était l’attitude la moins onéreuse et qui en imposait à notre ennemie héréditaire. Que n’avons-nous su la conserver !
Les gens du clan des Ya, et ceux qui faisaient avant la guerre des affaires avec l’Allemagne, ne sont point tous a priori des scélérats. Ils étaient et demeurent des imprudents. Pour quelques-uns, du fait de la guerre, l’entêtement ou la cupidité, ou les deux réunis, ont fait que l’imprudence a tourné au crime. Ajoutons que l’Allemand est aussi naturellement maître-chanteur qu’espion et qu’il ne lâche pas aisément celui qui a signé un contrat avec lui. Compromettre pour conserver, telle est sa devise. Il s’y est conformé largement.
Représentons-nous ce qui s’est passé au moment de la déclaration de la guerre. Les Allemands étaient convaincus que leurs travaux d’approche et de pénétration, joints à leur supériorité militaire, les mèneraient à Paris en un mois. La conviction de leurs créatures était la même. Les uns et les autres comptaient qu’après quelques engagements d’avant-garde, ou même une bataille générale mais courte, en mettant les choses au pire, un traité de paix serait signé qui servirait ensuite de base, sans trop de tiraillements ni de rancune, au fameux rapprochement franco-allemand. L’enthousiasme de la population française, la science de Joffre, de Castelnau et de leurs seconds, l’intervention de la Providence – aide-toi, le Ciel t’aidera – sont venus jeter par terre cette hasardeuse combinaison. Nous sommes ainsi entrés, les uns et les autres, dans la guerre chronique. Nouvelle erreur des Allemands et de leurs créatures : le peuple français, trop impatient, ne saura pas tenir. Or, au contraire, ce peuple français tant calomnié, tant méconnu par lui-même – voir Quand les Français ne s’aimaient pas de Maurras – a magnifiquement tenu. C’est alors que s’est posée pour les Allemands la grosse question d’une campagne menée chez nous, par leurs créatures d’avant-guerre, pour la corruption et la destruction de notre bon moral ; des sommes considérables, plusieurs vingtaines de millions, ont été consacrées par gros paquets à cette œuvre souterraine, qui a atteint son maximum d’intensité d’avril à juin 1917. Mais, en somme, le coup a échoué et le bonheur de cet échec n’est pas moindre que celui de la victoire de la Marne. Il a échoué d’abord, parce que la clairvoyance est épidémique et contagieuse, comme l’aveuglement, ensuite parce que l’Action Française était là. Les Allemands ont joliment raison de nous haïr spécialement et de nous insulter nommément, mes amis et moi, dans leurs feuilles. Nous avons copieusement mérité leur fureur. Nous nous efforcerons de continuer à la mériter. Ces imbéciles ne comprennent pas qu’ils accroissent ainsi notre autorité auprès de nos compatriotes.
Je m’en vais, dans les pages qui suivent, vous montrer l’Allemagne à l’œuvre, chez nous, pendant la guerre, en arrière du front et notamment à Paris. « Mélodrame, cinéma, inventions romanesques », vont crier à la fois ceux qui ont des yeux pour ne pas voir et les gens plus ou moins compromis dans cette tragique aventure. Ces sottises maintenant ne portent plus. Des scandales récents et des inculpations retentissantes ont prouvé que les manœuvres de corruption allemande ne se passaient pas seulement dans les têtes des collaborateurs de l’Action Française et de l’auteur de l’Avant-Guerre. Des évènements considérables ont prouvé jusqu’à l’évidence que ces manœuvres avaient eu leur répercussion en Russie, en Italie, en Roumanie, en Irlande, en Espagne, en Suisse, qu’il s’agissait d’un système général, appliqué méthodiquement, chez les adversaires comme chez les neutres. Ce système est aujourd’hui percé à jour, et tout porte à croire qu’il va être vigoureusement contrebattu. Tant mieux : car la persistance, sur ce point, de l’aveuglement et des errements des alliés a écarté d’eux jusqu’à présent une victoire que, par leurs sacrifices et leur vaillance, ils auront amplement méritée.