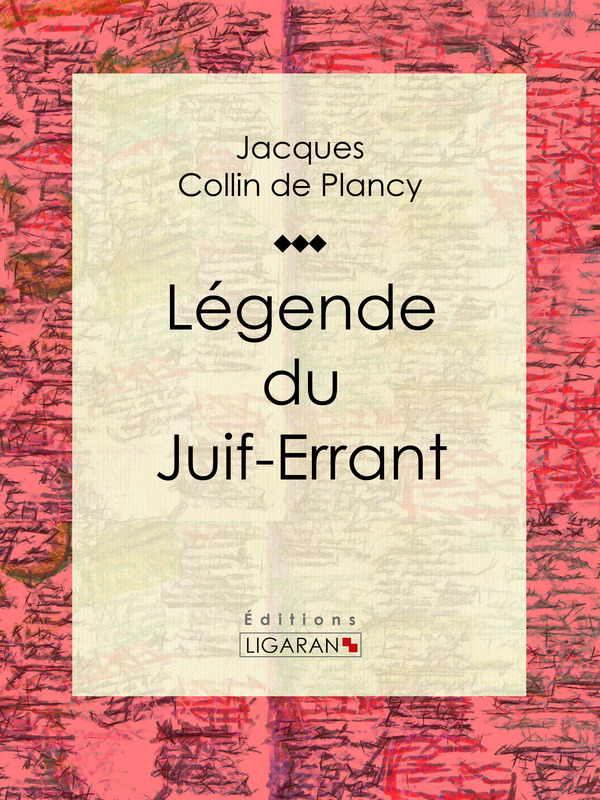
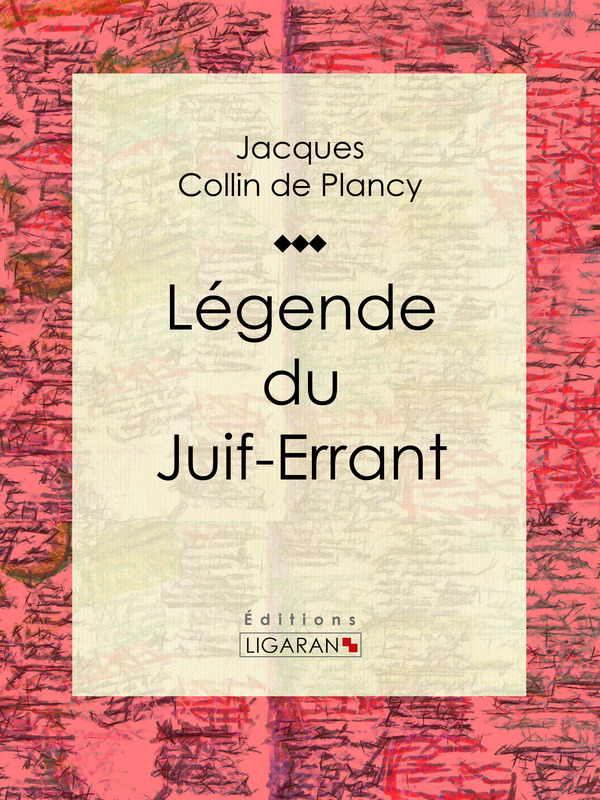
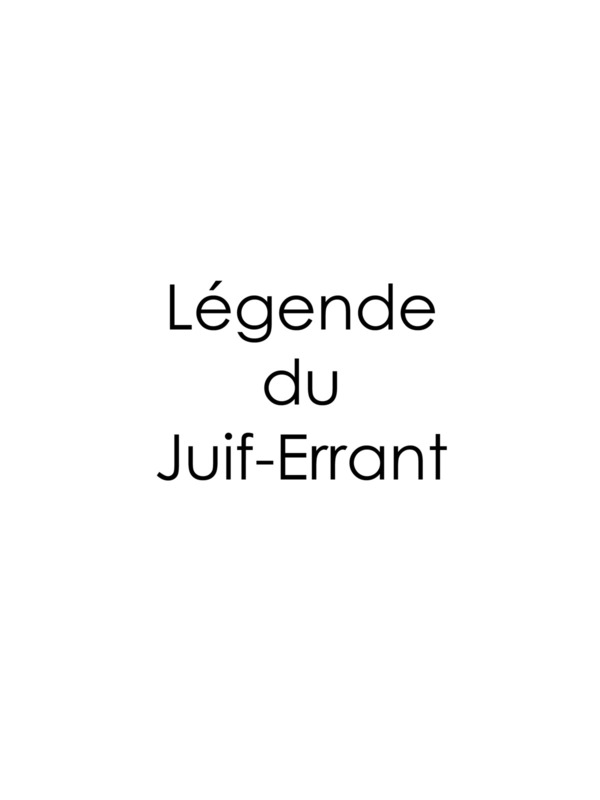
EAN : 9782335040302
©Ligaran 2015
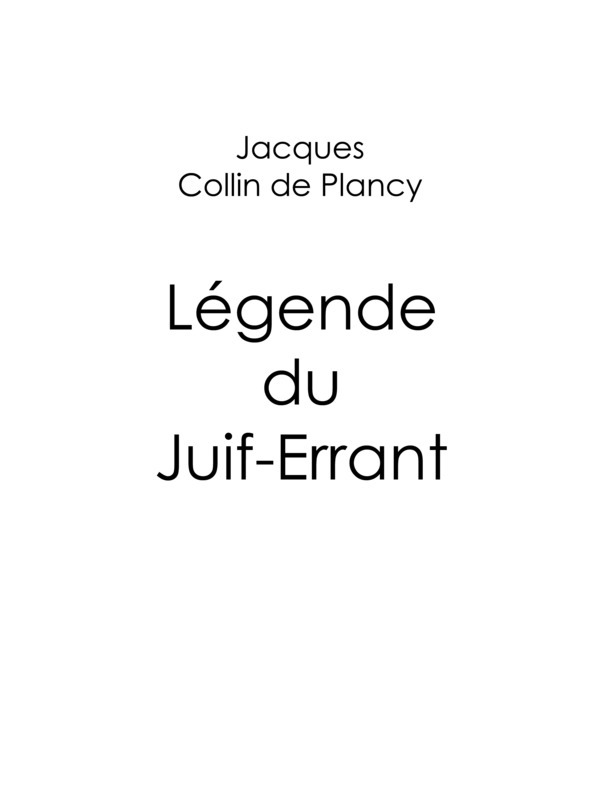
Hélas ! qui sait encor
si la science à l’homme est un si grand trésor ?
LA FONTAINE.
Il y avait quinze ans que Luther s’était levé contre l’Église romaine ; il y en avait douze qu’il était excommunié. Parmi les petits princes du Nord, gens alors habituellement grossiers et profondément charnels, la plupart avaient adopté les innovations de Luther, parce qu’elles favorisaient leurs passions et qu’elles les autorisaient à s’emparer des biens ecclésiastiques. Charles Quint avait voulu s’opposer à ce qu’on appelait la Réforme ; mais on lui répondait brutalement qu’il lui convenait mal de défendre l’Église catholique, à lui qui avait sans pitié guerroyé le Pape et saccagé Rome. Comme si le triste souvenir de sa criminelle expédition l’eût rendu timide, en effet, tandis que le repentir eût dû le porter à réparer, il hésitait et n’opposait qu’une molle résistance au torrent qui allait engloutissant les vieilles constitutions de l’Europe, menaçant les arts, les lettres et la civilisation.
Il avait pourtant, dans les diètes de Spire et d’Augsbourg, fait proclamer défenses formelles de s’attaquer aux croyances catholiques. Mais les réformateur savaient protesté contre ces décisions ; leurs princes s’étaient ligués à Smalkalde en Franconie ; ils avaient levé des armées, et Charles-Quint n’avait su faire autre chose que laisser la liberté de conscience – jusqu’à la convocation d’un concile général.
Ainsi, les portes étaient ouvertes à toutes les fantaisies, à tous les excès, à toutes les licences de l’esprit humain. Des peuples matériels, à qui on disait qu’ils pouvaient manger de la viande en tout temps, qu’on les délivrait de la confession, du jeûne, et des bonnes œuvres, qu’on leur permettait le divorce et la violation des vœux, des peuples très ignorants adoptèrent cette religion plus commode. Les moines et le clergé de ce temps-là étaient en général peu instruits, et moins encore qu’ailleurs dans les contrées germaniques. Ils cédèrent en trop grand nombre à la tentation ; la désertion des pasteurs entraîna les troupeaux.
Ceux qui voyaient de sang-froid les germes que semait la Réforme, n’en auguraient qu’une moisson de calamités. Mais les têtes sensées ne sont point ici-bas en majorité, et les gens de bien qui prévoient le mal ne savent pas, comme leurs ennemis, s’entendre et s’unir pour les luttes.
C’était à l’automne de l’année 1533. La Hollande, soumise directement à Charles-Quint, n’avait pas encore déployé ouvertement l’étendard de l’indépendance. Mais ce pays, qui s’est toujours recruté d’Allemands, subissait, comme on le voit encore de nos jours, des invasions perpétuelles de Westphaliens, de Hessois, de Saxons et de Suédois qui, infectés des nouvelles doctrines, apportaient le trouble dans des populations jusque-là heureuses et fidèles, opulentes de leur marine, de leur pêche et de leur commerce. En vain les magistrats poursuivaient tout hérétique qu’ils pouvaient découvrir. Les indépendants, parmi les cités qui les repoussaient, marchaient à la manière des sociétés secrètes, avec leurs mots de passe, leurs signes de ralliement et leur mode de reconnaissance. Des ferments de révolte agitaient donc sourdement les esprits téméraires. Nous disons de révolte, et non pas de luthéranisme, car dès ses jeunes années la réforme de Luther s’était variée en mille modifications et se formulait en autant de professions de foi qu’elle avait de ministres.
Parmi les enfants de Leyde, ville qui n’avait attendu ni son fameux siège, ni sa pesante université pour être riche et prospère, on citait comme une tête audacieusement folle un jeune tailleur de vingt-cinq ans qui se nommait Jean. Il était adroit, beau parleur, buveur joyeux, un peu querelleur. Il enviait la fortune, critiquait les riches ; et si ce n’eût été qu’il avait peur de la mer, il eût couru les aventures pour conquérir des trésors. Il avait des manies bizarres, comme on en attribue tant aux Anglais. De nos jours, on l’eût un peu caractérisé en l’appelant un homme excentrique. Il avait dépensé son petit patrimoine à des entreprises singulières, parmi lesquelles on peut citer le retournement de la pierre d’Amersfort.
De temps immémorial, on connaissait sur la place principale d’Amersfort une vaste pierre plate enclavée dans le pavé. Tous les enfants y jouaient, et à la longue une couche de mortier hydraulique qui la couvrait s’étant usée peu à peu, on découvrit des lettres gravées sur cette pierre. Les savants n’ont jamais manqué d’être à l’affût de toute trouvaille de ce genre. Ceux de la ville, qui cherchaient des preuves pour établir que Leyde n’était pas le Lugdunum Batavorum des Romains, et que cette gloire pouvait bien appartenir à Amersfort, virent là un monument, une antiquité, et s’efforcèrent de gratter la pierre, pour lire l’inscription dans son entier. Mais leur désappointement fut cruel de ne mettre à nu qu’une phrase énigmatique de mauvais hollandais, dont voici la traduction :
– Celui qui me retournera sera plus surpris qu’il ne pense. –
Les savants ne sont pas tous déshérités de finesse ; aucun d’eux ne voulut risquer les frais que sollicitait l’inscription. Il fallait des machines pour remuer cette masse. Ils pensèrent que quelque ancien plaisant, de ces plaisants qui rient en eux-mêmes, comme le Nord en possède encore, avait imaginé là quelque facétie qui pouvait être un piège. On laissait donc la pierre à sa place. Mais elle était le sujet de beaucoup de conversations ; et dans un temps où les nouvelles n’avaient encore d’autre organe que les voyageurs et les marchands, la phrase énigmatique se répandit assez vite dans toute la contrée. Jean, plus ardent que ses compatriotes, arriva un jour de Leyde à Amersfort. Il fit marché avec des charpentiers pour déchausser la pierre et la retourner, après avoir reçu du bourgmestre de la cité la promesse formelle que le trésor serait pour lui, s’il y en avait un ; et que si l’avertissement qui le tentait découvrait quelque antique objet, qu’il convînt à la ville de conserver, on le lui payerait à sa valeur. La pierre, avec de grands efforts, fut retournée. Hélas ! elle ne cachait rien ; seulement à son envers elle portait une autre inscription, qu’aucun enduit n’empêchait de lire facilement, et que voici :
– Ah ! que je suis aise de revoir le soleil.
On se fût moqué de Jean si, avec son caractère insouciant, il n’eût ri lui-même le premier de l’aventure, comme si elle ne lui eût rien coûté. On admira son désintéressement.
Pour remonter ses affaires, il s’était marié depuis ; mais sa femme ne voulant pas qu’il exposât sa petite part de fortune, il devait travailler de son métier ; et il faisait assez habilement des pourpoints et des hauts-de-chausses. Il excellait surtout dans les costumes de mascarades, qui déjà étaient usités aux kermesses.
Au physique, Jean avait la figure régulière, mais très mobile, les cheveux noirs, le teint frais, les yeux faciles à s’animer. Il était de taille moyenne et peu chargé de corpulence ; sa voix était forte, lorsqu’il ne parlait pas longtemps ; les passions la rendaient stridente ; mais elle lui manquait bientôt, n’ayant pas pour base une poitrine robuste. Cependant il jouait la comédie, et il aimait à pérorer.
Il s’enflammait pour toute nouveauté ; il soupirait après le moment où les apôtres de la Réforme pourraient venir librement à Leyde.
Dans ces dispositions, un soir que, seul dans son atelier à demi souterrain, il taillait sans beaucoup d’ardeur un pourpoint de noces, il vit entrer subitement un homme dont l’aspect le frappa. C’était un voyageur. Mais de quel pays ? Une calotte de cuir vert couvrait sa tête ; il était chaussé de bottines jaunes à l’antique, peu propres en des villes où la boue ne manque jamais ; il n’avait pour vêtement qu’une robe traînante de laine brune, pâlie et fanée, que contenait une ceinture de peau blanche ; il tenait un bâton à la main.
Sa taille était ordinaire ; il marchait fort droit, quoiqu’il parût fatigué ; son peu d’embonpoint laissait ressortir partout des muscles vigoureux. Tout dans ses traits semblait accuser un âge de soixante ans. Son teint bruni paraissait fort tanné. On pouvait compter à son front seize rides bien tracées. Sur la dernière, les plis de la peau figuraient une petite croix, si profondément marquée qu’on l’eût pu prendre pour une cicatrice. Il y avait dans ses yeux noirs quelque chose d’indéfinissable, un mélange de longue tristesse et de profonde colère, et à travers cette expression de fréquents éclairs comme des jets de flamme. Son nez d’aigle, ses dents solides, sa barbe grise, épaisse et longue, mais sans excès, lui donnaient un air imposant ; et néanmoins sa tenue et son geste révélaient quelque habitude invincible de la soumission et de l’abaissement. Était-ce un renégat ? Était-ce l’esclave de quelque riche marchand d’Asie ? Jean, en l’examinant, se faisait ces questions.
Lorsque l’étranger mit le pied sur la dernière des six marches qui descendaient à l’atelier, il salua le tailleur.
– Vous êtes celui qu’on appelle Bockelzoon, lui dit-il.
– Et mon nom est Jean.
– Votre mère était Aléïde, la servante ?
– Elle ne l’est plus.
– Votre père était Bockel, bailli de La Haye ?
– En son vivant.
– Vous ne faites plus de pièces de comédie ?
– Je m’occupe de choses plus graves.
– Vous les jouez pourtant encore ?
– Quelquefois.
– Vous avez vu Londres ?
– Et Lubeck.
L’étranger s’arrêta pour laisser passer quelque rougeur, que son singulier interrogatoire avait amenée sur les joues du jeune homme. Il reprit :
– Vous ne tenez plus cabaret ?
– Ma femme donne à boire les dimanches. Mais, qui êtes-vous, et que me voulez-vous pour me demander toutes ces choses ?
– Vous le saurez ; encore un mot. Vous n’avez pas voyagé dans la principauté de Munster ?
– Non. Il s’y passe, dit-on, des merveilles.
– Qui ne sont qu’à leur début. Vous connaissez Knipperdoling.
– Assurément, il a été mon maître. C’est un tailleur de première force. Je commence à vous comprendre. Vous m’apportez de ses nouvelles. Où exerce-t-il ?
– Il n’exerce plus son métier vulgaire. Comme vous, il s’occupe de choses plus graves ; il pense qu’un homme qui sent sa force ne doit pas rester en des lieux ou rien n’est à faire. En ce moment, les premières dignités viennent à sa rencontre.
– Depuis deux ans qu’il nous a quittés, nous ne savions plus rien de lui. Pourtant Mathys, le boulanger de Harlem, qui s’est enfui en Westphalie, nous en a fait passer quelques mots vagues. Mais si vous l’avez vu, soyez le bienvenu. Que fait-il ?
En parlant ainsi, Jean présenta un siège à l’étranger, qui refusa de s’asseoir. Il accepta pourtant un verre de vin d’Espagne.
– Je vous l’ai dit, reprit-il, il est sur la route des hautes fortunes. Mathys et lui gouvernent à peu près Munster. Là va renaître, avec des formes républicaines, une monarchie-modèle, comme on en vit aux premiers temps du monde. Là n’est déjà plus votre vieux christianisme. Les croyants régénérés de cette ville, qui sera bientôt la nouvelle Sion, n’ont déjà plus d’autre symbole que le baptême de Jean. Knipperdoling vous aime et vous appelle. Mathys-le-Voyant et Rothmann-l’Orateur, de concert avec lui, vous attendent.
Un moment de silence succéda à ces paroles concises.
Mathys et Knipperdoling dans les grandeurs, tandis que lui taillait un pourpoint ! Telle fut la première réflexion de Jean. Il sentit son cœur bondir de pensées ambitieuses ; en un moment sa résolution fut prise de partir pour Munster. Mais sa curiosité excitée éveillait en tumulte mille interrogations qu’il cherchait à mettre en ordre.
Il allait reprendre la parole, quand l’étranger lui demanda froidement :
– Que répondez-vous à l’invitation de votre ami ?
– Que je m’y rendrai promptement, si vous me donnez un témoignage auquel je puisse me fier, car je ne vous connais pas encore.
– Vous me connaîtrez plus tard, peut-être. Les questions que je vous ai faites m’étaient dictées par Knipperdoling. Voici de lui une lettre que je ne dois vous donner qu’après votre promesse. Je viens de l’entendre.
– Une lettre de sa main ! s’écria le tailleur en recevant la missive. Oh ! je la reconnais.
Il rompit vivement le cachet et lut ce qui suit :
Les voyants et les vrais apôtres de Dieu, dont le règne recommence, à Jean, leur frère. Tu viendras au milieu de nous, car j’ai vu ton âme ; je sais que l’Esprit te parlera. J’ai déclaré aux frères que la main du Père était sur toi. Avec nous, tu serviras la parole ; et dès que nous aurons vaincu l’Antéchrist, tu auras ta part de nos couronnes. Si ta femme veut t’accompagner, qu’elle vienne ; nous la purifierons dans le vrai baptême et elle sera notre sœur. Si les liens de la bête la retiennent, viens seul. Les palais des impies sont à nous. L’homme a les bras assez longs pour tout atteindre, s’il veut seulement les allonger. Ici, dans la nouvelle Sion, les plus petits sont les plus grands. J’ai pris ta mesure, frère. Écoute le sage qui te remettra cette lettre.
KNIPPERDOLING,
Tailleur spirituel, enfant du libre Esprit.
Jean relut trois fois cette lettre, dont le style mystique le surprenait étrangement. Le voyageur le considérait immobile.
– Je partirai, reprit-il enfin.
– Quand ?
– Bientôt.
– Voici venir novembre. Ne vous laissez pas gagner par les durs mois de l’hiver.
– Je partirai dans peu de jours.
– Adieu donc. Je rendrai votre réponse.
– Vous me quittez ainsi ! Demeurez jusqu’à demain.
– Impossible.
– Soupez du moins avec nous ; et que je vous connaisse.
– Nous nous reverrons.
– Souffrez une question. Qui êtes-vous ?
– Vous me retrouverez à la nouvelle Sion.
– Comment vous nommerai-je ?
– On m’appelle Isaac.
– Et vous ne pouvez vous arrêter plus longtemps ?
– Je dois ce soir être à Harlem.
– Permettez alors que je vous conduise jusqu’à la barque.
– Je vais à pied.
– Je vous mettrai dans le chemin.
– Je le connais.
Malgré cette réponse, Jean fermait son atelier. Il sortit avec Isaac, qui parcourait les rues de Leyde comme eût fait un habitant.
– Mais vous ne regardez rien de notre belle cité, dit le tailleur ; la connaissez-vous donc ?
– J’y suis venu autrefois.
– Vous n’avez ni les traits, ni le teint d’un Hollandais. Vous devez être Hollandais cependant, car vous parlez notre langue aussi bien que nous.
– Les Westphaliens à Munster me font la même remarque.
– Vous savez plusieurs langues ?
– Plusieurs en effet.
Les deux compagnons avaient franchi la porte de Harlem ; et sur le chemin public le tailleur allongeait le pas de son mieux pour suivre Isaac, qui marchait comme un cerf. Ils aperçurent bientôt, venant à eux, sur un cheval robuste, un grand gaillard taillé en force, que l’œil perçant de l’étranger reconnut de loin.
– C’est un des nôtres, dit-il. Cet homme, que vous reverrez aussi, est la colonne des enfants de Sion. Il s’appelle Bernard Buxtorf. Je dois lui dire une parole ; et il est utile que je ne vous nomme pas encore.
Le cavalier se rapprochait. Reconnaissant aussi le compagnon de Jean. – Eh ! père Isaac ! cria-t-il d’une voix d’airain, je vous trouve ici par les routes ! quelle merveille !
– Je suis en mission, frère, comme vous sans doute ; car vous n’avez pas ici la cuirasse et l’armet qui ne vous quittent point, et vous devez vous sentir peu à l’aise dans ce pourpoint de buffle.
– Au contraire, je suis plus léger. Je viderais de bon cœur une cannette, s’il se trouvait en ces chemins quelque honnête auberge.
– Vous trouverez tout à Leyde, frère. Retournez-vous à la nouvelle Sion ?
– J’y serai dans trois jours, s’il plaît au Père.
– Avant moi, par conséquent. Vous direz à Knipperdoling que le voyant qu’il attend viendra prochainement.
– Adieu.
Et le cavalier piquait son cheval. Il l’arrêta aussitôt :
– Vous ne savez pas, cria-t-il en se retournant, que notre ami Knipperdoling est sans doute en ce moment chef de justice.
– Et Mathys ?
– Roi peut-être.
Sur ce mot, il s’éloigna au galop.
Le cœur de Jean bondissait. Isaac le remarqua.
– Mon fils, dit-il au tailleur, une telle route vous fatigue ; je marche trop vite pour vous. Retournez à votre logis et préparez votre départ. Je vous remercie de la bonne compagnie que jusqu’en ce lieu vous m’avez faite. Nous nous reverrons. Adieu.
Jean voulut objecter quelques paroles de politesse. Mais le voyageur s’était si bien lancé, et le jeune homme éprouvait une telle émotion, qu’il ne fut pas capable de courir après lui. Il s’essuya le front, reprit son chemin vers Leyde, et rentra chez lui, absorbé dans des pensées qui lui déroulaient un avenir magique.
Ne vous fatiguez point sur le gouvernement.
FÉNELON, Maximes de l’honnête homme.
Depuis que se sont formés le Zuyderzée et la mer de Harlem, le vieux lit du Rhin s’est tari peu à peu vers sa principale embouchure ; et la faible partie des eaux de ce grand fleuve qui ne se confond pas avec la Meuse ne fait plus au-delà qu’un ruisseau qui conserve, avec étonneraient sans doute, le nom du Rhin, et se perd obscurément dans les sables de Katwyk. À deux lieues en avant, les eaux stagnantes et mortes que l’on continue à décorer du nom du grand fleuve, ceignent sans bruit cinquante petites îles groupées, qui ont l’air d’avoir été jadis un marécage. Sur toutes ces îles, que relie une multitude de ponts de pierre, s’est élevée cependant la belle ville de Leyde. Elle ne compte pas aujourd’hui trente-six mille habitants ; mais on dit qu’elle en avait bien davantage avant la Réforme. Cette piquante situation, l’éclat de cette ville florissante, ses édifices religieux, sa population animée, rien n’avait paru frapper le messager de Munster. Il parcourait avec la même indifférence la route de Harlem, bordée comme aujourd’hui de fraîches maisons de campagne, percée à travers deux lignes de beaux jardins, tous clos par un simple petit canal, tous émaillés de fleurs variées qui s’épanouissaient là durant la belle saison, et qui duraient jusqu’à la fin d’octobre.
Les charmes de la riante ville de Harlem ne l’occupèrent pas plus. Il faisait nuit lorsqu’il y entra ; mais la ville était encore catholique, et les lanternes allumées devant les images des saints et des vierges qui protégeaient la façade de la plupart des maisons, éclairaient suffisamment les rues. Isaac assurément connaissait Harlem aussi bien que Leyde, car il ne demanda son chemin à personne ; il traversa, par les voies les plus courtes, une grande étendue de la ville, et s’arrêta sans hésiter devant une des plus petites maisons du pourtour Saint-Bavon, sur la porte de laquelle on lisait cette enseigne :
In de peperkœk ; Divarre, brœdbakkerin.
Ce qui veut dire en français :
« Au pain d’épice ; Divarre, boulangère. »
Les Hollandais, ainsi que les Allemands, ont toujours eu quelque bienveillance pour les juifs. Déjà alors les noms de l’ancien Testament n’étaient pas rares chez eux. Divarre n’est autre que Débora.
Le voyageur frappa à la porte. Un jeune mitron vint lui ouvrir ; on n’était pas encore couché. Il fit entrer Isaac dans la salle du fond, où la maîtresse du logis, assise devant les débris de son souper, lisait dans une grande bible, à la lueur d’une lampe à deux becs. Elle leva la tête à l’arrivée de l’étranger et le reconnut.
– Des nouvelles de mon mari ! dit-elle en fermant son livre. Asseyez-vous, père Isaac ; soyez le bien reçu ; et soupez, si vous arrivez avec la faim. Voici du bœuf fumé, des concombres au vinaigre, des pains à la viande, et de l’hypocras.
– Vous ne m’avez donc pas oublié ? répondit le vieillard en s’asseyant et en témoignant qu’il acceptait l’invitation.
– Et pourtant je ne vous ai vu qu’une seule fois, lorsque, venu ici pour des motifs que je n’ai pas connus, vous avez décidé, il y a deux ans, mon mari ruiné à partir pour Munster. Ce qui m’étonne, père Isaac, c’est que votre habit n’ait pas plus vieilli que vous…
– Votre maison, si l’apparence est fidèle, n’a pas souffert non plus de l’absence de Mathys.
– Elle s’est relevée au contraire. J’occupe désormais quatre garçons. La clientèle revient, et les affaires marchent. Mais lui ?
– Lui, il prospère aussi.
– Plus d’une fois déjà il me l’a mandé. Je ne l’ai cru qu’à demi. Les jeunes hommes dans notre ville sont enclins à se tromper. Cependant il sait les saintes Écritures ; c’est un hardi parleur ; et dans un état comme Munster, où la libre pensée peut se faire jour, il a dû percer, s’il n’a pas eu à travailler de sa personne. Il était ici fort négligent.
– Travailler ! l’esprit se manifeste en lui. Il s’est révélé le voyant et le prophète du nouveau peuple ; c’est par l’intelligence qu’il travaille, réglant tout, gouvernant tout ; et un jour, inopinément peut-être, il sera roi, – s’il ne l’est déjà…
À ce mot prononcé froidement, la jeune femme bondit sur son siège.
– Roi ! mon mari serait roi !… Et moi ? dit-elle.
– Et vous, répondit lentement le voyageur, vous, – si vous le voulez, – vous serez reine.
– Mais, pardon, vous me faites dire des sottises, reprit Divarre en rougissant un peu ; vous ne parlez pas sérieusement. Mathys serait roi ! Je serais la reine Divarre !… Je fais un rêve… Et pourquoi pas en effet, dit-elle ensuite en remarquant le grave maintien d’Isaac, s’il est vrai que Munster devienne la nouvelle Sion ?… Si l’esprit règne ?… Si c’est l’esprit qui gouverne et non plus le privilège ?…
– Oui, il en est ainsi dans la ville des fidèles enfants du Père. Les jours de Salomon vont renaître.
– Ainsi les comtesses, les duchesses, les femmes des princes et des margraves n’effaceront plus la simple bourgeoise ?
– L’égalité sur toute chair.
– L’égalité, c’est beau ! Je serais reine ! Il est temps, certes, que de tels retours arrivent. On nous gouverne par des lois, mesures générales qui ne vont à la taille de personne. Les inspirations de l’esprit ne sont pas au moins des règles mortes ; elles jaillissent à propos. Je serais reine ! Vous voyez que je lis, comme mon digne époux, les Écritures. S’il est roi, roi comme Salomon, il aura dans sa compagne un conseil. Mais les peuples ont soif d’un tel règne. Qu’il se lève donc, et toute la terre s’inclinera.
– Tel est, dit Isaac, sans paraître frappé des échappements ambitieux de Divarre, tel est l’espoir de la nouvelle Sion, centre d’une régénération immense, qui va ramener dans leur pureté les beaux temps des patriarches. Ceux que l’esprit discernera seront les seuls chefs. Débora fut juge en Israël.
– Débora !… une femme !… Et Divarre fit un soupir.
Isaac tira de sa ceinture une longue enveloppe de soie. Il l’ouvrit, et il fit briller aux yeux de la jeune dame une magnifique parure de diamants.
La boulangère, dit-on, était citée comme l’une des plus belles femmes de Harlem. Elle brillait encore plus par sa coquetterie vaniteuse. Elle n’eut pas plutôt entendu les paroles qui lui annonçaient que cette riche parure était pour elle, qu’elle poussa de longs cris, de joie. Elle ne s’inquiéta pas des moyens qui avaient pu mettre tant de trésors aux mains de son mari. Elle s’écria :
– Voilà l’égalité ! J’ai des diamants.
– Et quand le règne des jours antiques sera vraiment et pleinement rétabli, dit Isaac, toutes les femmes auront ces splendeurs.
À ces paroles, le front de Divarre se rembrunit.
– Mais toutes ne seront pas reines, dit-elle.
– Ainsi, reprit le messager, après un moment de silence, vous viendrez à Munster ?
– Assurément. Dès demain, je fais mes apprêts. J’aliène cet humble comptoir et je quitte la Hollande. Mais, par quelle route sûre puis-je me hasarder dans la Westphalie ?
– Vous rejoindrez le tailleur de Leyde, Jean, fils de Bockel, qui se rend sous peu de jours auprès des voyants. Mathys, prévenu par moi, qui arriverai avant vous, viendra à votre rencontre. Le 15 novembre, vous pouvez y compter, il vous attendra à Cœsfeld. Pour gagner cette ville westphalienne, que l’esprit n’a pas encore touchée, vous n’aurez à traverser que le pays d’Utrecht, la Gueldre et Zutphen, contrées paisibles. De Cœsfeld à Munster on compte neuf lieues de chemin, que les chances de la guerre peuvent rendre périlleuses. Mais, par les soins des nôtres, vous aurez une grande et bonne escorte. Faites donc avertir Jean de Leyde ; concertez-vous avec lui. Je l’ai quitté tout à l’heure plus décidé que je n’espérais. Que le Père soit pour vous. Je me retire à présent. Demain, aux premières lueurs du jour, je pars pour Amsterdam. Recevez mes adieux.
– Vous coucherez ici, reprit Divarre.
– Dans cette chambre basse, si vous le permettez. Vos garçons se lèvent avant l’aurore ; ils m’ouvriront les portes.
Divarre souhaita une heureuse nuit à l’étranger, et pressant ses diamants sur son cœur elle monta à sa chambre, où son agitation ne lui permit pas de trouver le sommeil.
Si vous compreniez bien ce que vous êtes, vous ne chercheriez peut-être plus à être ce que vous n’êtes pas.
PLAUTE.
Le même soir, pendant qu’Isaac entraînait la boulangère de Harlem dans l’arène des ambitions, le tailleur de Leyde essayait auprès de sa femme les mêmes fonctions de tentateur. Mais, par un de ces bizarres instincts qu’on a pu remarquer fréquemment dans les mauvaises têtes, il se trouvait que Jean, au contraire de Mathys, avait épousé une femme sensée.
– Vous ne savez pas, Lydwine, lui dit-il, les brillantes fortunes qu’on est venu tantôt nous offrir ?
– Pardon, répondit doucement Lydwine ; – et désignant de la main un œil de bœuf ouvert dans la cloison qui séparait la salle où elle se tenait de l’atelier de son mari, qu’elle pouvait inspecter ainsi à tout moment : – j’étais là, derrière la vitre, continua-t-elle ; j’ai tout vu en soulevant le rideau, et j’ai tout entendu en tirant un peu le châssis. Cet homme qui vous parlait n’est autre qu’un vieux juif.
– C’est possible, je ne le connais pas ; mais qu’importe ?
– Il vous a proposé d’abandonner votre pays.
– Pour faire fortune.
– On ne fait jamais fortune plus sûrement que par le travail. Par d’aventureuses entreprises on court des chances. S’il était nécessaire de quitter Leyde pour être heureux, la ville ne serait pas si peuplée. Mais enfin, que les hommes qui n’ont pas de toit ou qui sont réduits à fuir s’en aillent, leur excuse est dans leur extrémité. Vous n’en êtes pas à ce point. Ne vous proposait-il pas ; autre chose ?
– Lui-même ne me proposait rien. Il m’apportait une lettre.
– J’ai bien entendu. Il est le messager de gens qui se sont sauvés prudemment de la Hollande, lorsqu’ils voyaient qu’on allait les en chasser. Je devine ce qu’ils vous offrent.
– Mathys est roi peut-être.
Lydwine leva la tête en sursaut.
– Knipperdoling est chef de justice.
Elle fit un second mouvement.
– Ils m’appellent à partager leurs prospérités.
– À gouverner avec eux, reprit Lydwine avec un sourire triste, et qui gouvernent-ils ? Mais, est-on propre à conduire les autres, lorsqu’on ne sait pas se conduire soi-même ? Je parle pour Knipperdoling et pour Mathys. Sait-on administrer un état, et un état en pleine désorganisation, lorsqu’on n’est pas de force à diriger son humble ménage ? Je parle pour vous. Ils vous invitent à régner dans leurs rangs sur une ville où s’est mis le désordre flagrant, sur un pays révolté. Vous ne songez pas que les princes viendront avec des armées. Ils reprendront la pauvre ville ; et que fera-t-on de Mathys et des autres ?
– Le temps des princes est passé.
– Non, puisque vous dites que Mathys le devient ; et je crois qu’il ne vous déplairait point d’être roi aussi.
– Pourquoi pas ? répliqua Jean en affectant un sourire. J’occuperais un poste élevé, aussi bien que Knipperdoling qui n’a que de l’audace, que Mathys qui n’a que de l’adresse, si j’ai seul ce qu’ils ont à deux. Mais vous, Lydwine, n’aimeriez-vous pas, si une couronne vous était offerte, à vous entendre saluer du nom de reine ?
– Dans les temps de troubles, il n’y a que trop de fous ; n’en augmentons pas le nombre. Pour ma part, je prie Dieu de m’en préserver, et à votre question insensée je ne puis répondre.
– Vous êtes trop sage, Lydwine ; j’admire votre calme ; les grandeurs ne vous tentent pas.
– Les grandeurs de la terre ? Nous ne sommes pas nés pour elles. Le bonheur est pour nous dans l’obscurité ; il est le prix du travail. Au bout de la vie, la simple bourgeoise et l’honnête ouvrière sont aussi riches que les impératrices. Pourquoi donc nous tourmenter ? Personne n’emporte d’ici-bas que ce qu’il y a apporté, et les enfants d’Adam sont tous jetés nus en ce monde. En tenant cabaret comme vous l’avez voulu, je remplis un devoir assez pénible. Mais si je ne fais pas le mal, je reposerai cependant. Pour vous, il y a pis que les grandeurs dans l’appât qu’on vous tend. Je sais où on vous conduira ; vous ne risquerez pas votre tête seulement ; on vous fera oublier votre âme ; on vous demandera, déserteur de votre pays, d’abandonner aussi votre religion. On fera de vous un renégat.
– Qui vous a dit cela ?
– Un renégat ! Si vous aviez sur vous cette tache affreuse !…
– Mes amis sont des réformateurs…
– Des réformateurs ! Et de quel droit ? En savent-ils plus que le pape et ses cardinaux, que l’Église et ses conciles, que les apôtres et les saints Pères ? Qui les a faits docteurs ? Qui les a établis juges des évêques et des curés, eux des tailleurs et des boulangers qui ne savent pas pétrir leur pâte et coudre leurs boutonnières ? Des réformateurs ! dites des destructeurs, et ce que je vous disais qu’ils feront de vous.
– Mais, Lydwine, vous les jugez mal. Vous ne suivez pas comme moi le cours de l’opinion. Il faut à notre époque une réforme. Les abus doivent tomber ; c’est un besoin senti. Luther, vous le voyez, a triomphé ; des évêques et des princes l’ont suivi. Beaucoup de curés ont déjà secoué le joug de l’Église romaine.
– Oh ! je devais prévoir que vous approuveriez ces criminelles nouveautés. Elles vont à votre tête malheureuse. Ainsi, Jean, vous donnerez la main à ces hommes méprisés, qui vous écrivent que le vieux Christianisme n’est plus, quand son fondateur divin a dit qu’il serait avec son Église jusqu’à la consommation des siècles. Je ne lis pas comme vous ; mais je n’oublie point les sûrs enseignements de l’Église. Je n’abandonne pas la sainte bannière que nos pères ont suivie quinze cents ans.
– Mais, encore un coup, Lydwine, nous n’apostasions pas non plus ; nous réformons les excès ; nous rétablissons les choses anciennes. Je vous le répète, une foule de curés sont avec nous.
– Ceux qui étaient la plaie et la honte du sacerdoce, je le conçois. Mais l’Église, que dit-elle ? Elle les excommunie ; elle repousse de son sein les réformateurs téméraires ; et vous allez vous joindre à eux. L’Église sait bien que vous ne vous arrêterez pas, que vous reculerez jusqu’au bout ; que, semant la destruction, vous n’amènerez que la ruine.
– Je comprends, dit Jean en relevant la tête ; vous êtes obstinée dans vos liens, vous aimez l’erreur et rabaissement. Ni l’affranchissement de l’esprit, ni la liberté de l’action et de la pensée, ni la conquête des biens ne vous tentent. Vous refuserez de me suivre.
– Ainsi, vous partez. Vous délaisserez une femme qui s’était liée à vous ; vous irez dans un gouffre. Vous n’en sortirez pas.
Le tailleur poussa un amer éclat de rire, strident et bruyant, qui couvrit la voix de sa femme ; et, saisissant cette occasion de rompre brusquement un entretien qui l’embarrassait et qu’il soutenait mal, il sortit en disant :
– Vous y réfléchirez…
Deux jours après, Jean de Leyde reçut de Divarre un message qui l’engageait à se tenir prêt à partir le 10 novembre, pour être le 15 à Cœsfeld, où l’on viendrait à leur rencontre. Il fit, en homme décidé, ses dispositions ; et, malgré les sages observations de Lydwine, qui ne voulut quitter ni sa maison, ni son pays, ni son Église, ni la paix de sa vie, Jean de Leyde ceignit ses reins, laissa sa femme, dont il dédaignait les représentations, et se lança avec l’ambitieuse Divarre dans les sentiers de ce qu’il appelait la Réforme.
Seulement, en franchissant le seuil de sa demeure, il dit encore à Lydwine :
– Mais enfin, quand je serai prince, viendrez-vous me rejoindre ?
– Non. Mais si les malheurs que vous affrontez épargnent votre tête, vous retrouverez toujours ici votre femme et un asile.