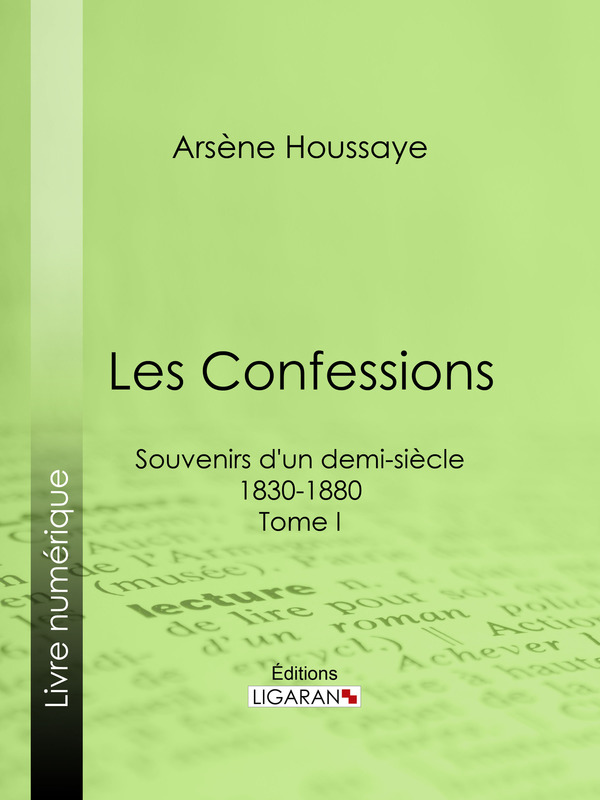
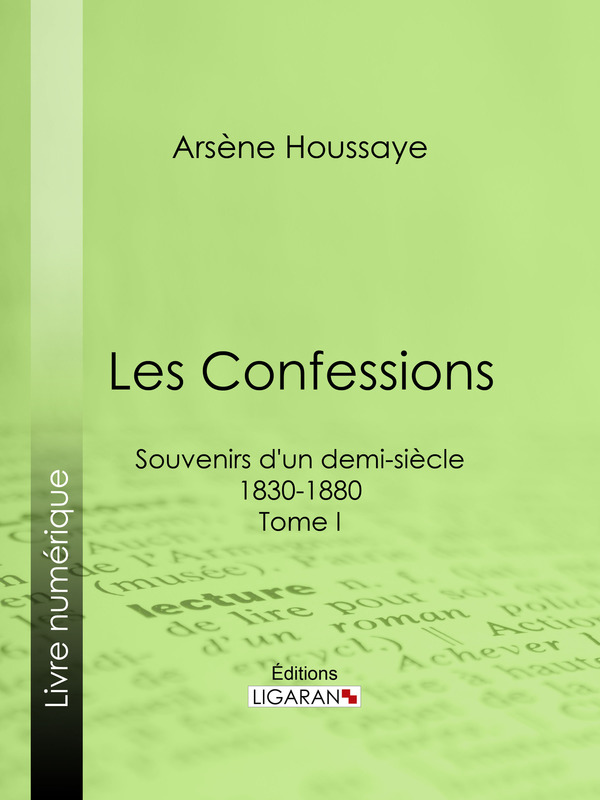


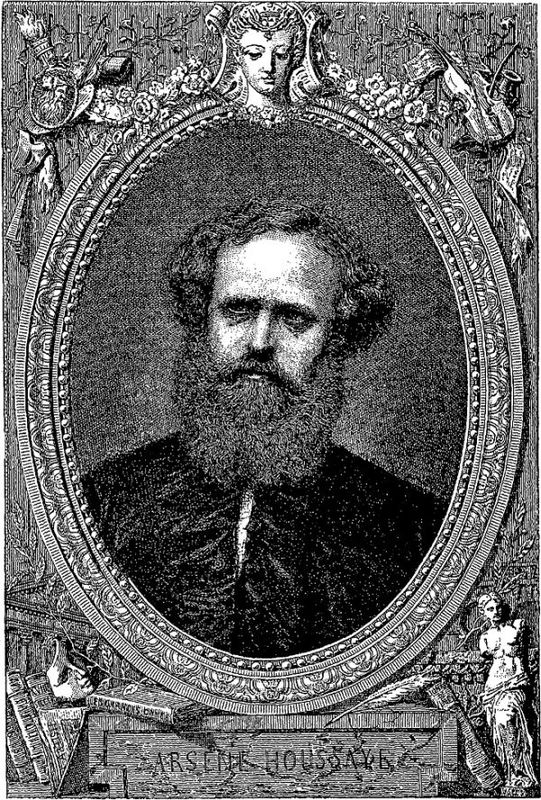

POURQUOI J’AI ÉCRIT CES MÉMOIRES
Avant de faire ma confession générale en racontant chacune des scènes de la comédie parisienne dont j’ai été si longtemps le spectateur, j’avais déjà donné – mais à un seul exemplaire – le roman de mon cœur à une étrange créature, gourmande de toutes les curiosités, une insatiable et une affolée sur le chemin de l’absolu.
Pourquoi ? C’est ce que vous dira cette première histoire.
En 186 –, le duc de Morny donna un bal masqué qui fut la plus belle fête de l’hiver. C’était au palais de la Présidence. Les illustrations et les célébrités de la veille ou du lendemain, la politique, la diplomatie, les arts, le journalisme, ce quatrième pouvoir de l’État, se pavanaient sous le manteau vénitien devant toutes les beautés mondaines et archimondaines, qui Jouaient des yeux et des lèvres à travers le masque. C’était au meilleur temps du second empire ; pas de points noirs à l’horizon ; la quiétude du luxe et de l’argent : on vivait pour vivre – au jour le jour. – On ne parlait à la Chambre que pour prouver son éloquence. On n’avait peur de rien, on croyait dominer le monde, jamais Paris n’avait été si hautement reconnu pour la capitale universelle.
Les journaux ne s’occupaient, dans leur partie officielle, que de la chevelure des duchesses et des chevaux des comédiennes.
Tout le monde était au bal de Morny : l’empereur, l’impératrice, madame de Metternich et madame de Galliffet, le lorgnon d’Émile de Girardin et la culotte courte de Darimon, le flot tumultueux des Parisiens et des Parisiennes de la décadence. Les hautes mondaines jetaient plus que jamais les rubans de leurs cheveux par-dessus les moulins – les derniers moulins de Montmartre. – C’étaient peut-être les dernières duchesses !
On s’en donnait donc à cœur joie sous la présidence en domino de Napoléon III, qui s’amusait comme un écolier.
Je connaissais depuis longtemps le duc de Morny ; je l’avais vu pour la première fois dans un salon célèbre, le salon de la comtesse Le Hon, au rond-point des Champs-Élysées, ce salon jaune que j’ai revu une dernière fois à un gai et docte dîner chez Nigra. Je me suis retrouvé seul des anciennes figures.
Il y a une jolie aquarelle d’Eugène Lami qui représente ce salon en 1850 ; le très spirituel peintre y a dessiné M. de Morny vu de dos, mais la touche est si fine qu’on le reconnaît du premier regard à son geste décidé, à sa désinvolture, à sa précision. Il y a des hommes de précision, comme il y a des armes de précision. Ces hommes-là frappent toujours juste jusqu’au jour où la mort, une autre arme de précision, les frappe dans leur œuvre.
De tous ceux qui posaient plus ou moins dans cette aquarelle d’Eugène Lami il n’y a plus qu’un seul vivant, c’est moi ; je m’y reconnais encore à ma barbe, quoique bien des années me séparent de cette soirée charmante où tout le monde avait de l’esprit même sans le vouloir, parce qu’il y a des salons où l’esprit est de rigueur.
Un moraliste a dit que rien n’est plus embarrassant pour un homme d’esprit que la compagnie des sots. Mettez un homme de génie au milieu de vingt imbéciles, il deviendra tout de suite un peu plus bête que les autres ; mettez une bête, – je ne dis pas un sot, – au milieu de vingt hommes d’esprit, cette bête en bonne compagnie deviendra soudainement plus spirituelle que les gens d’esprit, parce qu’elle aura plus d’imprévu dans sa riposte. Tout cela est une affaire de contagion. Il y a des épidémies d’esprit, comme il y a des épidémies de bêtise. L’homme n’est vraiment absurde que devant la femme qu’il va aimer.
Quand le duc de Morny donnait son bal masqué, en 186 –, il avait bien changé de monde. On en était au temps où un mari bien connu disait à sa femme en lui parlant de son amant : « Je t’avais toujours dit que cet homme-là nous tromperait. » Ce qui n’empêchait pas la belle dame, tout éplorée comme une Élégie en habits de deuil à traîne, de garder dans son oratoire, c’est-à-dire dans son cabinet de toilette, le portrait de M. de Morny en face du portrait du duc d’Orléans, car elle avait dit en ses belles années comme une comédienne célèbre : « L’un me fait aimer l’autre. »
Mais autre temps, pareilles mœurs !
Les jeunes filles qui chercheraient ici un cours de littérature feront bien de fermer ce livre.
À peine étais-je arrivé au bal de Morny, une femme se jeta à ma rencontre. C’était un domino de satin blanc tout épanoui de violettes. Je me penchai sur son cœur pour respirer comme dans un paradis retrouvé ; car je ne doutais pas que cette femme ne me fût bien connue. On ne se jette pas ainsi dans les bras des gens si l’on n’a pas déjà voyage ensemble dans la vie.
Elle commença par me débiter des impertinences. Par la raison qu’elle m’accusait de tous les crimes, je lui reconnus toutes les vertus. « Toutes les vertus, me dit-elle, vous allez être bien attrapé, vous qui cherchez des femmes demi perdues, de ne trouver en moi qu’une femme impeccable : mon domino est le symbole de ma vertu. – Alors pourquoi vous jetez-vous dans mes bras ? – C’est parce que je n’ai pas peur. On m’a dit tant de mal de vous que je veux faire des fouilles dans votre cœur. – Je n’en ai pas. – Dans votre esprit. – J’en ai encore bien moins. Vous savez bien que les gens d’esprit font courir le bruit qu’ils ont de l’esprit, mais c’est pour cacher leur bêtise. »
Ce fut à peu près ainsi que s’engagea la guerre. Je voulais toujours respirer les violettes, mais le domino me battait à coup d’éventail, pour me contenir dans les limites légendaires.
La dame était charmante, – d’autant plus charmante que je ne la voyais pas bien, – charmante par la désinvolture ; par ses yeux qui brûlaient le masque ; par ses dents qui éclataient sur ses lèvres rouges. On a beau être dans un bal masqué, – masqué pour les femmes, – on voit toujours la bouche avant de s’aventurer. Et ici la bouche, dents blanches, lèvres rouges, senteur de vie, jetait les plus jolis mots. De l’esprit en diable et à la diable, « Est-ce que c’est votre habitude d’avoir tant d’esprit ? Ou bien n’est-ce qu’un accessoire de carnaval ? – Pourquoi cette impertinence ? – Parce que je connais beaucoup de femmes qui n’ont pas d’esprit chez elles et qui s’en donnent à cœur joie dès qu’on ne les connaît pas. – Vous voulez dire que je débite des choses risquées ? – Oui, risquées, mais je n’en rougis pas. »
Et autres causeries de carnaval.
La dame se montrait de plus en plus, jouant avec fureur de son éventail, parlant à tort et à travers. Mais je comprenais bien qu’elle jouait à tous les masques. J’avais beau la regarder de face, de profil, de trois-quarts, soulever le masque de son cœur comme celui de sa figure, j’étais ébloui et aveuglé, « Voyons, reconnaissez que vous ne me connaissez pas ? – Non. Je ne vous connais pas, c’est pour cela que je vous aime. – Oh ! voilà une déclaration de guerre. – N’êtes-vous pas mon ennemie ? – Ni ennemie ni amie. Je veux m’amuser : Voilà tout. – Moi aussi, je veux m’amuser : Voilà tout. »
La belle avait pris mon bras. Nous rencontrâmes le comte Walewski qu’elle arrêta en lui portant les armes avec un bouquet de violettes. « N’est-ce pas, lui dit-elle, que je ne connais pas Arsène Houssaye ? – Je ne sais pas, répondit le comte, mais je sais bien qu’il ne vous connaît pas, car, moi qui vous rencontre souvent dans le monde à visage découvert, je n’ai pas deviné votre énigme. – Vous voyez, me dit la dame, mon nom c’est le sphinx. Et je suis d’autant plus le sphinx, que je ne me connais pas moi-même. »
Nous étions au buffet, où j’eus presque une affaire avec un de mes amis qui voulait cueillir des violettes : « C’est bien, me dit-elle, d’avoir défendu mon jardin ; mais la vérité, c’est que ce n’est pas pour moi : c’est pour vous. Vous vous figurez déjà que vous escaladez le mur mitoyen. Mais, halte-là ! je vous laisserai peut-être un jour cueillir des violettes, quand j’aurai déchiré votre masque. Car vous êtes bien plus masqué que moi-même. – Allons donc. Mon âme est dans une maison de verre. – Oui, mais c’est du verre de Bohême : on ne voit pas au travers. Quand je pense qu’il n’y a pas un homme au monde qui ose se montrer tel qu’il est. – Nous laissons ce plaisir – là aux femmes. – Vous riez. Les femmes se laissent surprendre quand elles nagent dans leur passion, mais les hommes se tiennent toujours au rivage. Ils ont beau verser des larmes de crocodile, ils ne se démasquent jamais. – Je vous jure que je n’ai rien à cacher. Pas plus les orages que les arcs-en-ciel. Qu’est-ce que l’homme ? un violon plus ou moins sonore qui rit et qui pleure quand cette vieille folle de Destinée joue l’air connu. – Oh oui ! l’air connu ! c’est toujours la même chanson. »
Nous allions, nous venions. On avait beau nous parler deci-delà, nous restions bras dessus bras dessous, heureux de ne pas nous connaître et de nous trouver ensemble.
Le maître de la maison, qui s’amusait comme s’il ne fût pas chez lui, vint un instant nous dire des folies. Quoiqu’il connût presque tout le monde, puisque les femmes s’étaient démasquées pour lui à leur entrée dans le premier salon, il ne savait pas bien à qui il avait affaire, tant les dames étaient malicieuses pour jouer aux métamorphoses. Naturellement, l’imprévu et l’inconnu, ces deux attractions irrésistibles, m’avaient pris le cœur, j’étais comme un condamné qui va rentrer dans sa prison ; car à chaque instant mon sphinx m’avertissait que l’heure était venue de ne jamais nous revoir, – moi qui ne l’avais pas vu !
J’avais gagné du temps, à force d’éloquence. Je finis par le décider à souper. J’aurais bien voulu que ce fut au café Anglais, ou à la Maison-d’Or, – ou chez moi, – ou chez elle, – mais elle n’accepta que le souper debout chez l’amphitryon, – le souper avec le masque.
Quoiqu’elle se défendît bien, toujours avec un éventail, – car je ne la prenais pas au mot quand elle me rappelait à l’ordre, – j’avais fini par faire quelques découvertes géographiques. Un cou adorable, des cheveux blonds, ruisselants de lumière dans leurs ondes soulevées, une épaule tombante doucement nourrie de chair, deux seins fiers d’eux-mêmes, comme des jeunes chevaux qui savent leur beauté et qui lèvent orgueilleusement la tête.
Que vous dirai-je ? Nous soupâmes gaiement. Ce qui mit un peu de gaieté dans notre passion improvisée ; car est-il rien de moins rieur que les passions ? Nous avions toujours l’air de nous moquer l’un de l’autre. Mais nous nous étions pris à ce feu de paille des aventures parisiennes. Quand la dame demanda ses chevaux, je me hâtai de lui dire que je n’en avais plus. « Eh bien, vous figurez-vous que je vais vous reconduire chez vous ? – Chez vous si vous voulez. – Rien que cela ! Me prenez-vous pour une soupeuse ? – Je sais très bien qu’il y a soupeuse et soupeuse. Vous me permettrez au moins de vous conduire jusqu’au marchepied de votre coupé ? – Non. Vous savez bien que je vous connais. – Vous me connaissez mal. Emmenez-moi chez vous, je vous ferai ma confession. – Non. Faites-moi votre confession extra-muros. – Pourquoi me mettre à la porte ? – Écrivez un livre pour moi : Le livre de votre vie. – Je perdrais mon temps. Car le roman de ma vie serait le seul roman de moi qu’on ne lirait pas. » Le domino me regarda comme une pyramide : « L’orgueilleux ! je le lirai, moi. Voyons, faut-il vous le payer d’avance, comme font les libraires de Lamartine ? – Oui. – Combien ? j’ai ma bourse de jeu : il y a bien sept ou huit mille francs. – C’est toujours ça. Mais ce n’est rien : je ne voudrais pas être payé de cette monnaie-là. – Eh bien, si vous voulez, je vous paierai comme vous voulez être payé. Seulement, le livre sera écrit pour moi, à un seul exemplaire. – C’est dit. »
Voilà pourquoi les chapitres trop intimes des Confessions ont été écrits. Pourquoi les avoir publiés ? Parce qu’ils ont été écrits.
Morny vint à passer dans un cortège de curieuses ; il me fit un signe, pour me dire que j’étais bien tombé. Quoique je ne voulusse pas me séparer de la dame, même pour une seconde, j’allai à Morny pour le questionner. « Non, non, dit-il en raillant, tout masque ici est sacré ; c’est à vous à dénouer le masque. – Pourquoi me laisser perdre mon temps ? – Vous appelez ça du temps perdu, vous ! Dieu merci ! prendre feu pour une femme quand on ne la connaît pas, c’est l’idéal. » Il avait passé. Je me retournai vers la belle ; elle-même avait passé, mais je la retrouvai bientôt accaparée par trois ou quatre amoureux. « Ce n’est pas de jeu, lui dis-je, ces messieurs repasseront. » Et je l’entraînai. « Si tu veux mes Confessions, il faut pourtant bien que tu me dises où tu les liras. – Oui, je te vois venir, tu voudrais que ce fût chez toi. – Tu y viendras quoi que tu fasses. – Jamais, jamais, pas plus que tu ne viendras chez moi ; mais nous nous rencontrerons, tu vas à Trouville, tu vas à Venise, tu vas aux Lundis de l’impératrice ; dis-moi où tu ne vas pas ? – Oui, mais soyons pratiques. Si tu veux que je m’imprime pour toi à un seul et unique exemplaire, dis-moi où je te porterai ce livre, cet oiseau rare, car un livre est un oiseau ? »
Un silence. La dame sembla chercher, de bonne foi. « Je t’écrirai, mais je t’avertis que c’est ma femme de chambre qui tient la plume. – Cela s’est vu. Après tout, je ne suis pas tant affolé de tes pattes de mouche que de toi-même, pourvu que tu ne m’envoies pas ta femme de chambre un jour de rendez-vous…– Oh ! non, je suis loyale : pas de fausse monnaie. – Mais si je veux t’écrire, moi ? – Eh bien, tu m’écriras au nom de ma femme de chambre, Mlle Élisa, bureau restant n° 3. – J’ai bien envie de ne pas t’écrire du tout. – Il faut bien commencer par le commencement. – J’aime mieux commencer par la fin. »
Alors je tentai de me moquer de ses airs mystérieux : le lui représentai qu’il n’y avait plus que les bourgeoises qui fissent gravir à leurs amoureux les stations de la croix. Je lui rappelai que nous étions dans une maison où on ne donnait pas dans ces bêtises du monde antédiluvien. « Morny, voilà l’homme. – C’est mon opinion. À la bonne heure, celui-là n’y va pas par quatre chemins. Dans le mauvais chemin, je vois bien que c’est ton maître. – J’ai eu deux maîtres dans l’art de vivre, Morny et d’Orsay, comme j’ai eu deux maîtres dans l’art d’écrire, Hugo et Musset. – Tu as frappé aux meilleures portes. – Mais c’est à ta porte que je veux frapper pour te prouver que Morny m’a donné de bonnes leçons. Tiens, tu es si jolie que si je savais où est ta porte je passerais par la fenêtre. – Eh bien ! Morny qui m’a aimée pendant vingt-quatre heures… plus longtemps que toi… n’a passé ni par la porte ni par la fenêtre. – C’est étonnant, lui qui ne procède que par coup d’État. »
La dame ne se fâcha pas. « Oui, dit-elle, c’est bien là son école. – La vie est si courte ! Si tu étais une vraie femme, tu ne me remettrais pas au lendemain. – Oui, mais je suis une vraie femme, qui n’a pas la liberté de ses mouvements. Si tu me regardais moins, tu verrais passer de temps en temps des yeux jaloux. – Je ne vois que toi, je n’aime que toi, je ne veux que toi. Est-ce que tu t’en vas seule ? – Oui et non. – Eh bien, oui. Je vais t’attendre au bas du perron, je te jetterai dans ma voiture ou dans la tienne. – Oui, comme tu me jetterais dans un lit nuptial. Mais non, ce n’est ni l’heure ni le moment, tout ce que je puis te dire aujourd’hui, c’est que je t’aime ! Sur ce mot-là il faut tirer le rideau, car je n’ai plus la force de parler. »
Et ses deux beaux yeux parlèrent plus haut que la voix, « Oui, je t’aime ! parce que tu as parlé à mon cœur, à mes lèvres, à ma curiosité. »
Elle dit cela si bien qu’elle me brûla l’âme, je me voyais dans une flambée amoureuse.
Son cœur était si près du mien que je le sentais battre violemment.
Elle se leva : « Adieu ! adieu ! tu m’écriras au nom de Mlle Élisa. »
Cette fois elle s’envola comme un rêve. Je me demandai pendant quelques secondes si j’étais bien éveillé. Je devinai qu’elle ne resterait pas plus longtemps à la fête. J’essayai de la rattraper dans les antichambres pour tenter de me jeter dans sa voiture ; mais quand je la revis, elle était avec une de ses amies, un domino noir qui lui passait sa pelisse. Alors je compris que je n’avais pas le droit de faire un pas de plus. En effet, les deux dominos s’en allèrent ensemble. Je ne connaissais sans doute pas plus le domino noir que le domino blanc ? Je retournai dans les salons ; mais j’eus beau vouloir me remettre au diapason, cette femme m’avait pris du même coup le cœur et l’esprit.
Plus d’une fois dans ma vie j’avais passé par là : je compris que j’étais sérieusement retombé dans la gueule du loup.
Morny me voyant seul vint à moi. « Eh bien ! Et la femme aux violettes. – Envolée ! – Vous savez que je ne sais pas qui. – Et moi donc. – Alors c’est un roman. – J’espère que ce ne sera pas une histoire. – Vous me conterez cela. »
C’était le plus beau moment de la fête. On se jetait éperdument dans toutes les belles folies de la jeunesse amoureuse et de la gaieté insouciante.
Aussi ce bal masqué est une page de l’histoire intime du temps.
On demanda au duc de Morny si l’empereur était de la fête. « Je crois bien, dit-il, l’empereur, la cour et les ministres. Il n’y manque guère que le gouvernement, car l’empereur est déguisé en socialiste, l’impératrice en Marie-Antoinette, le prince Napoléon en sans-culotte et les ministres en orléanistes. Vous les reconnaîtrez bien vite. »
Morny était la sentinelle avancée de la société française ; il n’avait peur d’être surpris ni par les barbares du dehors ni par les barbares du dedans ; il ne les défiait pas, mais il les bravait, le sourire sur les lèvres et l’éclair dans les yeux. Aussi Paris l’avait reconnu pour son maître, comme la France avait reconnu le nom de Napoléon pour souverain. Je ne parle pas des hommes qui se croyaient humiliés parce qu’ils n’étaient plus en République. Je crois que s’il y avait eu une scission sérieuse entre le président du Corps législatif et l’empereur des Français, la situation fût devenue périlleuse pour Napoléon III, car Paris voyait le chef de l’État trop embrumé dans les rêveries socialistes. On aimait donc Morny, comme on aime l’esprit armant la raison. Les mondains étaient pour lui parce qu’il était gentleman ; les mondaines parce qu’il était gentilhomme ; les bourgeois et les bourgeoises, parce qu’ils dormaient sous son égide ; le peuple lui-même l’aimait pour ses crâneries.
Il y avait bien quelques nuages ; on l’accusait d’aimer l’argent et d’en prendre dans les coffres de l’État comme si on pouvait prendre de l’argent dans les coffres de l’État ! On l’accusait aussi d’avoir envoyé nos soldats se battre au Mexique pour sauver une de ses créances, parce qu’on ne comprenait pas l’idée de l’Empereur qui voulait le triomphe des races latines, pour tenir en échec toutes les puissances du Nord qui ne combattront jamais avec nous.
On était donc en toute quiétude chez Morny. Aussi les jours de fête on s’en donnait à cœur joie. Ne croyez pas que tous les convives fussent des bonapartistes. Morny aimait le talent et le savoir-vivre dans tous les partis. On rencontrait chez lui en toute liberté de causerie des légitimistes, des républicains et des orléanistes. Il était trop Français pour ne pas saluer toutes les opinions ; il disait lui-même : « Eh ! mon Dieu, qui donc d’entre nous n’a été quelque peu légitimiste, républicain et orléaniste avant d’être napoléonien ! » Il disait encore : « La France aime trop le spectacle pour qu’on ne lui change pas l’affiche quatre fois par siècle. » On est pour tous les gouvernements nouveaux, à la condition qu’ils ne vieillissent pas.
On aimait peut-être un peu trop la musique d’Offenbach, les opéras d’Hervé, et les décamérons de Winteralter, mais on aimait aussi beaucoup les comédies des deux Dumas, d’Alfred de Musset, de Barrière, d’Émile Augier, de Jules Sandeau, d’Octave Feuillet, les opéras de Gounod, les tableaux de Ingres et de Delacroix qui vivaient encore, de Baudry, de Decamps, de Millet, de Meissonier, de Cabanel, de Diaz, de Gérôme. On lisait beaucoup Lamartine, Hugo et Sand. En un mot, les chandelles n’étaient pas éteintes à la rampe du théâtre du monde. Ceux qui aiment les nuées n’étaient pas contents, mais ceux qui aiment la lumière ne demandaient pas encore que l’heure des tempêtes sonnât aux Tuileries. Paris s’amusait donc par les belles passions de l’esprit, tout en se jetant à l’aventure dans les belles passions du cœur.
C’était avant l’ère des petits crevés ; il y avait toute une génération d’hommes bien trempés, qui en montant l’escalier des Tuileries pour les Lundis de l’impératrice, ne s’offensaient pas – non plus que les femmes – de la belle architecture des Cent-Gardes.
Je reviens à mon histoire. Le domino avait emporté ma gaieté. Dans mon désespoir je soupai une seconde fois. J’étais effrayé de mon affolement soudain. Quand je fus sur le quai d’Orsay, je respirai tout autour de moi comme pour retrouver les enivrantes senteurs que j’avais humées sur le cou de l’étrange et adorable créature.
Ses lettres ne se firent pas longtemps attendre : la première m’arriva le matin, à mon réveil. Ce fut une vraie joie, car ce n’était pas l’écriture ni la signature de Mlle Élisa : c’était la grande écriture, déjà à la mode, des femmes de Louis XIV, écriture héraldique et fière qui dispense les femmes de faire des phrases, parce que la page est tout de suite remplie. Mais voici ce billet :
Je me couche et je vous écris. Le croirez-vous ? c’est mon cœur qui ne veut pas s’endormir sans vous avoir dit un mot ; ce mot, vous le savez déjà : « Je vous aime ! » Que cette lettre s’en aille vous chanter cette chanson comme l’oiseau du matin. Si la chanson ne vous plaît pas, ne la chantez pas : tout sera dit et tout sera fini.
LIA.
P.S. Si vous ne m’avez pas oubliée, pensez bien vite à vos Confessions. N’ayez peur, je n’attends pas de vous un livre comme la Morale en actions, vous pouvez me confesser vos crimes, car ce n’est pas par ses vertus qu’un homme se fait aimer.
Par exemple, ne me cachez rien si vous voulez être absous. Je ne vous demande pas la litanie de vos sept cents femmes, enfant perdu de Salomon ! ces créatures m’importent peu, mais je veux au moins une page sur celles que vous avez aimées et qui ont eu la bêtise de vous aimer : n’en oubliez pas une seule ; d’ailleurs il n’y en a pas tant de celles-là !
Je répondis sans perdre cinq minutes :
Oui, je chante votre chanson tout à la fois joyeuse et triste, un amour nouveau c’est un renouveau, c’est le mois d’avril avec ses coups de soleil et ses ondées. Comme vous allez vous moquer de moi, mais j’ai du carreau dans mon jeu.
Pourquoi me reparler de mes Confessions ? On n’écrit pas un livre comme on boit une coupe de vin de Champagne ! Vous êtes une Salomé et vous voulez que je vous serve mon cœur sur un plat d’argent.
Pourquoi ce pseudonyme de Lia ? Je sens que ce n’est pas votre nom ; or cela trouble mon cœur, car j’ai déjà aimé une Lia ; il est vrai que ce n’était pas non plus son vrai nom ; c’est égal, je ne veux pas vous confondre avec elle : il serait si simple de signer tout simplement : La Charmeuse.
Le lendemain, seconde lettre :
Oui, La Charmeuse, oui, Salomé, mais je vous avertis qu’il me faut ce livre à tout prix, – à tout prix, entendez-vous le français ? Vous ne me reverrez qu’à la fin du premier volume. Si vous avez peur que je ne vous aime pas longtemps, dépêchez-vous : une page blanche de ma vie ne vaut-elle pas deux cents de vos pages noires ?
LA CHARMEUSE.
Cette Charmeuse m’envoyait l’enfer dans ses lettres ; je n’étais qu’à moitié affolé à la fête de Morny, je l’étais tout à fait maintenant. J’avais commencé un roman : Mademoiselle Cléopâtre, je jetai le roman de côté, parce que pour moi le vrai roman n’était pas là : l’homme de lettres s’était abîmé sous l’homme. Tout mon esprit était dans mon cœur ; j’avais beau me railler et m’appeler triple bête, j’étais pris et emprisonné dans le château des féeries amères.
C’est en vain que je voyais la folie d’écrire un tel livre sans rimes ni raison ; peu à peu mon cœur me prouva que ce livre n’était pas plus bête qu’un autre. Je pensais à saint Augustin et à Jean-Jacques qui ne connaissaient pas mieux que moi le cœur humain, à tous les faiseurs de Mémoires qui ne savaient pas mieux que moi les choses de leur temps. « Après tout, me dis-je, ce livre ne me coûtera pas plus à faire qu’un autre livre. Je vais l’imprimer à un seul exemplaire qui me donnera l’air d’un amoureux magnifique. L’amour est généreux de sa nature, mais au fond cette prodigalité ne sera peut-être pas perdue, si la dame me fait faillite, car qui dit un exemplaire dit deux exemplaires : un pour elle, un pour moi ; mon exemplaire me servira d’épreuve pour publier un jour le livre, si cela m’amuse. » Tant il est vrai que dans toutes les actions des hommes il y a presque toujours l’addition et la soustraction. Je commençai donc ce livre en me promettant de le faire très petit ; mais le temps m’a manqué. J’y allai à toute plume, voulant donner chaque jour vingt-cinq pages à l’imprimeur.
Alexandre Dumas, au Théâtre-Français, m’avait fait deux comédies de cinq actes en dix jours : je jurai de ne pas être plus longtemps à écrire mes Souvenirs, d’autant plus que ce n’était pas si difficile. Il y a la même différence entre un simple conteur et un auteur dramatique qu’entre un joueur de dames et un joueur d’échecs.
Je connaissais un calligraphe très rapide qui écrivait comme Lamartine. Il me détourna de l’idée de donner mes pages à un imprimeur. Dès que j’avais écrit un chapitre, il l’écrivait lui-même sur parchemin végétal avec les titres et les grandes lettres en rouge et en bleu, comme les anciens manuscrits.
Voici ce que je griffonnai à la Charmeuse en lui envoyant le premier cahier, à peine deux cents pages :
En vérité, madame, je ne sais si j’irai plus loin. À quoi bon ?
Quand je suis amoureux, – par malheur je le suis encore, – je n’ai garde de poser un point d’interrogation, car j’aime l’inconnu, – aujourd’hui c’est l’inconnue. – Si vous vous confessiez à moi, je prendrais mon chapeau. – Si vous vous avisiez de m’ouvrir votre cœur, je le refermerais tout de suite à triples verrous. Adorable vous êtes si je ne sais rien, mais vous n’êtes que la première venue si je sais tout. – Oui, la première venue, tramant les passions qui s’éteignent comme une procession de fantômes. Il y a là de la fosse commune.
Si je ne sais rien, si vous avez le sourire pénétrant qui masque les larmes séchées, je puis baiser vos yeux et vos lèvres ; mais si les battements de votre cœur me disent vos amours défunts, je vous rejette avec horreur sur le lit de vos chutes sans vouloir y respirer un instant. La volupté elle-même a ses fiertés.
Donc vous me faites jouer un rôle absurde. Pourquoi voulez-vous que j’évoque toutes ces ombres attristées qui ont été mes passions, mes orgueils, mes amitiés ? Dites-moi d’en finir et venez vaillamment vous jeter dans mes bras.
À cette lettre-là, la dame répondit :
Non, monsieur, je vais lire le livre, je l’ai déjà entrelu avec joie. Continuez donc si vous m’aimez : c’est un sacrifice que j’impose à votre cœur. Qui vous dit que ce n’est pas moi qui souffre de l’abîme qui nous sépare, mais les mauvaises passions aiment les larmes !
Jusque-là j’avais eu l’esprit de ne me prendre qu’à des femmes prenables. Cette fois c’était l’inaccessible, la vision, l’insaisissable ; j’ouvris les bras pour les refermer sur mes colères.
En vain, comme l’alchimiste, je jetais mon cœur au creuset pour me prouver qu’il n’y avait point d’or. Mais l’analyse qui tue tant de passions ne pouvait tuer la mienne ; j’avais effleuré des flammes de mes lèvres le cou et les bras de cette femme ; j’avais mordu ses cheveux en révolte ; j’avais senti battre son cœur ; j’avais respiré tous les parfums enivrants des pêches mûres sur l’espalier ; elle s’était presque donnée dans cette fête où les âmes jetaient des flambées : Je mourais de ne plus la voir, – de ne l’avoir pas vue !
J’étais bien résolu à ne pas continuer mes Confessions :
Je n’irai pas plus loin, ma belle amie, vous savez que je dicte et que je n’écris pas. J’ai horreur de l’encre et de la plume. Si vous voulez la suite au prochain numéro, venez bien vite, je vous promets de vous dicter le second volume en quelques jours qui seront les plus beaux jours de ma vie, car je vivrai du passé et du présent.
Tout en écrivant ces pages du passé, tantôt sous le rayonnement, tantôt dans les demi-teintes, tantôt dans la nuit où les fantômes aimés de ma jeunesse me reprenaient le cœur et m’enlevaient par instants aux charmeries de la Charmeuse, je lui écrivais tous les jours un billet de quatre lignes, croyant qu’au lieu de répondre par quatre lignes elle viendrait elle-même me dire : « Finissons cette comédie ! » Mais il était écrit là-haut que la plume jouerait un grand rôle dans cette étrange passion. J’avais pourtant juré depuis bien longtemps que je n’écrirais plus de lettres. Quand on n’est pas amoureux, on trouve qu’il n’y a rien de plus naïf que les romans par lettres, on n’a pas assez de commisération pour ces pauvres diables des deux sexes qui se jettent à la tête des phrases à dormir debout ; mais dès qu’on est repris à cette ivresse adorable jusque dans ses tourbillonnements, on prend sa harpe ou sa lyre comme Sapho.
Cela, toutefois, ne m’empêchait ni de boire ni de manger, ni de continuer ma vie à la diable, car dans ce temps-là je n’étais pas un saint ; mais j’avais beau faire, mon cœur était toujours à la Charmeuse. Je courais tous les mondes les plus mauvais et les meilleurs, – les extrêmes se touchent, – pour interroger çà et là, mais très discrètement, ceux ou celles qui pouvaient me mettre sur la voie de ma mystérieuse adorée. Rien, rien, rien. Philippe de Saint-Albin, un curieux bien renseigné parce qu’il se renseignait par ses yeux et par ses oreilles, parce qu’il aimait toutes les femmes platoniquement, me dit un jour : « Je la connais. » Ce fut tout ce qu’il me dit, je faillis le tuer. Je lui dis des injures jusqu’à l’appeler Pièce de cent sous. Car il était petit-fils de Louis-Philippe et il ressemblait à une pièce de cent sous. Rien ne put l’émouvoir, il me répondait avec sa placidité : « J’ai du bon tabac dans mes tabatières. » Je ne sais pas si son tabac était bon, mais tout le monde sait qu’il avait les plus belles tabatières du dix-huitième siècle dans son cabinet de curiosités.
Je voyais souvent M. de Morny qui s’intéressait de loin à mon aventure, mais qui, en fin de compte, ne connaissait pas la dame, quoiqu’il eût toujours l’air de la connaître. Il riait sous sa moustache et me disait : « Tant pis pour vous ! Quand vous étiez directeur du Théâtre-Français, vous nous promettiez longtemps d’avance une première représentation, vous pouvez bien attendre vous-même la première représentation de votre comédie. » Je lui dis un matin : « Nommez-moi vingt femmes, je la devinerai. – Non, je ne veux pas, après tout, que cette comédie devienne un drame. » Il se renferma stoïquement dans cet habit boutonné.
J’étais d’autant plus furieux que je m’accusais de manquer de malice. Paris est grand, mais le « Tout Paris » n’est qu’un salon où tout le monde se connaît : comment ne pas mettre plus vite la main sur le secret ? Roqueplan me disait : « Tu es amoureux d’un éventail. »
Mais après les colères de mes impatiences, je savourai ma passion en disant qu’il ne fallait pas imiter les enfants qui tuent les rossignols pour savoir ce qui les fait chanter.
J’étais pourtant bien décidé, un jour, à ne pas aller plus loin. J’écrivis à la Charmeuse :
Madame, décidément je ne peux plus jouer les rôles de Werther, c’est trop vous aimer dans le bleu, je suis descendu depuis trop longtemps de ces pays-là. J’y suis remonté pour vous parce que vous m’avez ensorcelé. Mais la plume m’échappe des mains, je ne finirai pas le second volume, le livre sera coupé en deux comme mon amour. Adieu donc, je donne un corps à mon âme pour vous embrasser jusqu’à l’étreinte.
C’est tout et ce n’est rien ! Bonsoir ! Célimène.
La réponse me vint quelques heures après :
Monsieur et cher impatient, ne dirait-on pas que je vous condamne au supplice de Pétrarque ! Il a attendu vingt ans, – pour rien. – Il n’y a pas si longtemps que vous attendez, – pour quelque chose.
Et encore, qui vous dit que ce n’est pas moi qui attends ? Votre ami Sainte-Beuve a écrit qu’il fallait un sacrifice à l’amour. Le sacrifice ! ce n’est pas vous qui comprenez ce mot, car je sais comment vous vivez le soir ! – les petites dames vous font oublier les grandes dames. – Je vous ai vu hier, au Bois : vous n’aviez pas l’air de M. Werther : des œillades à toutes les passantes, hormis à moi. J’avais loué un fiacre tout exprès pour n’être pas regardée. Et pourtant je cherchais vos yeux. Il ne faut donc pas croire au langage des yeux.
CELLE QUI FUT LA CHARMEUSE
Je ne répliquai pas à cette lettre. « Tant pis, dis-je, qu’elle aille se promener au Bois en fiacre ou en carrosse, je ne veux plus jouer mon jeu, les cartes me sont mauvaises, je brûle les cartes. »
Le lendemain, nouvelle lettre de la dame :
C’est vrai que j’ai un avantage sur vous, puisque je vous connais et que vous ne me connaissez pas ; puisque je vous vois tous les jours et que vous ne me voyez jamais, c’est peut-être pour cela que je n’ai pas vos impatiences d’enfant gâté.
Vous vous figurez, monsieur mon amoureux, que vous êtes au bout de vos peines ; mais on ne connaît jamais l’amour, même quand on en parle. Vous mettez pourtant bien la main sur le cœur… au bal masqué…
Je viens de lire un roman de vous qui m’a prise : L’histoire d’une étrangère bien née qui va échouer dans une maison infâme avec la vertu de Lucrèce. C’est beau, parce que c’est simple. Voilà la vengeance comme je la comprends : Se frapper mortellement pour jeter la mort dans le cœur d’un traître ! Luciana Mariani est mon héroïne ; je suis contente de ce livre si sérieux dans la passion ; vous avez un défaut agaçant, c’est de rire même quand vous voulez pleurer : là, au moins, vous ne riez pas. Bonsoir, ma lampe s’éteint !
Quoique je fusse fort agréablement chatouillé dans cette lettre comme faiseur de romans, je ne répondis pas davantage, résolu de jouer un autre rôle : Mais deux jours après :
Vous vous imaginez, monsieur l’esprit-fort, que je ne braverai pas votre silence ; je veux vous prouver que je vaux mieux que vous, puisque je brise mes fiertés en révolte. Hier encore je vous ai vu, je ne vous dirai pas où. Vous avez couru le monde jusqu’à aller dans trois soirées. Cherchez bien, vous ne trouverez pas. Et pourtant mon cœur m’a dit que vous pensiez à moi quand je vous ai regardé.
Ce billet fut pour moi un casse-tête chinois ; ma mémoire me représentait beaucoup de femmes vues la veille, mais chacune qui passait sous mon souvenir semblait me dire : « Ce n’est pas moi. »
Tout en ne voulant pas continuer mon livre, je me laissai reprendre. Je m’étais remis à Mademoiselle Cléopâtre, mais j’avais peur de brouiller les figures, d’autant plus que Mademoiselle Cléopâtre a déjà deux figures. J’étais trop dans le monde réel pour créer la vie dans le monde de l’imagination : je continuai à portraiturer mes contemporains et mes contemporaines.
Le second cahier fut mis le vendredi suivant à la poste, relié comme le premier dans une couverture en parchemin, papier de soie entre chaque page, pour que l’écriture, toute fraîche encore, ne donnât pas de contre-épreuve.
Elle envoyait plusieurs fois par jour à la poste ; aussi le volume n’y fit pas une longue station. Le même jour elle me crayonnait ceci :
Hosanna ! vous ne savez pas comme je suis heureuse. J’étais morte ce matin, déjà je me sens forte comme un charme. J’ai embrassé votre livre des lèvres, je le bride des yeux. Je suis touchée au vif du cœur. Devant Dieu, je vous jure que dès que je pourrai mettre le pied dehors, ce sera pour aller à vous ; mais jurez-moi devant Dieu que vous ne me briserez pas sur votre cœur, car cette fois j’en mourrais.
O noble bête ! chercheur de tout, trouveur de rien ; vous n’avez donc pas deviné ? Si je vous ai demandé votre histoire, mon bel ami, ce n’était pas pour savoir comment vous aviez aimé Manon ou Ninon, Nini yeux noirs ou Nini yeux bleus, cette comédienne ou cette princesse. Qu’est-ce que cela me fait ! Ce que je cherchais dans vos Confessions, ô aveugle que vous êtes, c’était moi, moi-même, rien que moi, entendez-vous ? Enfin j’ai dévoré les pages qui content notre petit roman :
Ah ! grand oublieux, vous ne m’avez pas reconnue, ni à mes cheveux ni à ma main, ni à mon pied ! Maintenant, je ne veux plus jouer à cache-cache. Vous me verrez peut-être arriver un de ces soirs vers dix heures. Je vous ferai moi-même une tasse de thé comme Mme d’Entraygues, votre ci-devant amie.
Une tasse de thé ! Et puis ce sera tout.
Cette lettre fut un petit coup de théâtre : elle brisait mon rêve, elle brisait les vitres, je reprenais ma liberté. Je m’envolai par la fenêtre de cette prison qui s’appelle l’amour.
La Charmeuse vint le soir – mais ce n’était plus la charmeuse !
J’avais trouvé – et je n’aimais plus !
Je l’admirai dans sa beauté fuyante. Et pourtant celle que j’avais tant aimée sans masque, celle que j’avais tant aimée sous le masque… je ne l’aimais plus…
C’est que ce qui est brisé ne se renoue pas. C’est que j’avais voulu lire un livre nouveau, et je ne trouvais plus à feuilleter qu’un livre ancien. On ne relit que les chefs-d’œuvre.
Nous nous mîmes tous les deux sur un canapé où nous avions conté nos meilleurs contes.
On s’imagina que le temps n’avait pas marché, on parla même du lendemain, mais sans y croire.
Elle me dit tout à coup : « Vous ne m’embrassez pas pour me dire adieu ? » Je me penchai vers elle et je l’embrassai comme une sœur. C’est que ce n’était plus une femme.
Je ne l’ai point revue.
Elle avait parlé de l’oubli comme d’un doux et chaste linceul : La mort l’a-t-elle prise ? Elle est déjà bien oubliée aujourd’hui, car son monde a passé comme un orage, orage sans arc-en-ciel !
Si Blanche vit, je la crois plus morte que dans un linceul. Le devoir est quelquefois un tombeau.
Si le domino blanc tout épanoui de violettes n’est plus qu’un suaire : Ci-gît qui a aimé.
Les pages amoureuses que j’ai écrites pour Blanche sans avoir deviné sa fantaisie, on les retrouvera éparses dans ces quatre volumes.
Naturellement en écrivant pour elle, je ne m’étais mis en scène que dans les aventures de sentiment ou de passion.
À quoi bon faire pénétrer la Charmeuse dans tous les détours du sérail de la bohême dorée et du château ruiné du romantisme ? Que lui importaient les révélations politiques ? Que lui importaient à elle, qui n’avait pas la curiosité des écoles, les batailles littéraires de toute la période radieuse ! Je n’écrivais alors que pour une femme, j’écris aujourd’hui pour tout le monde.
Comme le Molière de Geffroy voyant sur le grand escalier de Versailles s’agiter avec leurs passions vivantes tous les personnages de sa comédie, il me faut, moi qui ai vu la comédie de mon temps, représenter aussi tous les personnages qui ont joué leur rôle sur la scène du monde, rois ou poètes, hommes d’État ou artistes, femmes du monde ou femmes de théâtre, grandes dames ou demi-mondaines.
Les historiens politiques, toujours passionnés, ont violé la vérité dans toutes leurs pages, même quand ils ont parlé de l’histoire intime. Je suis au-dessus de toutes les politiques. On trouvera donc aussi les figures et les mœurs du temps peintes d’un pinceau moins amer ou railleur que sympathique par un homme qui a bien vu ses contemporains, – et ses contemporaines.


J’ai frappé les trois coups à la première page ; mais j’ai encore quelques mots à dire avant ma confession.
La vie est une comédie que Dieu se donne, mais il nous permet d’être au parterre. C’est un beau spectacle que je n’ai pas assez admiré. Mais c’est fini : de nouveaux venus me demandent avec impatience ma stalle ou mon rôle, car j’ai été spectateur et acteur dans ce drame inouï.
J’arrive sur l’âpre montagne aux neiges implacables ; je me retourne pour voir, dans le chemin parcouru, les images déjà pâlissantes des choses de mon temps ; je puis juger les hommes qui étaient à l’œuvre sous mes yeux et qui, presque tous, se croisent les bras dans le tombeau. Ils sont si loin de leur vie qu’ils ne me demandent pas même un souvenir, mais à chacun selon son œuvre : L’histoire moissonne ses gerbes et ses fleurs jusque dans la mort, jusque dans l’oubli.
De tous les livres, le livre de la vie est le plus difficile à faire ; aussi beaucoup d’hommes veulent-ils garder l’anonyme.
Par malheur pour ceux que le démon des arts a entraînés, il n’y a pas à se cacher. La renommée même la plus discrète oblige les orgueilleux à passer au confessionnal de l’opinion. Et ils le font volontiers pour que leurs ennemis les calomnient un peu moins.
Pour moi, que m’importent mes ennemis, puisque pas un seul ne serait digne d’être mon ami !
Je signe mes livres et mes actions sans forfanterie, mais sans me dérober. Par exemple, ce livre de ma vie, j’aurais pu le publier sous le masque de la mort, comme tous les mémoires d’outre-tombe, mais j’ai toujours vécu à visage découvert. J’aime mieux être debout pour répondre à qui voudrait me parler. Je veux bien qu’on trouve ce dernier livre mauvais, mais j’ai mes témoins aussi vivants que moi pour dire que c’est ici un livre de bonne foi. Non seulement j’ai parlé des morts avec la sympathie de l’histoire pour toutes les grandes figures, mais je ne les ai jamais mis en scène sans savoir qu’un des personnages qui ont joué avec eux un acte important de la vie, est encore de ce monde pour affirmer la probité historique.
On reconnaîtra au premier alinéa un curieux qui n’écrit pas ; mais il y a tant de manières d’écrire que peut-être la plus mauvaise n’est pas celle de ceux qui ne savent pas écrire. J’ai traversé, comme tout le monde, le jardin des racines grecques et des fleurs latines. Je n’ai pas plus compris qu’un autre la Rhétorique d’Aristote, ni le Traité du sublime de Longin, ni l’Art poétique de Despréaux. Je crois fermement que c’est le tempérament qui fait l’écrivain. Si on sent fortement, on écrit avec une mâle éloquence ; si on n’a que des battements de cœur anémiques, on écrit avec de l’encre blanche. Si la pensée n’habite pas le front, on joue au mot, comme on joue aux cartes : le roi retourne quelquefois. Ce qui m’enhardit dans mon ignorance, c’est l’exemple de Saint-Simon, qui n’ayant peur de rien parce qu’il ne s’était pas enchaîné dans les règles, disait ce qu’il pensait sans souci de la grammaire, créant le mot, si le mot lui manquait, osant le barbarisme, si le barbarisme donnait du montant à sa pensée. Il y a certes de grands écrivains qui sont parfaits comme Racine dans la tragédie ; mais n’oublions pas, nous qui ne sommes que des infiniment petits, que le savant abbé d’Aubignac fit mathématiquement la plus mauvaise des tragédies d’après Aristote.
Je me risque donc, quoique déjà j’entende dire que j’aurais mieux fait, moi aussi, de mourir sans confessions.
Ma vie ne m’apparaît que comme une vision impersonnelle, aussi puis-je juger la comédie de mes passions comme la première comédie venue que je verrais jouer au Théâtre-Français, sans aucune des émotions d’un auteur qui sera applaudi ou sifflé. Il y a en nous plusieurs hommes qui se succèdent fraternellement, parce qu’ils sont de la même famille. Mais que de contrastes ! De même qu’après vingt-cinq ans d’absence vous ne reconnaissez pas un ami, de même vous avez toutes les peines du monde à reconnaître les diverses physionomies de votre âme. Conter sa jeunesse quand on traverse l’été de la Saint-Martin, c’est donc conter la jeunesse d’un autre. Et d’ailleurs ce livre qui renfermera le portrait ou le profil ou le crayon de tous mes contemporains d’un demi-siècle, aura sa raison d’être, parce qu’il sera moins encore les Mémoires d’Arsène Houssaye que les Mémoires des autres.
Saint Augustin a fait ses Confessions dans un sentiment d’humilité et de repentir ; Jean-Jacques Rousseau a écrit les siennes dans un esprit d’orgueil. L’auteur de la Nouvelle Héloïse s’est voulu montrer dans le bien et dans le mal pour accuser avec plus de relief et plus de couleur sa glorieuse personnalité. Si j’ose me mettre en scène à l’ombre de ces deux figures immortelles, moi qui ne dois vivre qu’un jour, c’est bien moins pour me peindre que pour faire le tableau des personnages, des physionomies, des curiosités de mon temps.
Le hasard des choses m’a jeté à travers tout. Soldat, comédien de rencontre, bûcheron, surnuméraire dans un moulin à vent, poète en action, romancier, historien, directeur du Théâtre-Français, inspecteur général des Beaux-Arts, architecte, créateur du pays de Beaujon, directeur de journaux, j’ai vu passer les plus belles passions et les plus belles vanités du siècle, dans tous les mondes, depuis le meilleur jusqu’au plus mauvais.
« Le moi est haïssable. » Ce qui n’a pas empêché Pascal de peindre les agitations de son âme. Et moi aussi j’ai horreur du moi. On ne m’a jamais surpris dans le monde à parler de mes livres ni de mes aventures. Si je me hasarde ici, c’est que je crois parler à moi-même. Ma conscience est au confessionnal et je lui dis mes péchés ou mes impertinences : qu’est-ce qu’un péché, sinon une impertinence ?
Il ne m’en coûte pas pour dire la vérité, même pour m’accuser devant le tribunal sévère de l’opinion, mais n’est-on pas toujours puni par où l’on pèche ? Avant que les juges ne condamnent on se condamne soi-même, – et on recommence. – Je suis né poète, c’est-à-dire rêveur, curieux, fragile, flottant toujours entre le bien et le mal – tombant plus d’une fois à gauche quand je veux tomber à droite, finissant par croire qu’il faut traverser le mal pour arriver au bien. Je suis né aussi quelque peu directeur de théâtre – du théâtre de la vie. J’aime le faste, le luxe, la mise en scène. Quand je donne à festoyer, je crois que c’est une première représentation ; mais dès qu’on se met à table ou dès que la fête commence, je ne suis plus qu’un simple convive et je m’amuse ou m’ennuie chez moi, comme si j’étais un invité : c’est peut-être pour cela que chez moi tout le monde est chez soi. Il m’est arrivé plus d’une fois, – on en riait, beaucoup, – de prendre mon chapeau quand chacun s’en allait, convaincu que je devais rentrer chez moi – ailleurs que chez moi.
Et alors je ne rentrais pas.