


EAN : 9782335050417
©Ligaran 2015
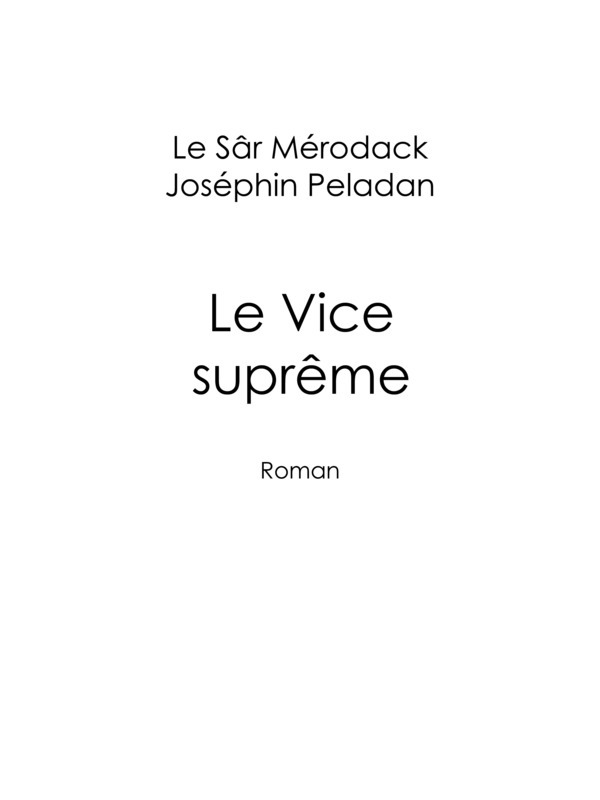
Parmi les romans dont nous sommes si impitoyablement criblés, à cette heure, en voici du moins un que je n’attendais pas et qui n’a pas le ton des autres ! En voici un qui nous enlève avec puissance à la vulgarité des romans actuels qui abaissent la notion même du Roman et qui, si cela continue, finiront par l’avilir… Le Roman, en effet, tel que l’aime et le veut l’imagination contemporaine et tel que le lui font les serviles du succès n’importe à quel prix, n’est guère plus maintenant que la recherche et la satisfaction d’une curiosité plus ou moins frivole ou plus ou moins corrompue. Pour la forme et pour l’art, de deux choses l’une : ou il s’effeuille misérablement en œuvres courtes, sans haleine et sans portée, auxquelles l’idéal manque autant que la moralité, ou il s’allonge, plus misérablement encore, en des aventures imbéciles. Ajoutez à cela dans les très rares où l’on distingue quelque talent, tous les morcellements et toutes les pulvérisations de l’analyse, car l’analyse est le mal intellectuel d’un siècle sans cohésion et sans unité, et dont les œuvres littéraires portent, même sans le savoir, la marque d’un matérialisme qui est toute sa philosophie… On le comprend, du reste. L’analyse, cette faculté de myope qui regarde de près et ne voit les choses que par les côtés personnels et imperceptibles, se trouve beaucoup plus exactement et naturellement en rapport avec la masse des esprits faibles dont la prétention est d’être fins, que la vigoureuse et large synthèse qui voit les ensembles d’un regard et les étreint quelquefois avec la poigne du génie. Il ne faut pas s’y tromper. Le temps n’est pas à la synthèse ! Présentement, les ramasseurs de microbes et les cardeurs de riens l’emporteraient en littérature sur les plus mâles créateurs, s’il y en avait ! Je sais bien qu’on ne peut pas supprimer absolument la Synthèse dans l’esprit humain sans tuer l’esprit humain lui-même, mais dans la vaste décomposition qui s’avance sur nous, on peut très bien prévoir le moment où l’analyse qui dissout tout, dans les livres comme dans les sociétés, dissoudra aussi le roman dont la synthèse serait la beauté ; le roman, c’est-à-dire la seule grande chose littéraire qui nous reste, l’épopée des sociétés qui croulent de civilisation et de vieillesse, et le dernier poème qui soit possible aux peuples exténués de poésie !
Eh bien ! c’est ce genre de roman dont si peu d’esprits sont capables dans l’amollissement et l’affadissement universels, c’est ce genre de Roman qui fit de Balzac le plus grand romancier de tous les temps et de tous les pays, qu’un jeune homme inconnu encore – du moins dans le roman – ose, après Balzac, aborder aujourd’hui ! Tête synthétique comme Balzac, M. Joséphin Péladan n’a pas été terrorisé par cet effrayant chef-d’œuvre, le sublime diptyque à pans coupés que Balzac appela « La Comédie humaine », et il a écrit le Vice suprême, qui n’est d’ailleurs qu’un coin de l’immense fresque qu’il va continuer de nous peindre.
Balzac, dans sa grande « Comédie humaine » – sur laquelle il mourut, hélas ! sans l’achever – avait donné l’éblouissante synthèse de la société de son temps, éblouissante encore. Mais après Balzac, quelques années de la plus foudroyante décadence pour la rapidité, ont élargi sa colossale synthèse, et c’est cette colossale synthèse élargie que M. Joséphin Péladan a entrepris de nous donner à son tour… Il a pris sur ses jeunes bras plus lourd que Balzac, et, disons-le, plus terrible. Ce n’est pas de la synthèse d’une société entre toutes qu’il s’agit dans son livre, comme dans la Comédie humaine, – mais de la synthèse de toute une race, – de la plus belle race qui ait jamais existé sur terre, – de la race latine qui se meurt.
Formidable sujet, car il est écrasant, mais magnifique, pour l’homme qui ne restera pas dessous !
M. Péladan y restera-t-il ?… Qui le sait ?… L’œuvre qu’il projette est si grande qu’elle pourrait déconcerter jusqu’à l’espérance de la sympathie… Son livre d’aujourd’hui, ce premier volume des Études passionnelles de décadence, qu’il nous promet, et qu’il appelle de ce nom, le Vice suprême, est déjà presque un gage donné à une gloire future par des facultés supérieures. Elles sont indéniables, ces facultés… J’en connaissais déjà quelques-unes. Ce débutant dans le Roman n’est pas un débutant dans les lettres. Avant de publier le Vice suprême, il avait publié une biographie de Marion Delorme, véritablement délicieuse ; mais c’est surtout comme critique d’art qu’il s’était dernièrement révélé. Il avait passé deux ans en Italie et il s’y était fait une éducation esthétique très forte, dont il a donné la mesure dans l’Artiste de l’an dernier. Il y écrivit un Salon de la compétence la plus profonde. Les qualités de ce Salon, scandaleusement belles et qui firent scandale, comme le fait toujours ce qui est beau dans ce monde de platitudes et de vulgarités où nous avons le bonheur de vivre, annonçaient un écrivain et un penseur très indépendant et très élevé ; mais on ne se doutait pas qu’elles cachaient un audacieux romancier, qui, probablement et dans l’ordre du Roman, va faire un scandale plus grand encore que dans l’ordre de la Critique.
Il y a, en effet, une triple raison pour que le scandale soit la destinée des livres de M. Joséphin Péladan. L’auteur du Vice suprême a en lui les trois choses les plus haïes du temps présent. Il a l’aristocratie, le catholicisme et l’originalité. En peignant la décadence de la race latine avec ce pinceau sombrement éclatant et cruellement impartial qui est le sien, M. Péladan a pris la société par en haut, parce que c’est par là, – par la cime, – qu’elle meurt ; parce que toutes les décadences commencent par la tête des nations et que les peuples, fussent-ils composés de tous les Spartacus révoltés, ne sont jamais, même après leur triomphe, que ses esclaves. Les démocrates qui vont lire le livre de M. Péladan ne lui pardonneront pas d’avoir choisi pour héroïne de son roman une princesse d’Este et d’avoir groupé toute la haute société de France et d’Italie autour de cette femme qui a tous les vices de sa race et qui, de plus, en a l’orgueil. Depuis que les goujats veulent devenir les maîtres du monde, ils veulent être aussi les maîtres des livres qu’on écrit et y tenir la première place. Ils veulent des flatteurs d’Assommoir… et ils ne comprendront jamais que l’intérêt d’un roman, fût-ce le Vice suprême, puisse s’attacher à des races faites pour commander, comme eux sont faits pour obéir.
D’un autre côté, le catholicisme de M. Péladan, du haut duquel il juge la société qu’il peint, et qui lui fait écrire à toute page de son livre, avec la rigueur de l’algèbre – que la race latine ne peut être que catholique ou n’être plus – ce catholicisme est depuis longtemps vaincu par l’impiété contemporaine qui le méprise et qui s’en moque. Enfin, plus que tout pour le naufrage de son roman, il a l’originalité du talent dans un monde qui en a l’horreur parce qu’elle blesse au plus profond de leur bassesse égalitaire tous les esprits qui ne l’ont pas.
Telles les raisons qui peuvent empêcher le succès immédiat du livre de M. Péladan ; mais que lui importe ! C’est un de ces artistes qui doivent beaucoup plus se préoccuper de la sincérité de leur œuvre que de leur destinée… Or, la sincérité de l’observation est ici, comme la force de la peinture. Le roman de M. Joséphin Péladan qui a pour visée d’être l’histoire des mœurs du temps, idéalisées dans leurs vices, n’en est pas moins de l’histoire, et l’idéal n’en cache pas la réalité. Le reproche qu’on pourrait faire au livre du Vice suprême, c’est son titre… Titre trop abstrait, mystérieux et luisant d’une fausse lueur. Il n’y a point de vice suprême. Il y a tous les vices qui, depuis le commencement du monde, pourrissent les nations, et avant même qu’elles aient disparu dans la mort, dansent la danse macabre de leur agonie… Ils sont tous « suprêmes » dans le sens de « définitifs » comme la dernière goutte d’une coupe pleine, qui va la faire déborder, mais il n’y en a pas un nouvellement découvert qui soit le souverain des autres et qui mérite ce nom de suprême, dans le sens d’une diabolique supériorité… Le cercle des Sept Péchés Capitaux tient l’âme de l’homme tout entière dans sa terrible emprise et Dieu même peut défier sa faible créature révoltée de fausser ce cercle infrangible par un péché de plus !
On ne rencontre donc pas dans ce roman du Vice suprême, qui semblait le promettre, un vice de plus que les vieux vices ; les vices connus, les vices éternels qui suffirent pour anéantir sous le feu du ciel Sodome et Gomorrhe et qui suffiraient bien encore pour que Dieu mît en morceaux sa mappemonde demain. Pauvres vices pour des blasés comme nous qui, semblables à l’empereur romain, en voudrions payer un de plus !… Mais que voulez-vous ? M. Joséphin Péladan a été bien obligé de se contenter de cette pauvreté, et sous son pinceau, on ne s’aperçoit jamais qu’elle en soit une… Je ne sache personne qui ait attaqué d’un pinceau plus ferme et plus résolu ces corruptions qui plaisent parfois à ceux qui les peigne ou qui épouvantent l’innocente pusillanimité de ceux qui craignent de les admirer… Peintre acharné de ressemblances, la panique morale ne prend jamais M. Péladan devant sa peinture, car il y a une panique morale moins odieuse, mais plus bête que l’hypocrisie. Il peint le vice bravement, comme s’il l’aimait et il ne le peint que pour le flétrir et pour le maudire. Il le peint sans rien lui ôter de ses fascinations, de ses ensorcellements, de ses envoûtements, de tout ce qui fait sa toute-puissance sur l’âme humaine, et il en fait comprendre le charme infernal avec la même passion d’artiste intense que si ce charme était céleste !
Mais le moraliste invincible et chrétien, est là toujours derrière le peintre et c’est lui qui éclaire le tableau… Puisque M. Joséphin Péladan avait voulu peindre une décadence, il devait être hardi avec les détails comme avec le sujet de son livre, et s’il eût reculé devant aucun d’eux, il eût affaibli la conception de son roman. Dans le flot de personnages qui y passent sous nos yeux, on ne trouve pas même les trois justes qu’il fallait pour sauver Sodome. On n’y compte qu’une seule innocence et une seule vertu, l’innocence d’une vierge violée, et la vertu d’un prêtre qui résiste à de démoniaques tentations. Tout le reste de ce monde, en chute, n’est que corrompus et corrupteurs, dépravés et pervers, mais sans les mesquineries de l’indécence. Ils sont par trop au-dessus d’elle ! Si un vice suprême, en tant que nouveau et spécial à la civilisation qui nous tue, était impossible, si l’auteur du livre a été obligé de se rabattre sur les vieux vices connus, de tous, du moins, il a choisi celui qui communique aux principales figures de son œuvre cette incontestable, mais affreuse grandeur qui reste à l’âme de l’homme, quand elle ose encore garder son orgueil, après avoir perdu sa fierté !
L’une de ces principales figures ou pour mieux parler la figure centrale de la fresque de M. Joséphin Péladan est comme je l’ai dit déjà une princesse d’Este, Malatesta par mariage, dont la beauté rappelle les plus beaux types de la Renaissance et le sang bleu roule le germe de tous les vices de cette époque funeste qui fut le Paganisme ressuscité. La princesse Léonora est, comme dit superbement Saint-Bonnet, toute l’addition de sa race et cette addition fait une colonne de hauteur à dépasser le cadre étroit du XIXe siècle et à le faire voler en éclats comme un plafond qu’on crève… Parmi les plus grandioses vicieux qui entourent la princesse, aucun ne l’égale. Douée de toutes les puissances corruptrices de la vie, la beauté, le génie, l’esprit, la richesse et la science, une éducation fée mais perverse a développé en elle le monstre futur, mais c’est elle qui l’a elle-même accompli. La brutalité d’un mari bestial lui avait donné, dès la première nuit de son mariage, le dégoût des voluptés charnelles, et d’une Messaline ou d’une Théodora qu’elle aurait pu être, elle se fit un autre genre de monstre… Elle fut le monstre métaphysique. L’orgueil et la volonté domptèrent ses sens et elle fut chaste. Chasteté homicide ! Don Juan femelle plus fort que Don Juan le mâle, qui avant bon appétit et qui dévorait ses conquêtes, elle repoussa les siennes avec mépris. Elle n’avait soif que des désirs qu’elle allumait et elle buvait ce feu, comme de l’eau, d’une lèvre altière… Bourreau de marbre, elle se dresse en ce roman du Vice suprême à côté de toutes les débauches et de toutes les luxures dans sa placidité cruelle jusqu’au moment où, comme le diamant qui coupe le diamant, elle rencontre un bourreau de marbre plus dur que son marbre et à l’heure juste marquée par le destin.
Car il y a un destin dans ce livre, mais ce destin est un homme… et c’est cet homme, plus que la Critique, qui va porter, je le crains bien, à l’œuvre majestueuse de M. Péladan son plus rude coup.
Cet homme, extraordinaire et oraculaire, qui voit l’avenir et le prédit sans se tromper jamais et qui prédit le sien, dans le roman, à la princesse d’Este, est plus qu’un de ces magiciens, comme on en trouve dans toute époque de décadence, depuis Apollonius de Tyane jusqu’à Cagliostro. Lui, c’est bien plus qu’un magicien… Il n’y a que ceux qui veulent déshonorer le magisme, cette science sacrée de la vieille Assyrie, qui appellent les mages des magiciens. Mérodack est plus qu’un magicien, c’est un mage. M. Joséphin Péladan a, pour les besoins dramatiques de son œuvre, composé le personnage, dans le Vice suprême, avec beaucoup d’art, de sérieux et même de bonne foi ; seulement, on est bien tenu de le lui dire, pour un catholique qu’il est, partout ailleurs, dans son livre, et qui fait du catholicisme la seule certitude de salut qui reste aux nations latines décrépites, c’est là une redoutable inconséquence, et même, c’est beaucoup plus… Magisme ou magie, quel que soit le nom qu’on préfère, sont des erreurs absolument contraires à l’enseignement de l’Église qui les a condamnées, à toutes les époques de son histoire, pour les raisons les plus profondes et l’Église est toujours prête à effacer sous son pied divin, depuis la grande tour de Babel, toutes les petites qu’on veut recommencer contre elle. Or, la magie est une de ces taupinières… Et, d’ailleurs, cette invention presque impie d’un homme, surnaturel par la Science, qui n’a plus les proportions humaines et dont l’action sur les évènements est irrésistible, n’est pas meilleure ni plus vraie en littérature qu’en théologie, car une telle création supprime cet intérêt que tout roman a pour but d’exciter.
Les hommes, en effet, ne s’intéressent qu’à ceux qui leur ressemblent, et c’est la raison qui les fait s’émouvoir et se passionner aux œuvres dans lesquelles ils ont affaire à des hommes comme eux. Les enfants seuls font exception parce qu’ils ont la naïveté et la foi de l’enfance. Ils croient à tout ce qu’on leur raconte, ogres ou fées, mais ce sont là des contes et non pas des romans ! L’imagination des hommes est plus difficile. Elle peut accepter ce qui l’étonne et ce qui lui est supérieur, mais elle ne veut pas de ce qui l’écrase – et on l’écrase, quand on veut la faire s’intéresser à des créatures hors nature, et qui ne sont plus en proportion avec elle. Alors, du coup, les sources de l’émotion et du pathétique sont taries… Balzac lui-même, l’omnipotent Balzac, qui croyait pouvoir tout oser, s’est heurté à cet écueil contre lequel M. Péladan pourrait se briser. Plusieurs fois, Balzac est sorti de la nature humaine. Dans Séraphitus-Séraphita où il a peint l’androgyne céleste de Swedenborg, dans sa Peau de chagrin dont la donnée est orientalement fabuleuse, et dans Ursule Mirouet où le magnétisme moderne joue un rôle qu’on n’y voudrait pas voir et que M. Péladan, dans son Vice suprême, a exagéré. Eh bien ! malgré l’imposant exemple de Balzac, c’est toujours une tentative téméraire et dangereuse, car elle permet tout, que d’introduire un merveilleux extrahumain dans la réalité des choses telles qu’elles existent ou telles que nous les connaissons. Avec un pareil procédé, l’art est trop facile. Et si les trois romans que j’ai cités saisissent l’imagination, pourtant, avec la force des chefs-d’œuvre, c’est que l’intérêt humain, diminué par l’impossibilité du sujet, se trouve dans la beauté transcendante des détails. Mais le procédé de composition n’en reste pas moins inférieur, quoique magnifiquement couvert par la supériorité du génie.
M. Joséphin Péladan aura-t-il ce génie qui fait tout oublier, même les fautes et les imperfections d’une œuvre ? On en jugera plus tard, car son livre d’aujourd’hui n’est que le commencement de la tâche qu’il s’est imposée. Seulement le conseil à lui donner, c’est de rester le plus qu’il pourra dans la réalité humaine. Il peut y être très puissant et son livre du Vice suprême nous en donne la preuve. À côté de ce personnage de Mérodack qui occupe trop de place dans son roman et en détermine trop l’action dramatique, il y a des figures d’une énergie de réalité qui montrent bien que le talent auquel on les doit n’a besoin, pour nous passionner, ni de l’hyperbole, ni de l’impossible. La grande figure du P. Alta, ce prêtre aimé de la princesse d’Este et qui résiste à ses ensorcellements avec l’auguste invulnérabilité de son sacerdoce ; celle du Prince royal de Courtenay, vivant avec la pensée de sa race déchue, qui est son remords dans le vice et qui lui inspire des actions sublimes, dans la guerre de 1870, sont bien autrement impressionnantes que la figure de l’homme des sciences occultes, dressée à côté d’elles et qui n’en efface pas la poésie. Les plus beaux chapitres du roman, par exemple le Krack et l’Argentier du roi en 1881, l’Orgie chez le prince de Courtenay, le P. Alta à Notre-Dame, et l’Émeute au théâtre ne nous remuent tant dans le livre de M. Péladan que parce qu’ils sont de ces faits que nous touchons encore du coude dans la décadence de ces derniers temps… Aussi, que le peintre de cette décadence, exprimée dans ce livre étonnant de vérité en beaucoup de ses parties, se souvienne qu’il n’a pas besoin pour la beauté et la gloire de son œuvre future d’une autre magie que la magie de son talent !
Jules BABBEY D’AUREVILLY.
Elle est seule.
Plein d’ombre alanguie et de silence berceur, clos à la lumière, clos au bruit, le boudoir circulaire a le recueillement rêveur, la somnolence douce, d’une chapelle italienne, aux heures de sieste ; buen retiro, semblable à l’étage d’une tour ronde, sans baie à ses murs elliptiques, où cloutée d’argent aux plis, la pourpre héraldique étale, en un satin violet plein de rouge, son deuil royal et sa magnificence triste.
Aux portières de velours, s’étouffent les voix du dehors et le plafond s’évide en un dôme, d’où le jour tombe, arrêté et affaibli par un vélarium bleu. Dans cette crypte mondaine dont la demi-obscurité rend, par places, le violet presque noir, de grands lys s’élancent autour d’une dormeuse où, écrasant délicatement les coussins, la princesse, couchée sur le dos et sans pensée, songe, avec l’abandon de corps et d’esprit, des heures esseulées.
Sur ses formes Parmesanes, le peignoir de soie violette a des froissements pareils à des moues de lèvres, à des caresses timides et effleureuses. Un bras que la retombée de la manche dénude, encouronne sa tête aux cheveux roux et lourds, l’autre pend avec des flexibilités de lianes, des souplesses de lierre et le dos des doigts pointus touche la peluche rase du tapis.
Par un bayement de l’étoffe la gorge apparaît, filigranée de l’azur des veines qui transparaissent. Les seins très séparés et placés haut sont aigus, les mules tombées, les pieds nus ont cet écartement de l’orteil que la bandelette du cothurne fait aux statues : et le sortir du bain amollit de matité douillette tout cet éphébisme à la Primatice. On dirait l’Anadyomène de ces primitifs qui, d’un pinceau encore mystique, s’essayent au paganisme renaissant, un Botticelli où la sainte déshabillée en nymphe, garde de la gaucherie dans la perversité d’une plastique de stupre ; une vierge folle de Dürer, née bous un ciel italien, et élégantisée par un mélange de cette maigreur florentine où il n’y a pas d’os et de cette chair lombarde où il n’y a pas de graisse.
La paupière mi-close sur une vision entrevue ; le regard perdu dans les horizons du rêve, la narine caressée par des senteurs subtiles, la bouche entrouverte comme pour un baiser – elle songe.
D’une robe couleur du temps, où d’un cœur qui la comprenne, d’infini ou de chiffons ? Dans quelle contrée du pays bleu, à la porte de quel paradis perdu, son désir bat-il de l’aile ? Sur la croupe de quelle chimère, prend-elle son envolée dans le rêve ?
Elle ne songe à rien, ni à personne, ni à elle-même.
Cette absence de toute pensée énamoure ses yeux, et entrouvre ses lèvres minces d’un sourire heureux.
Elle est toute à la volupté de cette heure d’instinctivité pure, où la pensée, ce balancier inquiet et toujours en mouvement de la vie, s’arrête ; où la perception du temps qui s’écoule, cesse, tandis que le corps seul vivant s’épanouit dans un indicible bien-être des membres. Ses nerfs au repos, elle ne perçoit que la sensation de sa chair fraîche, souple, dispose ; elle jouit de la félicité des bêtes, de ces vaches de Potter, accroupies dans l’herbe haute, repues et qui reflètent une paix paradisiaque dans leurs gros yeux clignés.
La princesse savoure délicieusement l’extase de la brute ; elle est heureuse comme un animal. Ses yeux en l’air regardent sans voir, le blason des d’Este, brodé sur le vélarium ; et l’aigle d’argent couronnée, becquée et membrée d’or la regarde aussi, et semble crisper et roidir son allure héraldique, au-dessus du lazzaronisme de boudoir qu’elle plafonne.
Les lys, les fleurs royales, les fleurs pures, élancent, sereins et augustes, leurs tiges droites des pieds de bronze, et leurs calices d’argent, pistillés d’or gouachent la tenture de pourpre, de tons chastes et nobles.
De ses mains glissé, un volume s’étale, les feuillets en éventail.
Les accalmies absolues de l’intelligence et de la mer, sont brèves dans les hautes têtes et sur les grandes plages : le flux de la pensée reconquiert vite le corps un moment quitté. Lointaines, les images et les vagues montent, agitées et successives, et reprennent à leur repos d’un moment, le sable déjà sec et brillant des grèves, et le cerveau déjà vide et sans souffrance.
La buée qui s’élevait de la baignoire gazant sa nudité, flotte encore dans sa tête, où se fait un lever paresseux et lent des idées.
Dans ce réveil de l’immortel de l’être, où les brumes d’une aube s’évaporent, domine, seule distincte, une phrase lue, qui revient, se répète obsédante, ainsi que ces hémistiches de vers oubliés qui poursuivent le lettré et ces airs entendus dans le lointain d’une vesprée que l’oreille, comme une boîte à musique, a gravés ; semblable, aussi, au répons sonore de litanies balbutiées dans une somnolence de dévote, ou bien au refrain d’une ballade dont on ne sait pas les strophes : « Albine s’abandonna, Serge la posséda, le parc applaudissait formidablement. »
À ce chapitre où toutes les sèves en délire éclatent en un cri de Rut, la princesse n’avait pas vibré. Cette bestiale ardeur n’éveillait rien dans ses sens délicats et raffinés de décadente. Elle avait tourné d’une main froide ces pages enfiévrées, mais la curiosité, chez elle analytique, avait été intéressée par ce tableau d’une sensation inconnue, d’un sentiment plus inconnu encore.
La femme qui lit un roman, essaye, par un instinct fatal sur son âme les passions du livre ; comme elle essayerait infailliblement, sur ses épaules, la mante de forme rare qu’elle trouverait sur un meuble, aimant à se retrouver dans l’héroïne. Exceptionnelle, la princesse eût souffert de se voir écrite ; et à lire Balzac, elle s’irritait pour les coins d’elle-même qu’elle y trouvait révélés.
Satisfaite, dans le soin de sa gloire, d’être indemne des ivresses animales de la sexualité ; confirmée dans la rareté de son caractère, elle reçoit une louange des disparates qu’elle se découvre et sa supériorité s’augmente de tout ce qui la dissemble des autres.
Dans son passé, aucune frondaison de Paradou ; dans son souvenir, aucune figure de Serge, aucune.
Tout à l’heure, l’eau tombait en perles de sa nudité, et elle se complaisait aux lys de sa peau que nul baiser ne rosit jamais ; maintenant une volupté qui a manqué aux Pharaons et aux Césars, lui vient de la continence de ses reins, de l’impavidité de son cœur : l’impériale satisfaction d’avoir fait toute sa volonté sur soi-même.
Elle n’est ni Sémiramis, ni Cléopâtre. Son nom illustre n’a sur elle que le prestige des ancêtres ; l’histoire ne saura pas si elle a en lieu : ce n’est qu’une grande dame de nos jours et du Faubourg Saint-Germain. Mais contemplant ses vertus solides comme des vices, ses vices calmes comme des vertus, elle se répète le Divi Herculis Filia, de Ferrare. Car elle est elle-même le monstre qu’elle a vaincu, et invincible aux Omphalus, son âme pleine de passion, son corps pétri de désirs, elle les a modelés, de son pouce long, à la spatule volontaire, d’après un idéal pervers d’Artémis moderne. Elle a vécu selon une idée : c’est sa gloire.
Le mouvement lyrique de sa superbe se calme ; elle évoque lentement l’un après l’autre, les détails dont la vie est faite.
En entrant dans l’hypogée du souvenir elle reçoit cette bouffée d’air froid et humide, qu’ont les lieux d’où la lumière et la vie se sont retirées ; et la fadeur poussiéreuse et moisie des choses vieilles, lui impose son vague attendrissement.
Confusément s’éveillent : l’écho des mouvements dont le cœur a battu, une impression posthume des sensations d’autrefois, une vie retrouvée des personnages et des actes dans leur cadre, et avec, au cerveau, le retour des pensées d’habitude, aux yeux l’humidité des larmes, jadis pleurées.
Elle contemple au lointain, du haut de son orgueil, le panorama du temps défunt, et faisant présent son passé ressuscite toute sa vie morte.
D’abord un Pannini ; ce que ses yeux d’enfant, étonnés de voir, ont premièrement aperçu ; et le décor de fond de sa vie enfermée d’enfant patricienne.
Du premier joujou au premier rêve, de la poupée à l’amant, cette poupée idéale ; tout le temps que ses courtes robes de baby ont mis à s’allonger, sur ses jambes de jeune fille : toujours cet horizon. Qu’elle ouvrit sa fenêtre au frais matin ; qu’elle y vînt par l’instinctivité de l’enfance qui aime à voir du ciel et se sent oiseau ; que, les nuits, sa puberté demandât leur nom aux attirantes étoiles, et à l’ombre du dehors un voile de mystère pour ses rougeurs sans cause de fleur, frôlée par les phalènes de l’adolescence : devant ses yeux souriants à l’avenir ignoré ou embrumés des larmes anticipées que la prévision des douleurs prochaines fait perler aux jeunes paupières ; dans la multiplicité et la succession de ses naissantes pensées : toujours la place de la Seigneurie.
Le premier livre lu en secret, premier fruit défendu, cueilli à l’arbre triste et séducteur de la science, s’entaille si profondément dans l’esprit, que ni les baisers de la passion ne l’effacent, ni le sel figé des larmes n’en couvre l’empreinte. De même, les spectacles quotidiens pendant des années, se gravent dans le souvenir, rendus ineffaçables par cette contemplation machinale des heures passives, où l’avidité de nos sentiments fait rendre le même son à tous les pizzicati de la vie, sans que le doigt violent de la douleur appuie sur aucune de ces cordes qui font résonner grave ou rieur, notre souci. Et cette faible épaisseur de notre libre arbitre, cette mince couche de cire où nous pouvons esquisser nos vouloirs, s’incise au hasard de l’existence ; l’eau-forte de l’habitude, c’est-à-dire l’éternel retour du banal et du coutumier, y mord ses lignes profondes et informes, pareilles à des ornières, au lieu de notre rêve !
Les fantômes de l’adolescence, revêtant les formes locales, lui apparurent encadrés par les cintres de la Logia où errants derrière les créneaux en queue d’aronde du Palais Vieux, avec une allure du passé, et quelque chose de la date du monument.
Pour l’enfant qu’appelle la liberté de la grande nature, la fenêtre, dans l’éducation civilisée, est une baie sur la vie, une baie sur l’idéal. Les cris, l’aller et le venir perpétuels lui donnent le spectacle de l’activité de mouvement qui est son souhait ; et l’œil de la rêverie, qui s’effraye aux tapisseries vieilles où s’agitent les êtres revenants d’autrefois, se plonge heureusement dans la nuit, sur laquelle se détachent, lumineuses dans l’évocation de la pensée, les illusions blanches.
En face du Palais Torelli, la forteresse d’Arnolfo di Lapo dressait sa masse tragique dans l’immobilité de Florence. La lune qui roulait dans le ciel comme un rhombe d’argent sur un tapis bleu, découpait par sa clarté mouvementée, la silhouette élancée du beffroi : et du noir où le Médicis équestre disparaissait, l’Hercule de l’Ammanato projetait une ombre colossale sur les dalles polies, tandis que le clapotis de l’eau scandait l’envolée des heures de son bruit flasque et rythmé.
Souvent, dans les insomnies où la sensation s’éveille, nu-jambes elle se levait, et sous l’arc géminé de sa fenêtre, archère agrandie, elle restait pendant des heures, immobilisée dans un appuiement las sur la pierre dont le grain dur rosissait ses coudes nus. Le sommeil du Palais, le calme de la nuit, le silence de la place enfiévraient son pouls, agitaient son esprit, rendant sa rêverie prolixe et son imagination osseuse.
Des haleines passaient sur elle, caressantes ; et l’hymne de l’idéal balbutiait dans son cœur, qui battait à des pensées de roman.