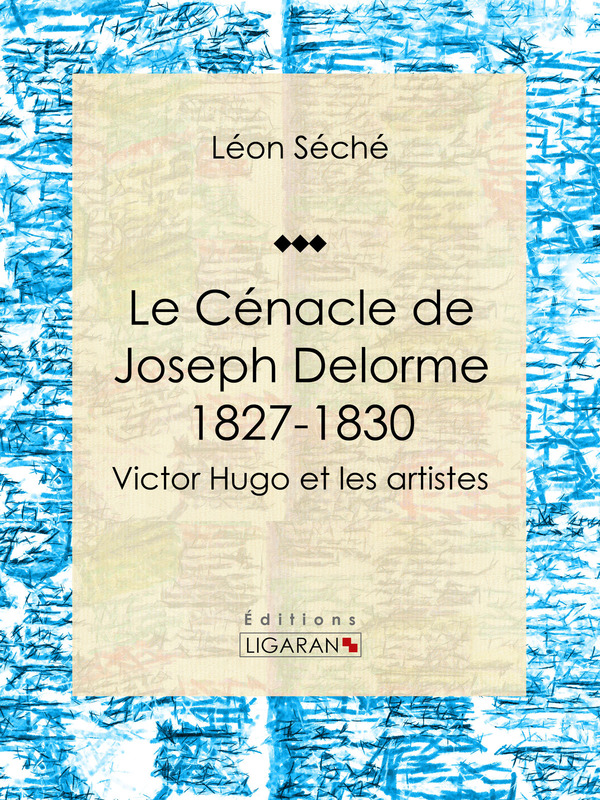
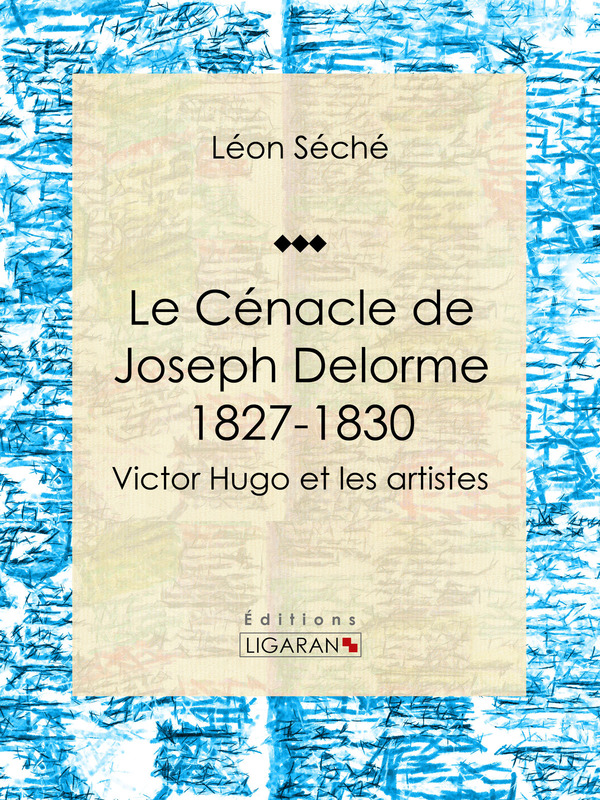
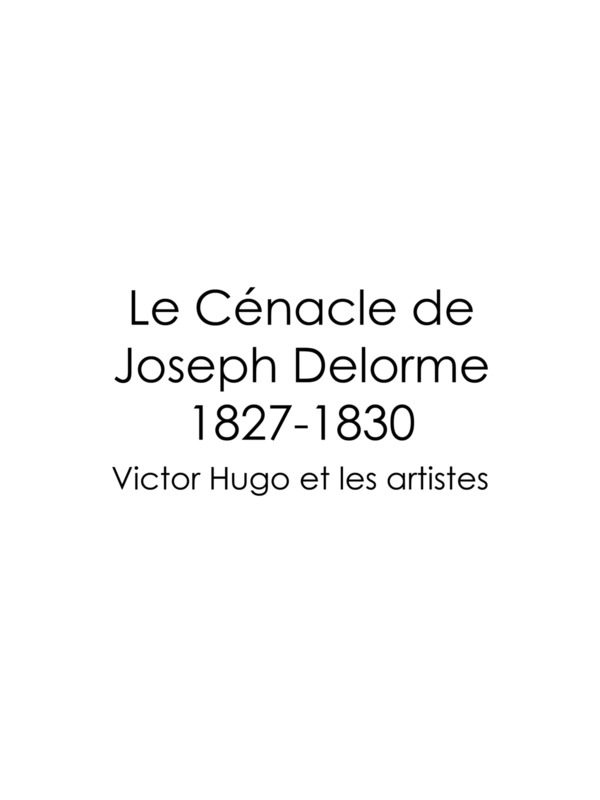
EAN : 9782335076561
©Ligaran 2015
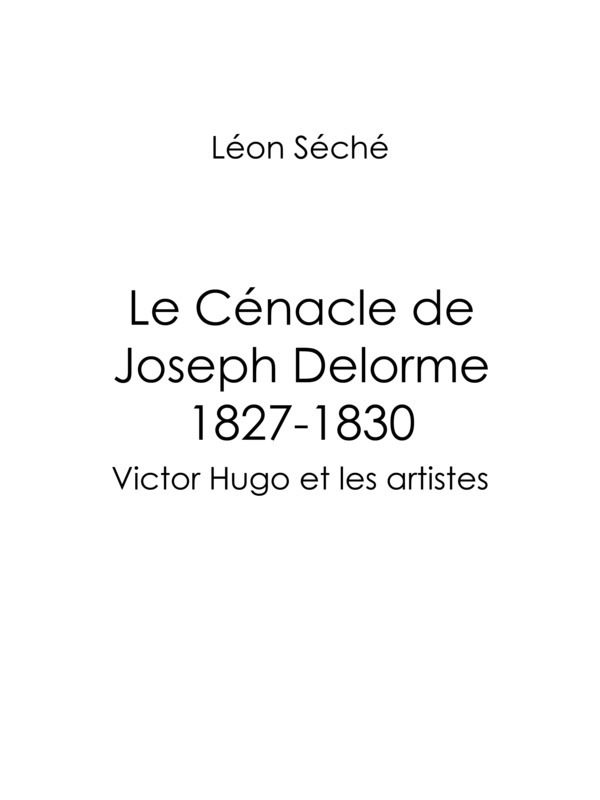
I.– Des lieux prédestinés. – La Bretagne-Angevine et le mouvement de la Renaissance. – Le roi René et la reine Anne. – Leurs cours d’amour. – Comme quoi l’art prima la poésie jusqu’au milieu du XVIe siècle. – Les maîtres-maçons de la Loire. – La chapelle de la Bourgonnière, en Anjou. – Le tombeau de François II à Nantes. – La Renaissance et Joachim du Bellay. – David d’Angers précurseur du mouvement romantique avec sa statue du Grand Condé. – L’influence de la Bretagne sur Victor Hugo et Lamartine. II.– Victor Pavie, son père, son enfance, ses premières études. – David d’Angers lui sert de correspondant à Paris. – Royaliste et républicain. – Souvenirs de la guerre de Vendée. – La statue funéraire de Bonchamps. – La première rencontre de Louis Pavie et de David d’Angers. – Deux inséparables. – L’amour du pays natal chez David et Victor Pavie. – L’influence de Lamartine sur Pavie. – Le Feuilleton littéraire des Affiches d’Angers. – Victor Pavie y rend compte des Odes et Ballades de Victor Hugo. – Point de départ de leur amitié. – Leurs premières lettres. – Le père de Victor Pavie présente Victor Hugo à David d’Angers. – La liaison du statuaire et du poète. – Ils vont ensemble assister au ferrement des galériens de Bicêtre. – L’atelier de David. – Toute l’École romantique pose devant lui. – Son désintéressement. – Son œuvre immense. – Le Musée David à Angers. III.– Les Français à Weimar. – Les premières traductions de Faust et les dessins de Delacroix. – La Violette et le Roi des Aulnes, de Gœthe. – La Lénore de Burger. – Le Globe publie, en 1827, deux lettres datées de Weimar. – Portrait de Gœthe à cette époque. – Description de son intérieur. – Ses idées sur la littérature française et sur Manzoni. – Ampère le visite et le documente sur la jeune École romantique. – Ce que Gœthe pensait de Victor Hugo. IV.– David et Pavie partent pour Weimar… Ils s’arrêtent à Strasbourg, Cologne, Mayence, Heidelberg et Carlsruhe. – Leur première entrevue avec Gœthe racontée par Victor Pavie. – David fait le buste du grand poète qui se déclare satisfait. – Le 80e anniversaire de sa naissance. – L’Allemagne en fête à cette occasion. – Les représentations de Faust. – Retour de David et de Pavie.
Je suis de l’avis de Lamartine : il y a vraiment des lieux prédestinés.
Au quinzième siècle, par exemple, le mouvement de la Renaissance partit de la province idéale que j’ai baptisée la Bretagne-Angevine, parce que la Loire qui la traverse, de Saumur à Nantes, a fait à la longue aux habitants de ses deux rives une âme à part où il entre bien plus de douceur angevine que d’âpreté et de mélancolie bretonne.
Le roi René fut le précurseur de ce grand renouveau, et la duchesse Anne sa protectrice avouée. Elle naissait quand René mourut. Sur leurs pas se levèrent une nuée d’artistes, peintres, enlumineurs, imagiers, architectes, musiciens et poètes, qui furent l’honneur de leurs cours d’amour, et, pendant cinquante ans, firent de ce val de Loire une sorte de jardin enchanté.
Dès lors, quoi d’étonnant que cette province ait été de leur temps en avance de plus d’un siècle sur le reste du royaume, et qu’aujourd’hui encore le voyageur qui la visite ait l’agrément de cueillir sur les lèvres mêmes des gens du peuple, sous forme de proverbes, de sentences et d’observations, une fleur de poésie et d’urbanité qui ne se trouve que là ?
Mais l’art prima et domina la poésie proprement dite jusqu’au milieu du seizième siècle. Pour un Georges Chastellain et un Jean Meschinot, il y eut dix Jean de l’Espine et dix Mathurin Rodier. Durant des années de liesse et de prospérité, les maîtres-maçons du comté nantais et du royaume d’Anjou émaillèrent les coteaux de la Loire de castels ouvragés, fleuris comme des reliquaires, et dont les mille détails étaient un charme pour les yeux. C’est Mathurin Rodier qui, sous le dernier duc de Bretagne, fut le maître d’œuvre de la cathédrale et du château de Nantes, comme ce fut Jean de l’Espine qui, sous le successeur du roi René, fut l’architecte de l’hôtel Pincé d’Angers et du corps de logis du château d’Ancenis. Et sans qu’aucun document nous ait encore révélé son nom, nous pouvons dire que ce fut également un architecte du pays qui fit les plans de la merveilleuse chapelle de la Bourgonnière, laquelle est à la Renaissance ce que la Sainte-Chapelle est à l’architecture gothique.
Vers le même temps, l’illustre imagier de la duchesse Anne, le breton Michel Colombe, donnait la mesure de son génie dans les quatre figures d’angle du tombeau de François II qui décore aujourd’hui la cathédrale de Nantes.
Il est donc tout naturel que, sur cette terre de délices, entre cette chapelle incomparable et ce royal tombeau, se soit épanouie un jour, dans un manoir du quinzième siècle, la fleur poétique de l’Olive et du sonnet du Petit Lyré. – Joachim du Bellay est, en effet, l’aboutissant de tout un art et de toute une civilisation ; il représente mieux qu’aucun autre, la Bretagne-Angevine de la Renaissance ; il a tous les traits caractéristiques de la race, depuis la douceur qui confine à la mollesse jusqu’à la mélancolie souriante qui se traduit par la raillerie à fleur de peau. Et je comprends que les poètes de la Restauration, s’inspirant de la Deffence et Illustration de la langue françoyse, aient pris comme mot d’ordre et de ralliement, à l’aube du Romantisme, le cri de guerre de Joachim :
Mais ce qui établit à mes yeux la prédestination de cette province unique sous le rapport des idées, c’est que le mouvement romantique partit de là, comme celui de la Renaissance. N’est-ce pas David d’Angers qui y donna le branle, en 1817, avec sa statue du Grand Condé, et qui, ramassant le mot de Patrie naturalisé par Joachim du Bellay, se fit l’illustrateur, le Phidias de nos gloires nationales ?
Les poètes vinrent après David. Que si Lamartine et Victor Hugo naquirent et se formèrent ailleurs que sur les bords de la Loire, il convient de ne pas oublier que les femmes qui leur ouvrirent le cœur et l’esprit avaient dans les veines du sang breton-angevin. Les Méditations sortirent du tombeau d’Elvire, qui était d’origine nantaise, et les Odes et les Feuilles d’Automne, de l’amour de Victor Hugo pour sa mère et sa fiancée, qui toutes deux étaient de Nantes. Rappelons-nous aussi que les maîtres de Lamartine et d’Hugo, à savoir Chateaubriand et Lamennais, étaient fils de la Bretagne.
Enfin ce qui met le comble à ce miracle d’art et de poésie, c’est que ce fut un Angevin pur sang qui fut le trait d’union entre David d’Angers et les écrivains de l’École romantique.
À cet égard Victor Pavie, car c’est de lui que je veux parler, a droit à toute notre reconnaissance et mérite une place à part dans l’histoire du Cénacle de Joseph Delorme.
Né à Angers, le 26 novembre 1808, Victor Pavie était fils d’un imprimeur dont le père, imprimeur aussi, avait passé comme tel par toutes les affres de la Révolution.
Arrêté sous la Terreur pour avoir imprimé des placards royalistes, le grand-père de Pavie avait été sauvé par l’intervention de Choudieu et s’était réfugié en Espagne, pendant que sa femme était enfermée dans la prison de Blois.
Victor fut donc nourri dans la haine de la Révolution. Ayant perdu sa mère en bas âge, il fut confié avec son frère Théodore aux soins d’une admirable fille, nommée Manette Dubois, qui, avant d’entrer à leur service, avait suivi l’armée vendéenne dans sa campagne d’outre-Loire, et qui, ayant été prise et incarcérée au Bouffay de Nantes, n’avait dû son salut qu’au 9 Thermidor.
Jusqu’à l’âge de dix ans, Victor Pavie fut un assez mauvais écolier. Mais, en ce temps-là, les enfants étaient élevés à la diable et connaissaient surtout l’école buissonnière. Après avoir usé pas mal de culottes sur les bancs de deux petites institutions privées, un ami de la famille se chargea de lui apprendre les premiers éléments du français et du latin, puis, une fois débrouillé, on le mit au lycée d’Angers d’où, sa rhétorique finie, on l’envoya à Paris pour suivre les cours du lycée Charlemagne.
Il y était en 1825, et je vois, dans une lettre de David d’Angers à son père, que c’est le grand sculpteur qui lui servait de correspondant.
Cela me parut d’abord extraordinaire, car autant le père de Pavie était royaliste, autant David d’Angers était républicain. Lui aussi, il avait souffert de la Révolution, mais c’était dans le camp adverse. Son père, qui pour l’aguerrir l’avait traîné derrière lui en Vendée dans les armées de la République, avait été fait prisonnier le soir d’un combat terrible, et même, après la déroute de Cholet, les Vendéens l’eussent sûrement passé par les armes avec tous les bleus enfermés comme lui dans l’église de Saint-Florent, si Bonchamps, au moment de mourir, n’avait crié grâce pour ces prisonniers.
Le geste de Bonchamps avait touché jusqu’au fond du cœur le jeune David. Tout en restant républicain, il s’était pris d’admiration pour le héros vendéen qui avait sauvé la vie à son père, et c’est pour lui payer sa dette de reconnaissance qu’en 1824 il avait fait sa statue funéraire que l’on regarde comme son chef-d’œuvre.
Cet acte de piété filiale avait cimenté l’amitié que, malgré les opinions opposées de leurs pères, David et Pavie s’étaient vouée sur les bancs de l’École centrale. C’est là, en effet, qu’ils se rencontrèrent pour la première fois. Il y a même une anecdote charmante au sujet de cette première rencontre. On sait que, le matin de la rentrée des classes, les élèves nouveaux, se sentant dépaysés, ont l’habitude de chercher autour d’eux quelque figure amie. Or, David, ne reconnaissant personne dans la cour, se tenait à l’écart, timide et les mains dans ses poches, quand Louis Pavie, frappé de la douceur réfléchie de son œil bleu, lui dit gentiment : « Viens donc avec nous, p’tit gâs, viens donc ! »
Il faut être du pays pour savourer « la douceur angevine » de cette expression populaire.
Le p’tit gâs ne se le fit pas dire deux fois et s’attacha à Pavie qui se prit pour lui d’une égale affection. Longtemps après, David perdit son père. Il était alors à l’École de Rome. À son retour, il fut touché jusqu’aux larmes en apprenant que c’était Pavie qui lui avait fermé les yeux. Ces choses-là sont de celles qui ne s’oublient pas quand on a du cœur. Aussi la politique fut-elle incapable de les désunir. En 1836, alors que la révolution de Juillet avait creusé davantage encore le fossé qui séparait les ultras des libéraux, David écrivait à Pavie : « Tu sais qu’en politique notre opinion a toujours été opposée, et cependant jamais le moindre nuage ne s’est élevé entre nous. Continuons donc ainsi. »
Et pour « continuer », il avait déjà reporté sur le fils l’affection qu’il avait pour le père.
À partir de 1824, on peut dire que Victor Pavie entra pour n’en plus sortir dans la vie de David d’Angers et qu’il fut associé de près ou de loin à toutes ses pensées, à tous ses travaux. Il est vrai que Pavie avait une nature d’apôtre. C’est le mot dont se servait pour me le peindre le fils de Paul Huet, le paysagiste.
« Je me souviens très bien de cette belle figure », m’écrivait naguère M. René Huet, qui le vit souvent chez son père, quand il était enfant. « Grand, maigre, illuminé, très exalté, il avait l’air d’un apôtre et passait rapidement d’une chose à une autre, sans tarir jamais la source de son enthousiasme. Passionné pour la poésie et pour l’art, il était lié avec toute l’École romantique ; mon père l’aimait beaucoup et il l’avait en grande estime. Pour nous, enfants, il nous paraissait un peu étrange et nous faisait parfois l’effet d’un christ battant l’air pour retrouver les deux bras de sa croix. »
L’image est d’autant plus juste que Pavie était un parfait chrétien.
Mais s’il était passionné pour la poésie et pour l’art, il aimait avant tout sa petite patrie. Tout ce qui touchait à l’histoire d’Anjou lui était sacré, et c’est par là, j’imagine, que David s’était senti attiré tout de suite vers cette âme vibrante, lui qui, dans sa fierté d’Angevin, avait ajouté à son nom celui de sa ville natale pour s’en faire un titre de noblesse.
Si David a dressé des monuments à toutes les illustrations de sa province, Pavie les a célébrées sur tous les tons, en vers et en prose. Sa première ode, car il rima de bonne heure à l’exemple de son père, mais avec un autre talent que lui, fut pour déplorer la mort de Béclard, médecin fameux, qui était Angevin de naissance.
Il avait alors seize ans et ne jurait déjà que par Lamartine. Ayant aperçu un jour un exemplaire des Méditations sur le bureau de son père, il en lut au hasard quelques fragments, et telle fut son émotion que, pour lui en faire part plus vite, il courut à toutes jambes aux Rangeardières, où l’imprimeur était en villégiature, à quelques kilomètres d’Angers. C’est Lamartine qui lui révéla la poésie. « Il surgissait à mes yeux comme un régénérateur, a-t-il écrit plus tard. Il chantait Dieu, le Dieu de nos foyers et de nos temples. Les orages de sa vie si péniblement évoqués dans les premières Méditations se résolvaient du moins dans un religieux repentir. »
Quelques années après, il faillit s’évanouir à sa vue en le rencontrant chez Victor Hugo.
Fontanes disait que :
L’enthousiasme habite aux rives de Jourdain.
S’il avait connu Pavie, il aurait pu dire tout aussi bien qu’il habitait aux bords de la Loire.
Cependant, ses études finies, Victor Pavie était retourné chez son père qui, pour satisfaire ses goûts plus encore que ceux de ses lecteurs, venait d’ajouter (janvier 1826) un feuilleton littéraire aux Affiches d’Angers. Je crois même que Victor était pour beaucoup dans cette création, car le style le démangeait lui aussi, et comme il avait suivi avec un intérêt croissant, durant son séjour à Paris, le mouvement, les publications de l’École romantique, il n’était pas fâché d’avoir sous la main un organe à lui, si modeste fût-il, où il pût exprimer son enthousiasme et ses admirations naissantes.
Justement Victor Hugo venait de faire paraître la troisième édition de ses Odes et Ballades. Victor Pavie acheta l’ouvrage et en rendit compte sous ses initiales dans le feuilleton des Affiches d’Angers du 2 décembre 1826, en termes qui allèrent au cœur du jeune poète et lui mirent la plume à la main.
Le 13 décembre suivant, Victor Hugo écrivait à Monsieur V.P., l’un des rédacteurs du Feuilleton des Affiches d’Angers :
« C’est à vous sans doute, Monsieur, que je dois l’envoi d’un numéro du Feuilleton d’Angers (2 décembre) où il est parlé du volume d’Odes et Ballades que je viens de publier. Du moins, c’est à vous, Monsieur, que je dois ce bienveillant article, et je me fais un devoir et une joie de vous en remercier !
Ce n’est point parce que vous me louez que je vous remercie. Je ferais peu de cas, permettez-moi de vous le dire, d’un éloge qui ne serait qu’un éloge. Ce dont je suis reconnaissant dans votre article, c’est du talent qui s’y trouve ; ce qui me plaît, ce qui me charme, ce qui m’enchante, c’est d’avoir trouvé dans si peu de lignes la révélation complète d’une âme noble, d’une intelligence forte et d’un esprit élevé.
Vous êtes, je le sens, Monsieur, du nombre de ces amis que mes pauvres livres me font de par le monde et que je ne connais pas, mais que j’ai tant de plaisir à rencontrer quand une occasion fortuite se présente de leur serrer la main. En attendant que cette bonne fortune m’arrive à votre égard, recevez cette lettre comme un gage de ma vive et cordiale estime.
Je regrette de ne pouvoir vous écrire que sous les initiales V.Ρ. ; elles signent un article que les premiers noms de notre littérature pourraient souscrire ; mais, quel qu’il soit, le nom qu’elles cachent ne restera pas longtemps ignoré.
Votre ami
VICTOR HUGO. »
Vous pensez si Victor Pavie se rengorgea en recevant cette lettre et s’il s’empressa de se faire connaître ! Le 3 janvier, sans perdre de temps, Victor Hugo lui répondit qu’il appartenait à la seule classe privilégiée que fit la nature ; qu’il avait le mens divinior qui place l’homme au-dessus des hommes et que, bien qu’il ne connût encore que peu de lignes de sa plume, il n’aurait pas de peine à prophétiser son avenir… « Le chêne est en vous, lui disait-il, laissez-le croître. »
Victor Hugo était déjà le donneur d’eau bénite qu’il fut toute sa vie. Mais Pavie, tout jeune et tout fier qu’il était d’entrer ainsi en relations avec un poète d’un tel talent, d’une telle renommée, n’était pas de ceux qui se laissent prendre à la glu des paroles flatteuses. Outre qu’il avait à côté de lui, dans la personne de son père, un homme qui, le cas échéant, se serait chargé de le rappeler à la modestie, il ne s’abusait pas sur ses moyens ; on pouvait vanter son mérite et dire que ses premières compositions en vers, comme le Juif, la Mer et le Lac et l’Enfant, étaient « ingénieuses et inspirées » ; Victor Hugo avait beau l’inviter « à ne pas cacher sa tête sous son aile, son aile étant faite pour planer dans le ciel et sa tête pour contempler le soleil », il sentait qu’il n’aurait jamais, comme poète, qu’un talent d’amateur ; son ambition n’était pas, du reste, de se faire un nom dans la littérature, mais d’honorer, et d’illustrer si possible, la profession de son père.
En attendant, il cultiva, cela va sans dire, l’amitié du poète glorieux qui lui avait tendu si gracieusement la main et sa première pensée fut naturellement de le mettre en rapports avec David d’Angers, persuadé que tous deux y trouveraient leur compte.
Trois mois après, c’était chose faite. Le 20 mai 1827, – toutes ces dates doivent être retenues, car ce sont les jalons de l’histoire, – Victor Hugo mandait à Pavie :
« Votre père nous a quittés vite, trop vite, dites-le-lui bien. Mais aux regrets que nous a causés son départ, il a voulu mêler une espérance, celle de vous voir bientôt. Votre aimable lettre la change en certitude et la plus chère marque d’amitié que vous puissiez me donner, c’est de la réaliser bientôt. Vous ferez de belles choses partout, mais à Paris l’esprit a plus d’aliment : les musées, les galeries, les bibliothèques lui ouvrent de nouvelles sphères d’idées ; enfin, tout ce qui s’acquiert est ici, et vous avez déjà tout ce que la nature donne.
J’ai été également enchanté de connaître M. David (d’Angers). C’est un homme de beaucoup de talent et de beaucoup d’idées. Il m’a fait voir son atelier où abondent les belles choses… »
C’est donc au mois de mai 1827, et par l’entremise du père de Pavie, que Victor Hugo et David d’Angers entrèrent en relations ensemble. Désormais, malgré leur différence d’âge, ils seront unis comme les doigts de la main, et pour fortifier encore leur amitié, quand Pavie viendra faire son droit à Paris, il mettra son orgueil et sa joie à aller de l’un à l’autre.
Le 19 novembre 1827, David écrivait au fils de l’imprimeur :
« Je vois souvent notre ami Hugo ; nous sommes allés assister au ferrement des galériens de Bicêtre. Combien j’aime Hugo avec son âme ardente et tout antique ! Je lis actuellement le Dante. Hugo n’est pas sans quelque ressemblance avec ce poète. Il vient de nous lire sa préface de Cromwell. Quelle profondeur de pensées ! à elle seule, cette préface est un code de littérature. »
On voit qu’Hugo n’était pas seul à posséder une âme ardente, et que David avait comme Pavie la flamme et l’enthousiasme.
Que si vous me demandez dans quel but le poète et le sculpteur étaient allés à Bicêtre assister au ferrement des galériens, je vous répondrai que c’était afin de documenter Hugo, qui songeait à écrire le Dernier jour d’un Condamné. Dans l’espace de quelques semaines ils assistèrent deux fois à cette lugubre cérémonie. Car David s’intéressait maintenant à tout ce que faisait Victor Hugo, et comme il habitait à deux pas de chez lui, dès qu’il avait un moment de loisir, il allait rue Notre-Dame-des-Champs, se réchauffer, si l’on peut dire, au foyer de l’auteur de Cromwell. Souvent aussi Victor Hugo passait le prendre le soir, à son atelier, et l’emmenait voir le coucher du soleil dans la plaine de Montrouge. Et, le dimanche, David se joignait régulièrement à la bande joyeuse des artistes et des poètes qui allait au Moulin de Beurre manger, au son des violons, le poulet sauté de la mère Saguet. C’est même au cours d’une de ces promenades que le statuaire rencontra un jour avec Hugo, rue du Montparnasse, la petite fille, grêle, étiolée, flétrie, mais belle tout de même, qui lui servit de modèle pour le Tombeau de Botzaris.
Mais la grande occupation de David, en ces années de fièvre et d’émulation fraternelle, était de modeler dans la terre glaise les traits de tous ceux, jeunes ou vieux, qui étaient sur le chemin de la gloire. Bientôt son atelier de la rue d’Assas devint en quelque sorte le vestibule du Panthéon. Chateaubriand posa devant lui, l’un des premiers, puis ce fut au tour de Delacroix, d’Hugo, de Lamartine, de Vigny, de Sainte-Beuve, de Mérimée, d’Émile Deschamps, de Delphine Gay, de Mme Tastu. Tout le Cénacle y passa, sans parler des autres. Si bien que David d’Angers acquit en peu de temps, dans le monde des lettres, une renommée extraordinaire et, d’ailleurs, parfaitement justifiée.
On connaît les vers que lui ont dédiés Victor Hugo et Sainte-Beuve dans Joseph Delorme et les Feuilles d’Automne. En voici quelques-uns d’Alfred de Vigny, qui ne figurent pas dans ses œuvres :
Et ce qu’il y avait d’admirable et de tout à fait unique chez David, c’était son désintéressement absolu. Non seulement il ne demandait rien aux écrivains et aux artistes dont il faisait le buste ou le médaillon, mais il se croyait encore leur obligé. Il les sollicitait comme un débutant dans la carrière, et comme s’ils lui avaient fait une grâce en venant poser devant lui. Et quand les modèles lui manquaient en France, il allait en chercher en Angleterre et en Allemagne. Il faisait le voyage de Londres avec l’espoir d’en rapporter le buste de Walter Scott. Il entreprenait celui de Weimar pour modeler le front olympien du grand Gœthe. Et toujours et partout il était accompagné de Victor Pavie et quelquefois de son frère Théodore. Victor, avec ses qualités lyriques, lui donnait l’aplomb qui lui aurait manqué sans lui pour forcer les portes illustres. Il a fait ainsi, dans l’espace de vingt-cinq ans, quelque chose comme 50 statues, 120 bustes, 75 ou 80 bas-reliefs, dont celui du Panthéon, 40 statuettes, 30 médaillons de proportions colossales et 500 médaillons de moyenne grandeur, tous fondus à la cire perdue.
Et tout cela se voit à Angers, au Musée qui porte son nom, car il voulut que toute son œuvre fût réunie dans sa ville natale, et au fur à mesure qu’il exécutait un morceau, grand ou petit, il en offrait gracieusement, humblement, le moulage à la municipalité d’Angers. Je ne crois pas qu’il existe au monde un ensemble sculptural comparable à ce Musée. Toute l’histoire de France est là, évoquée et traduite par un ébauchoir magistral et divin.