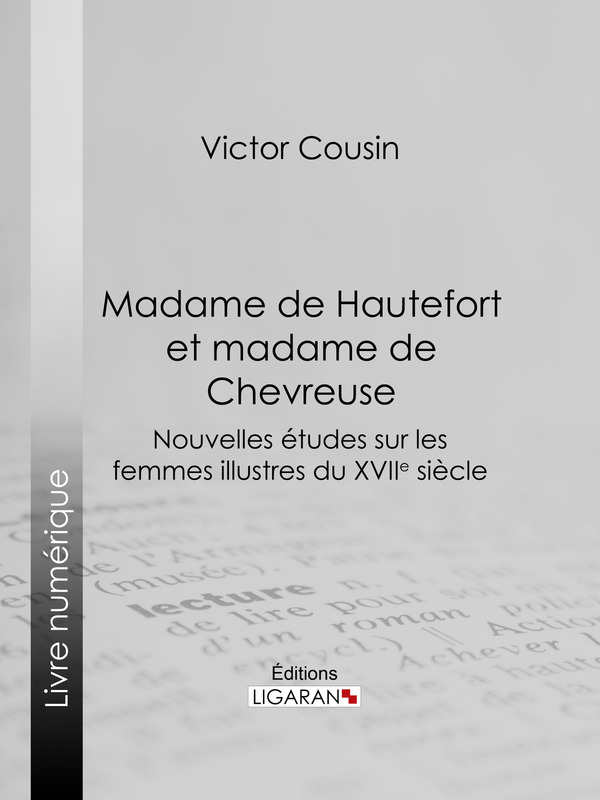
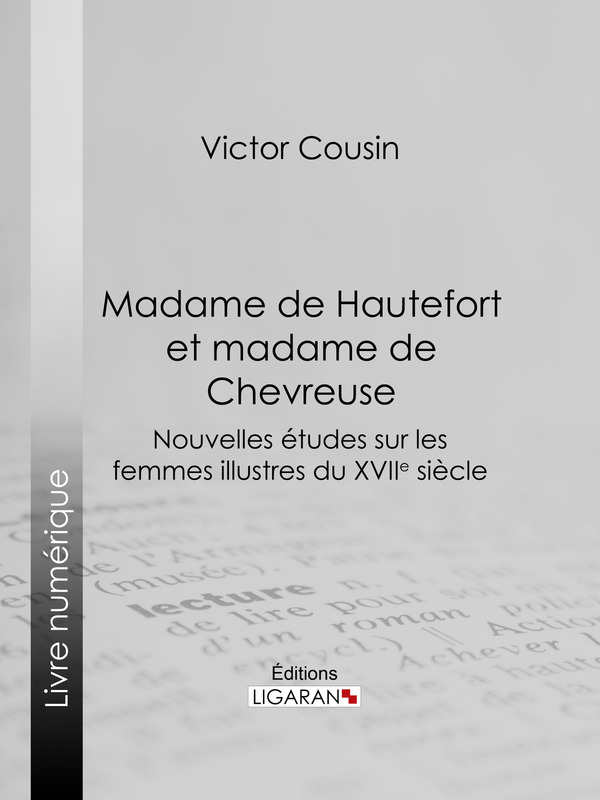

EAN : 9782335091762
©Ligaran 2015
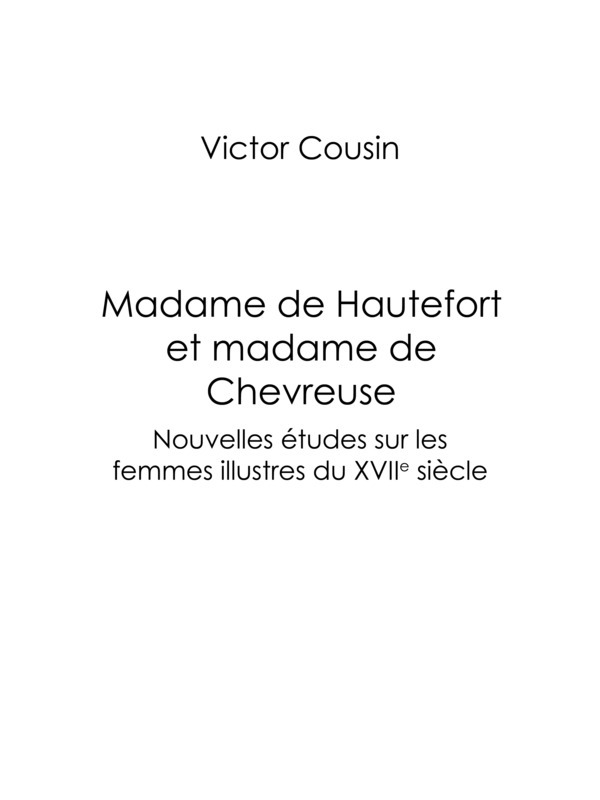
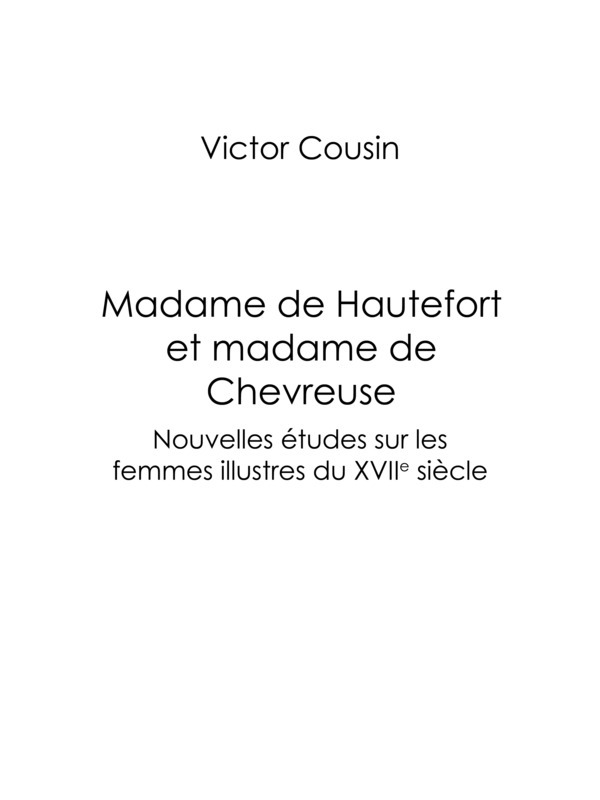
Voici maintenant une tout autre personne, qui va nous ramener parmi les mêmes évènements, mais qui y portera un bien différent caractère. C’est encore une ennemie, ce n’est plus une rivale de Richelieu et de Mazarin. La noble femme dont nous allons retracer la vie n’appartient point à l’histoire politique ; elle n’est point de la famille des hommes d’État ; elle n’a point disputé aux deux grands cardinaux leur pouvoir et le gouvernement de la France ; elle a refusé seulement de leur livrer son âme, de trahir pour eux ses amis et sa cause, cette cause qui lui semblait celle de la religion et de la vertu. Son grand cœur, qu’animait une flamme héroïque, et que servaient une merveilleuse beauté et un esprit adorable, toujours contenu par la dignité et la pudeur, a paru surtout dans ses sacrifices. Après avoir été la favorite d’un Roi, l’amie d’une Reine, l’idole de la cour la plus brillante de l’univers, dès que le devoir a parlé, elle a été au-devant de la disgrâce, elle s’est retirée du monde, elle a caché et comme enseveli sous les voiles et dans l’ombre de la vertu les dons les plus rares que Dieu ait jamais départis à une créature humaine. Elle n’a point laissé de nom dans l’histoire, et nous qui entreprenons de la disputer à l’oubli, si nous la mettons à côté de Mme de Chevreuse, ce n’est pas un parallèle, c’est bien plutôt un contraste que nous voulons établir, pour faire paraître sous ses aspects les plus divers la grandeur de la femme au XVIIe siècle, comme aussi, nous l’avouons, avec le désir et l’incertaine espérance d’intéresser à cette fière et chaste mémoire quelques âmes d’élite çà et là dispersées.
La naissance et la famille de Marie de Hautefort. – Piété et ambition. – La jeune Marie entre à la cour comme une des filles d’honneur de Marie de Médicis, puis de la reine Anne. – Louis XIII amoureux de Mlle de Hautefort. Caractère de cet amour. – Richelieu, ne pouvant la gagner à ses intérêts, devient son ennemi. – Mlle de La Fayette. – Affaire de 1637. Péril extrême de la reine Anne. Dévouement de Mlle de Hautefort.
Marie de Hautefort naquit en l’année 1616, le 5 février, dans un vieux château féodal du Périgord, qui tour à tour avait appartenu à Gui le Noir, à Lastours dit le Grand pour ses exploits dans les croisades, au fameux poète guerrier Bertrand de Born, à Pierre de Gontaut, et à d’autres personnages illustres du Moyen Âge, qui servit souvent de rempart contre les incursions de l’ennemi dans les guerres des Anglais au XVe et au XVIe siècle, et depuis est devenu une grande et noble résidence, diminuée aujourd’hui, mais encore fort bien conservée, et surtout très dignement habitée.
Marie était le dernier enfant du marquis Charles de Hautefort, maréchal de camp des armées du Roi, et gentilhomme ordinaire de sa chambre. Il avait épousé Renée de Bellay, de l’ancienne maison de La Flotte Hauterive ; et de ce mariage étaient sortis deux fils et quatre filles. Le fils aîné, Jacques François, devint lieutenant général, premier écuyer de la Reine, chevalier des ordres du Roi, fameux à la fois par sa parcimonie pendant sa vie et ses largesses après sa mort. Ne s’étant pas marié, il laissa son titre, ainsi que sa charge de premier écuyer de la Reine, à son cadet Gilles de Hautefort, longtemps connu sous le nom de comte de Montignac, qui suivit avec succès la carrière des armes, et parvint aussi au grade de lieutenant général. C’est lui qui a continué la noble famille. Il épousa en 1650 Marthe d’Estourmel, dont il eut de nombreux enfants, et mourut en décembre 1693, âgé de quatre-vingt-un ans. Des quatre filles de Charles de Hautefort, les deux premières s’éteignirent fort jeunes et n’ont pas laissé de trace. La troisième, au contraire, née en 1610, prolongea sa vie jusqu’en 1712 ; on l’appelait Mlle d’Escars ; en 1653, elle fut mariée à François de Choiseul, marquis de Praslin, fils du premier maréchal de ce nom. Elle ne manquait ni de beauté ni d’esprit. Mais la figure qu’elle fit dans le monde ainsi que ses deux frères, ils la devaient surtout à l’éclat que jeta de bonne heure et à la haute renommée que garda toute sa vie leur sœur cadette Marie de Hautefort.
Celle-ci était à peine née quand mourut son père que sa mère suivit bientôt, en sorte qu’elle resta en très bas âge, et presque sans biens, confiée aux soins de sa grand-mère, Mme de La Flotte Hauterive. Ses premières années s’écoulèrent dans l’obscurité et la monotonie de la vie de province. La jeune fille, qui promettait d’être belle et spirituelle, ne tarda pas à s’y ennuyer. Souvent, chez Mme de La Flotte, elle entendait parler de la cour, de cette cour brillante et agitée, vers laquelle étaient tournés tous les regards, et où se décidaient les destinées de la France. Elle aussi, elle se sentit appelée à y jouer un rôle, et depuis elle racontait plaisamment qu’à onze ou douze ans, unissant déjà la plus sincère piété à cette ardeur de l’âme qu’on nomme l’ambition, elle s’enfermait dans sa chambre pour prier Dieu avec ferveur de la faire aller à la cour Sa prière fut exaucée : les affaires de Mme de La Flotte l’ayant conduite à Paris, elle y amena avec elle l’aimable enfant, dont les grâces naissantes firent partout la plus heureuse impression. Elle plut particulièrement à la princesse de Conti, Louise Marguerite de Guise, fille du Balafré, si célèbre par sa beauté, son esprit et sa galanterie, la brillante maîtresse de Bassompière, l’auteur des Amours du grand Alcandre. La princesse la trouva si jolie qu’elle voulut la mener avec elle à la promenade, et tout le monde cherchait à deviner quelle était cette charmante personne que l’on voyait à la portière de son carrosse. Le soir on ne parla que de Mlle de Hautefort, et il ne fut pas difficile d’engager la Reine mère, Marie de Médicis, à la prendre parmi ses filles d’honneur.
Voilà donc Mlle de Hautefort sur le théâtre où elle avait tant souhaité paraître. Elle y montra des qualités qui en peu de temps la firent aimer et admirer tout ensemble : une bonté inépuisable avec une rare fermeté, une piété vive avec infiniment d’esprit, un très grand air tempéré par une retenue presque sévère que relevait une beauté précoce. On l’appelait l’Aurore, pour marquer son extrême jeunesse et son innocent éclat. En 1630, elle suivit la Reine mère à Lyon où le Roi était tombé sérieusement malade, pendant que Richelieu était à la tête de l’armée en Italie. C’est là que Louis XIII la vit pour la première fois, et qu’il commença à la distinguer. Mlle de Hautefort avait alors quatorze ans.
Louis XIII était l’homme du monde qui ressemblait le moins à son père Henri IV : il repoussait jusqu’à l’idée du moindre dérèglement, et les beautés faciles de la cour de sa mère et de sa femme n’attiraient pas même ses regards. Mais ce cœur mélancolique et chaste, avait besoin d’une affection ou du moins d’une habitude particulière qui lui tînt lieu de tout le reste, et le consolât des ennuis de la royauté. La modestie aussi bien que la beauté de Mlle de Hautefort le touchèrent ; peu à peu il ne put se passer du plaisir de la voir et de s’entretenir avec elle ; et lorsqu’à son retour de Lyon ; après la fameuse journée des Dupes, l’intérêt de l’État et sa fidélité à Richelieu le forcèrent d’éloigner sa mère, il lui ôta la jeune Marie et la donna à la Reine Anne, en la priant de l’aimer et de la bien traiter pour l’amour de lui. En même temps il fit Mme de La Flotte Hauterive dame d’atours de la reine à la place de Mme du Fargis qui venait d’être exilée. Anne d’Autriche reçut d’abord assez mal le présent qu’on lui faisait. Elle tenait à Mme du Fargis, qui comme elle était du parti de la Reine mère, de l’Espagne et des mécontents, et elle regarda sa nouvelle fille d’honneur, non seulement comme une rivale auprès du Roi, mais comme une surveillante et une ennemie. Elle reconnut bientôt à quel point elle s’était trompée. Le trait particulier du caractère de Mlle de Hautefort, par-dessus toutes ses autres qualités, le fond même de son âme était une fierté généreuse, à moitié chevaleresque, à moitié chrétienne, qui la poussait du côté des opprimés et des faibles. La toute-puissance n’avait aucune séduction pour elle, et la seule apparence de la servilité la révoltait. Dans cette belle enfant était cachée une héroïne, qui parut bien vite dès que les occasions se présentèrent. Voyant sa maîtresse persécutée et malheureuse, par cela seul elle se sentit attirée vers elle, et par goût comme par honneur elle résolut de la bien servir. Peu à peu sa loyauté, sa parfaite candeur, son esprit et ses grâces charmèrent la Reine presque autant que le Roi, et la favorite de Louis XIII devint aussi celle d’Anne d’Autriche.
La première galanterie déclarée du Roi envers Mlle de Hautefort fut à un sermon où la Reine était avec toute la cour. Les filles d’honneur étaient, selon l’usage du temps, assises par terre. Le Roi prit le carreau de velours sur lequel il était à genoux, et l’envoya à Mlle de Hautefort pour qu’elle se pût commodément asseoir. Elle, toute surprise, rougit, et sa rougeur augmenta sa beauté. Ayant levé les yeux, elle vit ceux de toute la cour arrêtés sur elle. Elle reçut ce carreau avec un air si modeste, si respectueux et si grand qu’il n’y eut personne qui ne l’admirât. La Reine lui ayant fait signe de le prendre, elle le mit auprès d’elle sans vouloir s’en servir. Il n’en fallut pas davantage pour lui attirer encore plus de considération qu’auparavant. La Reine fut la première à la rassurer ; elle voyait tant d’estime du côté du Roi, et tant de vertu du côté de Mlle de Hautefort, qu’elle devint leur confidente.
Les mémoires du temps abondent en piquants détails sur ces premières et platoniques amours de Louis XIII.Écoutons Mademoiselle : « La cour était fort agréable alors. Les amours du Roi pour Mlle de Hautefort, qu’il tâchait de divertir tous les jours, y contribuaient beaucoup. La chasse était un des plus grands plaisirs du Roi ; nous y allions souvent avec lui. Mlles de Hautefort, Chemerault et Saint-Louis, filles de la reine ; d’Escars, sœur de Mlle de Hautefort, et Beaumont venaient avec moi. Nous étions toutes vêtues de-couleur, sur de belles haquenées richement caparaçonnées, et pour se garantir du soleil chacune avait un chapeau garni de quantité de plumes. L’on disposait-toujours la chasse du côté de quelques-belles maisons, où l’on trouvait de grandes collations, et au retour le Roi se mettait dans mon carrosse avec Mlle de Hautefort et moi. Quand il était de belle humeur, il nous entretenait fort agréablement de toutes choses… L’on avait régulièrement trois fois la semaine le divertissement de la musique…, et la plupart des airs qu’on chantait étaient de la composition du Roi ; il en faisait même les paroles, et le sujet n’était jamais que Mlle de Hautefort. »
Les vers amoureux de Louis XIII ne sont pas venus jusqu’à nous ; mais voici un couplet d’une autre chanson, dont l’auteur est inconnu, et qui, ce nous semble, peint avec assez de grâce le charme qu’exerçait Mlle de Hautefort sur l’humeur chagrine de son royal amant :
Quand Mlle de Hautefort n’aurait pas été aussi sage que belle, l’amour du Roi ne lui aurait pas été fort dangereux. Tous les soirs, il l’entretenait dans le salon de la Reine ; mais il ne lui parlait la plupart du temps que de chiens, d’oiseaux et de chassé, et la craignant et se craignant lui-même il osait à peine en lui parlant s’approcher d’elle. On raconte qu’un jour étant entré à l’improviste chez la Reine, et ayant trouvé Mlle de Hautefort tenant un billet qu’on venait de lui remettre, il la pria de lui laisser voir ce billet. Elle n’avait gardé de le faire parce qu’il contenait quelque plaisanterie sur sa faveur nouvelle ; et pour le cacher, elle le mit dans son sein. La Reine en badinant lui prit les deux mains, et dit au Roi de le prendre où il était. Louis XIII n’osa se servir de sa main et prit les pincettes d’argent qui étaient auprès du feu pour essayer s’il pourrait avoir ce billet ; mais elle l’avait mis trop avant, et il ne put l’atteindre. La Reine la laissa aller en riant de sa peur et de celle du Roi.
Si la passion du Roi était innocente, elle était trop vive pour n’être pas mêlée de fréquentes et violentes jalousies. Le Roi savait quelle était la conduite de Mlle de Hautefort, et que parmi tous les jeunes seigneurs qui brillaient à la cour, elle n’en aimait aucun ; mais il aurait aussi voulu que personne ne l’aimât, que personne ne lui parlât, que personne même ne la regardât avec quelque attention. Souvent il lui disait qu’il serait mort de déplaisir si son père Henri le Grand eût été encore en vie, parce qu’assurément il eût été amoureux d’elle. Ces bizarres jalousies, ces longues et fatigantes assiduités pesaient quelquefois un peu à la jeune fille, et avec son indépendance et sa fierté elle le témoignait. De là des démêlés assez souvent orageux, suivis de raccommodements qui ne duraient guère. Dès qu’il y avait entre eux quelque brouillerie, tout s’en ressentait, les divertissements de la cour étaient suspendus, et si le Roi venait le soir chez la Reine, il s’asseyait dans un coin sans dire un mot, et sans que personne osât lui parler. « C’était, dit Mademoiselle, une mélancolie qui refroidissait tout le monde, et pendant ce chagrin le Roi passait la plus grande partie du jour à écrire ce qu’il avait dit à Mlle de Hautefort et ce qu’elle lui avait répondu : chose si véritable qu’après sa mort on a trouvé dans sa cassette de grands procès-verbaux de tous les démêlés qu’il avait eus avec ses maîtresses, à la louange desquelles on peut dire, aussi bien qu’à la sienne, qu’il n’en a jamais aimé que de très vertueuses. » Mme de Motteville déclare fort nettement que Mlle de Hautefort, tout en étant sensible aux hommages de Louis XIII, n’avait aucun goût pour lui, et qu’elle le maltraitait autant qu’on peut maltraiter un Roi ; en sorte qu’il était, dit-elle, « malheureux de toutes les manières ; car il n’aimait pas la Reine, et il était le martyr de Mlle de Hautefort qu’il aimait malgré lui. Il avait quelque scrupule de l’attachement qu’il avait pour elle, et il ne s’aimait pas lui-même. Parmi tant de sombres vapeurs et de fâcheuses fantaisies, il semblait qu’une belle passion ne pouvait avoir de place dans son cœur. Elle n’y était pas aussi à la mode des autres hommes qui en font leur plaisir ; car cette âme, accoutumée à l’amertume, n’avait de la tendresse que pour sentir davantage ses peines. »
Le sujet ordinaire des querelles que faisait le Roi à Mlle de Hautefort, était la Reine. Louis XIII avait deux motifs pour ne pas l’aimer, l’un était général et de l’ordre le plus élevé, celui qui le sépara de sa mère, à savoir l’intérêt de l’État, une politique qui ne fléchit jamais et le ramena toujours à Richelieu, bien que les façons altières du cardinal ne lui plussent point, et qu’il lui prît souvent des impatiences et des révoltes qui cédaient bientôt à sa justice et à son patriotisme. L’autre motif n’était pas moins fort et plus personnel. Défiant et jaloux, depuis l’affaire de Chalais et ses premières déclarations, le Roi était demeuré convaincu que la Reine s’entendait avec le duc d’Orléans, et qu’elle se serait fort bien accommodée de l’épouser après lui et de partager son trône. Cette conviction était à ce point enracinée dans cet esprit malade qu’après qu’il eut eu des enfants de la Reine, et même à son lit de mort, lorsqu’elle lui protesta avec larmes qu’elle était entièrement étrangère à la conspiration de Chalais, il se contenta de répondre que dans son état il était obligé de lui pardonner, mais non de la croire. Il s’efforça de détacher Mlle de Hautefort d’une maîtresse qu’il lui peignait sous les couleurs les plus défavorables, ne se doutant pas que, plus il s’emportait contre l’une, moins il persuadait l’autre, et que la persécution même dont Anne d’Autriche était l’objet, exerçait sur ce jeune et noble cœur une séduction irrésistible. Voyant que tous ses discours ne réussissaient point, il finit par lui dire : « Vous aimez une ingrate, et vous verrez un jour comme elle paiera vos services. »
Richelieu avait vu d’abord avec plaisir le goût du Roi pour une jeune fille qui n’appartenait à aucun parti, et dont il n’avait pu deviner le caractère. Il espérait qu’une distraction agréable adoucirait un peu cette humeur sombre et bizarre qui lui était un continuel sujet d’inquiétude. Il prodigua les compliments et les caresses à la jeune favorite ; il s’employa même à dissiper les orages qui s’élevaient souvent dans ce commerce agité, croyant bien en retour-la gagner à sa cause et la mettre dans ses intérêts. Mais elle qui n’avait pas consenti à sacrifier sa maîtresse au Roi lui-même, eût rougi d’écouter son persécuteur ; elle rejeta bien loin les avances du cardinal, et dédaigna son amitié dans un temps où il n’y avait pas une femme à la cour qui ne fît des vœux pour en être seulement regardée.
Aujourd’hui que nous pouvons embrasser le cours entier du XVIIe siècle et mesurer son progrès presque régulier depuis les glorieux commencements d’Henri IV jusqu’aux dernières et tristes années de Louis XIV, il nous est bien facile de comprendre et d’absoudre Richelieu. Nous concevons que pour en finir avec les restes de la société féodale, pour mettre irrévocablement le pouvoir royal au-dessus d’une aristocratie excessive, mal réglée, turbulente, pour empêcher les Protestants de former un État dans l’État et les faire ployer sous la loi commune, pour arrêter la maison d’Autriche, maîtresse de la moitié de l’Europe, pour agrandir le territoire français, pour introduire un peu d’ordre et d’unité dans la société nouvelle, pleine de force et de vie, mais où luttaient les éléments les plus dissemblables, il fallait une vigueur extraordinaire, et peut-être pour quelque temps une dictature éclairée, un despotisme national et intelligent. Mais le despotisme a besoin d’être vu à distance : de trop près, il révolte les cœurs honnêtes ; et, tandis qu’aux yeux de la postérité, la grandeur du but excuse en quelque mesure, non pas l’injustice, qui jamais ne peut être excusée, mais l’extrême sévérité des moyens, c’est alors la dureté des moyens qui, en soulevant une indignation généreuse, offusque et fait méconnaître la grandeur du but. Qui de nous, parmi les plus fermes partisans de Richelieu, eût été sûr de lui-même et d’une admiration fidèle devant tant de coups frappés sans pitié, devant tous ces exils, devant tous ces échafauds ? Les contemporains ne virent guère que cela : Richelieu laissa une mémoire abhorrée, et, vivant, il n’eut pour lui qu’un très petit nombre de politiques, à la tête desquels était Louis XIII ; et encore celui-ci, à la mort de son redouté ministre, en approuvant et en gardant le système, fut d’avis de le pratiquer différemment. Mettons-nous donc à la place d’une jeune fille sortie d’une race féodale, mise à la cour par la Reine-mère, et jetée à quinze ans dans celle d’Anne d’Autriche. Disons-le : plus son cœur était noble, moins son esprit pouvait voir clair dans le fond des affaires du temps. Mlle de Hautefort ne connaissait ni les intérêts de la France, ni l’état de l’Europe, ni l’histoire, ni la politique. Tout son esprit, si vanté pour sa vivacité et sa délicatesse, était incapable de percer les voiles du passé et de l’avenir, et le présent la blessait dans tous ses instincts d’honneur et de bonté. Gracieusement accueillie par Marie de Médicis, au bout de quelque temps elle l’avait vue exilée, et elle apprenait que sa première protectrice, la femme d’Henri le Grand, la mère de Louis XIII, dont les torts surpassaient son intelligence, était réduite à vivre en Belgique des secours de l’étranger. Elle n’avait pas connu la première jeunesse un peu légère d’Anne d’Autriche. Depuis 1630, elle n’avait rien aperçu qui pût choquer la sévérité de ses regards. Elle trouvait fort naturel qu’abandonnée et maltraitée par son mari, la Reine en appelât à son frère le roi d’Espagne, et qu’opprimée par Richelieu elle se défendît avec toutes les armes qui lui étaient offertes. Elle voyait les malheurs de la Reine, et elle croyait à sa vertu. Une piété fervente lui faisait accompagner avec joie Anne d’Autriche aux Carmélites et au Val-de-Grâce. Là, on n’aimait pas plus Richelieu que plus tard on n’aima Mazarin ; là, et particulièrement aux Carmélites, chez ces dignes filles de sainte Thérèse et de Bérulle, on priait pour les deux-reines, bienfaitrices de la maison ; on priait pour les victimes de Richelieu ; et il s’était trouvé une sainte religieuse qui, en 1632, dans l’effroi et le silence universel, n’écoutant que la charité et l’amitié, osa élever la voix en faveur du garde des sceaux Michel de Marillac, exilé à Châteaudun, mit sur sa tombe une épitaphe magnanime, et mêla publiquement ses larmes à celles de Charlotte Marguerite de Montmorenci, princesse de Condé, quand la hache impitoyable du cardinal faisait tomber, à Toulouse, la tête de son frère. En 1633, Mlle de Hautefort avait vu frapper et disperser tout l’intérieur de la Reine, Mme de Chevreuse, dont au moins l’intrépidité devait lui plaire, chassée de la cour pour la deuxième fois, et le chevalier de Jars, condamné à mort, ne recevant sa grâce que sur l’échafaud. Toutes ces cruautés indignaient Mlle de Hautefort ; la courageuse fidélité des amis de la Reine excitait la sienne ; elle brava donc les menaces prophétiques de Louis XIII, elle repoussa toutes les offres de Richelieu, qui n’était à ses yeux qu’un tyran de génie, et elle se donna tout entière à la reine Anne, fermement résolue à partager jusqu’au bout sa destinée.
Richelieu, n’ayant pu la gagner, entreprit de la perdre dans l’esprit du Roi. Plus que jamais il se mêla de leurs nombreux démêlés, non plus pour les accommoder, mais pour les aigrir. D’intermédiaire bienveillant, il devint un juge sévère. Aussi, quand Louis XIII était mécontent de la jeune fille, il la menaçait du cardinal. Celle-ci s’en moquait avec l’étourderie de son âge et la fierté de son caractère. Richelieu fit jouer sur le cœur du Roi deux ressorts habilement inventés. Louis XIII était défiant et dévot. Des rapports perfidement exagérés lui apprirent que, dans l’intérieur de la Reine, Mlle de Hautefort faisait avec elle des plaisanteries sur ses manières, sur son humeur, sur son amour. D’autre part lorsque, épris de plus en plus de la beauté toujours croissante de cette charmante fille, dont les grâces se développaient avec les années, il se reprochait un sentiment trop ardent pour être toujours entièrement pur, au lieu d’apaiser comme autrefois les scrupules de sa conscience, on les nourrissait, et on finit par lui faire un crime d’un attachement immodéré, condamné par la religion. Enfin, vers 1635, à la suite d’une querelle plus vive qu’à l’ordinaire, le triste amant prit le parti de rompre avec une maîtresse aussi peu complaisante, et, pendant plusieurs jours, il ne lui parla plus. Il ne l’aimait pas moins, et le soir, chez la Reine, ses regards mélancoliques et passionnés avaient peine à s’éloigner de l’attrayant visage. Il la contemplait en silence, et, quand il voyait qu’on y prenait garde, il détournait sa vue d’un autre côté. La rupture était commencée ; le cardinal la fit durer deux années entières.
Il y avait alors parmi les autres filles d’honneur de la Reine une jeune personne de fort bonne naissance, qui, sans avoir toute la beauté de Mlle de Hautefort, était aussi très agréable. Marie était une blonde éblouissante, parée de bonne heure des charmes les plus redoutables ; Louise Angélique de La Fayette était brune et délicate. Si elle n’avait pas le grand air de sa compagne, si elle n’enlevait pas l’admiration, elle plaisait par sa douceur et sa modestie. À la place de la vivacité et de la grâce, elle avait du jugement et de la fermeté, avec un cœur porté à la tendresse, mais défendu par une piété sincère.
Les confidents du Roi, de faciles serviteurs, Saint-Simon, favori émérite, qui avait fait son traité avec le ministre et ne songeait qu’à lui complaire, bien d’autres encore, parmi lesquels on met à tort ou à raison l’oncle même de Mlle de La Fayette, l’évêque de Limoges, portèrent Louis XIII à faire attention à la jeune fille par tout le bien qu’ils lui en dirent. Louis XIII commença à lui parler pour faire dépit à Mlle de Hautefort ; mais, comme il était homme d’habitude , à force de la voir, l’inclination lui vint pour elle, et il l’aima sérieusement. Mlle de La Fayette commença aussi par être flattée des hommages du Roi ; puis, quand il lui ouvrit son cœur, quand il lui montra ses tristesses intérieures, ses ennuis profonds parmi les grandeurs de la royauté ; quand elle vit l’un des plus puissants monarques de l’Europe plus misérable que le dernier de ses sujets, elle ne put se défendre d’une compassion affectueuse, elle entra dans ses peines et les adoucit en les partageant. Le Roi, se trouvant à son aise avec une femme pour la première fois de sa vie, laissa paraître tout ce qu’il y avait en lui d’esprit, d’honnêteté, de bonnes intentions, et il connut enfin la paix et la douceur d’une affection réciproque. Mlle de La Fayette en effet finit par aimer Louis XIII ; Mme de Motteville, qui plus tard devint son amie et reçut ses plus intimes confidences, l’assure, et nous la croyons. Mlle de La Fayette n’aima pas seulement le Roi comme un simple gentilhomme, avec le plus entier désintéressement, sans s’enorgueillir ni sans profiter de sa faveur : elle l’aima comme un frère, d’un sentiment aussi pur que tendre. Cette liaison dura deux années, jusqu’en 1637, toujours noble, touchante et véritablement admirable. Mlle de La Fayette, c’est Mlle de La Vallière, mais Mlle de La Vallière qui n’a pas failli. Il est vrai que Louis XIII n’était ni aussi dangereux ni aussi pressant que Louis XIV. Une fois pourtant, vaincu par sa tendresse et par le besoin qu’il avait de la voir à toute heure, il la conjura de se laisser mettre à Versailles pour y être toute à lui ; cette parole effraya la vertu de la jeune fille et l’avertit du danger qu’elle courait. Louis XIII ne renouvela jamais la proposition qui lui était échappée, mais Mlle de La Fayette s’en souvint, et elle résolut de mettre un terme à cette situation difficile d’une façon digne du Roi et d’elle-même : elle songea à entrer en religion. Cependant elle n’avait cessé d’exhorter le Roi à se réconcilier avec la Reine et à secouer le joug de Richelieu. Ainsi, quand tout le monde, depuis Mathieu Molé jusqu’à M. le Prince, fléchissait et tremblait devant l’impérieux cardinal, deux jeunes filles, sans fortune et placées presque sous sa main, lui résistèrent. En vain il essaya de gagner Mlle de La Fayette, il ne réussit pas mieux auprès d’elle qu’auprès de Mlle de Hautefort. Il eut recours alors à ses manœuvres accoutumées : il fomenta les scrupules des deux amants, et, après bien des luttes que Mme de Motteville a racontées, Mlle de La Fayette se retira au couvent des filles de Sainte-Marie de la Visitation, rue Saint-Antoine. Le Roi alla l’y voir pendant plusieurs mois. La noble religieuse lui parla à travers la grille du cloître avec plus de force encore et d’autorité que dans leurs anciennes entrevues ; elle ne put rien sur sa politique, mais elle l’adoucit un peu envers sa femme, et c’est un soir, en revenant du couvent de la rue Saint-Antoine que, forcé par un orage de ne pas retourner à Saint-Maur, et de passer la nuit au Louvre où était la Reine, Louis XIII donna Louis XIV à la France.
Mais, depuis la retraite de Mlle de La Fayette, et jusqu’au jour où la grossesse d’Anne d’Autriche parut et mit un terme ou du moins apporta quelque adoucissement à ses malheurs, les plus étranges évènements s’étaient accomplis : la Reine avait été à deux doigts de sa perte, et elle n’avait été sauvée que par l’intrépide dévouement de sa jeune et fidèle amie Marie de Hautefort.
L’année 1637 est la plus triste et la plus douloureuse que la reine Anne ait eu à traverser. Jamais Louis XIII ne l’avait à ce point délaissée et elle n’avait conservé autour d’elle qu’un très petit nombre de serviteurs et d’amis dont elle s’était fait une petite cour intime, où encore l’œil vigilant du cardinal parvenait souvent à pénétrer. Au premier rang de ces rares courtisans de l’infortune était La Rochefoucauld, tout jeune encore, et qui, plein des sentiments que son père lui avait inspirés contre Richelieu, en débutant dans le monde, embrassa d’abord le parti des mécontents et la cause d’Anne d’Autriche. Lui-même a raconté quel agrément il trouvait alors à servir une reine sans crédit, mais environnée de femmes charmantes, et quelle liaison il forma avec Mlle de Hautefort, dont il célèbre la surprenante beauté, ajoutant, comme s’il avait peur de la compromettre, qu’elle avait beaucoup de vertu. Nous pouvons écarter le voile de ce langage incertain, et nous ne voyons pas pourquoi La Rochefoucauld, si peu réservé, hélas ! sur un point bien autrement délicat, montre ici quelque embarras à nous dire qu’il devint amoureux de la belle Marie. C’est peut-être qu’il eût fallu avouer que, loin d’être accueillie, cette passion dut se borner à une adoration respectueuse, selon les mœurs de la galanterie du temps, ou plutôt selon le goût particulier de l’héroïne. La Rochefoucauld aima Mlle de Hautefort sans oser le lui dire ; mais quelque temps après, étant à l’armée et à la veille d’une bataille, il alla trouver le marquis de Hautefort avec lequel il servait, lui fit confidence de sa passion ; et lui donna une lettre pour sa sœur, en-lui faisant promettre que, s’il périssait dans le combat, il la lui remettrait et lui dirait de sa part ce qu’il ne lui avait jamais dit, et que, s’il n’était pas tué, il lui rendrait sa lettre à lui-même et lui garderait fidèlement son secret. C’était là comme on faisait la cour à Mlle de Hautefort. Ce n’est pas ici d’ailleurs le temps de parler de ses conquêtes ; celui où nous en sommes arrivé n’était pas la saison des amours, et des choses plus sérieuses et presque tragiques se passaient dans l’intérieur de la Reine.
Lasse de souffrir, Anne d’Autriche rêva quelque entreprise désespérée pour sortir d’embarras, ou du moins elle intrigua avec Mme de Chevreuse, alors reléguée en Touraine, et entretint une correspondance plus qu’équivoque avec ses deux frères, le cardinal Infant et le roi Philippe IV, pendant que, l’Espagne était en guerre avec la France. Un de ses domestiques qu’elle employait à cette correspondance, et qui avait tous ses secrets, La Porte, fut arrêté, jeté dans un cachot de la Bastille, soumis aux plus terribles épreuves. Après avoir commencé par tout nier avec la plus étonnante assurance, la Reine, pressée par Richelieu et par des indices irrécusables, craignant les derniers malheurs, fit de grands aveux, que nous connaissons bien aujourd’hui, et qui, tout graves qu’ils sont déjà, ne devaient pas être complets, car s’ils l’eussent été, la Reine n’avait qu’à faire dire tout simplement à La Porte par le chancelier Séguier, et par une lettre de sa propre main, de déclarer tout ce qu’il savait, tandis qu’elle tint une conduite bien différente. Elle considéra son salut comme suspendu à deux fils : il fallait que, selon le tour que prendrait l’affaire, Mme de Chevreuse pût fuir rester ; il fallait surtout que La Porte, dans ses interrogatoires, ne dépassât pas les aveux de la Reine, et aussi qu’il avouât tout ce qu’elle avait avoué, pour donner à leurs déclarations communes une parfaite vraisemblance. La Porte intimidé pouvait en dire trop, ou sa constance à tout nier pouvait inspirer des ombrages ; la Reine craignait tout ensemble son énergie et sa faiblesse. Un concert secret était nécessaire, mais comment l’obtenir ? Comment arriver jusqu’à La Porte, enseveli dans un cachot de la Bastille ? Comment même prévenir Mme de Chevreuse, ignorante de ce qui se passait, et qui pouvait à tout moment être arrêtée ? C’est alors, si on en croit La Rochefoucauld, que la Reine, dans les angoisses de sa première terreur, se croyant menacée d’être répudiée, déchue de tout droit, enfermée dans quelque couvent ou même dans le château du Havre, qui était à Richelieu, lui aurait proposé de l’enlever, elle et Mlle de Hautefort, et de les conduire à Bruxelles ; proposition trop extravagante pour avoir été faite sérieusement, et que La Rochefoucauld ne rapporte sans doute que pour peindre le danger du moment et aussi pour relever son importance. C’eût été jouer précisément le jeu du cardinal, comme l’avait fait Marie de Médicis ; il fallait rester, tenir tête au péril, et le conjurer à force d’adresse et de courage.
Dans cette grave conjoncture, Marie de Hautefort entreprit de sauver sa maîtresse ou de se perdre avec elle. Déjà elle lui avait sacrifié la faveur du Roi, celle de Richelieu, son avenir, elle qui n’avait rien que sa beauté et son esprit, et qui aimait naturellement la magnificence et l’éclat ; elle fit plus cette fois, elle risqua pour elle quelque chose qui lui était mille fois plus cher que la fortune et la vie, elle risqua sa réputation ; elle rejeta cet instinct de pudeur et de retenue qui faisait son charme et sa gloire, qui jusque-là avait fermé son oreille à tout propos flatteur, et ne lui avait pas même permis d’écrire, sous quelque prétexte que ce fût, le moindre billet à aucun homme ; et la superbe créature se condamna au rôle le plus opposé à tous ses goûts et à toutes ses habitudes. D’abord elle persuada à un gentilhomme de ses parents, M. de Montalais, d’aller à Tours dire à Mme de Chevreuse où les choses en étaient, de ne pas remuer, tout en prenant ses précautions, et qu’on l’avertirait de fuir ou de rester, en lui adressant des Heures reliées en rouge ou en vert, selon le parti qu’il faudrait prendre. Puis elle-même, elle se déguise en grisette, barbouille son beau visage, cache ses blonds cheveux sous une grande coiffe, et de grand matin, quand personne n’est encore éveillé au Louvre, elle en sort à la dérobée, prend un fiacre et se fait conduire à la Bastille. Elle savait qu’il y avait là un prisonnier qui déjà une fois avait joué sa tête pour la Reine, déployé dans les fers une constance magnanime, et venait à peine de descendre de l’échafaud, François de Rochechouart, alors chevalier, depuis commandeur de Jars. Il commençait un peu à respirer de cette terrible épreuve ; on lui laissait quelque liberté, et il pouvait recevoir quelques personnes. La noble fille, jugeant du chevalier par elle-même, crut qu’elle pouvait lui demander de jouer sa tête une seconde fois. Elle se donna pour la sœur de son valet de chambre, qui venait lui apprendre que cet homme était à la mort, et l’entretenir de sa part de choses pressantes. Le chevalier de Jars, qui savait son domestique en bonne santé, répugnait à se déranger pour une telle visite, et l’altière Marie de Hautefort dut attendre quelque temps dans le corps de garde qui était à la porte de la Bastille, exposée aux regards et aux plaisanteries de tous ceux qui étaient là, et qui, à son costume, la prenaient pour une demoiselle très équivoque. Elle supporta tout en silence, appliquant bien ses mains sur sa coiffe pour qu’on n’aperçût pas sa figure et ses yeux. Enfin le chevalier de Jars se décida à venir. Ne la reconnaissant pas d’abord, il allait la traiter assez mal, lorsque, le tirant à part et entrant avec lui dans la cour, pour toute réponse à ses propos, elle leva sa coiffe et lui montra cet adorable visage qu’on ne pouvait oublier quand on l’avait vu une fois : « Ah ! madame ! est-ce vous ? » s’écria le chevalier. Elle le fit taire, et lui expliqua en peu de mots ce que la Reine lui demandait. Il s’agissait de faire parvenir à La Porte une lettre cachetée, où on lui marquait jusqu’où il pouvait et devait aller dans ses déclarations. Elle remit cette lettre au chevalier en lui disant : « Voilà, monsieur, ce que la Reine m’a donné pour vous ; il faut employer votre adresse et votre crédit dans ce lieu-ci pour faire arriver cette lettre jusqu’à ce prisonnier. Je vous demande beaucoup, mais j’ai compté que vous ne m’abandonneriez pas dans le dessein que j’ai de tirer la Reine de l’extrême péril où elle est. » Le chevalier, tout intrépide qu’il était, fut bien étonné de voir qu’il était question de hasarder de nouveau sa vie. Il balança, il songea longtemps. Mlle de Hautefort, le voyant chanceler, lui dit : « Eh quoi ! vous balancez, et vous voyez ce que je hasarde ! car, si je viens à être découverte, que dira-t-on de moi ? » – « Eh bien ! lui répondit le chevalier, il faut donc faire ce que la Reine demande ; il n’y a point de remède ; je ne fais que sortir de l’échafaud, je vais m’y remettre. »
Mlle de Hautefort fut assez heureuse pour n’être pas plus reconnue en rentrant au Louvre que le matin lorsqu’elle en était sortie. Elle retrouva dans un petit endroit auprès de sa chambre la fille qu’elle y avait mise en sentinelle avant de partir, afin que, si le Roi, passant près de là pour aller à la messe, demandait de ses nouvelles, on ne manquât pas de lui dire que, s’étant trouvée un peu mal la nuit, elle reposait encore. Mais, quand elle fut dans sa chambre, et qu’elle réfléchit à l’aventure qu’elle venait de courir, elle en fut épouvantée : la jeune fille modeste remplaça l’héroïne, et elle tomba à genoux pour remercier Dieu de l’avoir conduite et protégée.
Le chevalier de Jars fit des merveilles. Sa chambre était de quatre étages au-dessus du cachot de La Porte ; il perça son plancher, et fit passer la lettre de la Reine au bout d’une corde, avec prière au prisonnier de la seconde chambre d’en faire autant, puis successivement jusqu’à la dernière où était La Porte, en recommandant bien le plus profond secret. C’est ainsi que la lettre de la Reine arriva parfaitement intacte aux mains du fidèle valet de chambre. Chose admirable qu’une manœuvre si difficile, si compliquée, et qui dura plusieurs nuits, se soit accomplie sans qu’aucun des geôliers s’en soit aperçu, et sans qu’aucun de ceux qui y prirent part l’ait compromise par la moindre indiscrétion ! En sorte que ce prisonnier si bien gardé, dans un cachot et derrière des portes de fer, reçût une instruction détaillée, qui le mit en état de se justifier lui-même et de justifier sa maîtresse. La fermeté qu’avait d’abord montrée La Porte eût tourné contre la Reine, si à la fin elle n’eût été éclairée et guidée par la lettre qui parvint jusqu’à lui, grâce à la courageuse industrie du chevalier de Jars, dont le dévouement était dû à celui de Mlle de Hautefort.
Dès que celle-ci avait espéré le succès, elle s’était empressée d’envoyer à Mme de Chevreuse, selon ce qui avait été convenu, des Heures à la couleur favorable qui devait la rassurer et la retenir. Se trompa-t-elle sur la couleur, ou Mme de Chevreuse s’y méprit-elle elle-même ? À tort ou à raison Mme de Chevreuse entendit que tout allait mal ; et, comme ce qu’elle redoutait le plus au monde était la prison, elle se hâta de fuir déguisée en homme, et alla chercher un asile en Espagne, où le frère d’Anne d’Autriche l’accueillit presque comme autrefois, dans son premier exil, l’avait reçue le duc de Lorraine. Cet évènement, arrivé un peu avant les derniers interrogatoires de La Porte, ranima et porta à leur comble l’irritation et les soupçons de Richelieu. On redoubla de sévérité envers la Reine ; La Rochefoucauld, que Mme de Chevreuse avait vu un moment en passant à Vertœil pour lui demander des chevaux, fut mis quelques jours en prison, et on ne sait trop comment la chose aurait tourné, si La Porte, en ayant l’air de céder à l’ordre officiel que la reine lui envoya de tout dire, n’eût admirablement confirmé les déclarations de sa maîtresse dans la mesure concertée, et par là persuadé au cardinal et au Roi que toute cette affaire n’était pas aussi importante qu’ils l’avaient jugé d’abord.
Est-il besoin de dire de quelle vive reconnaissance la Reine fut pénétrée pour Jars, pour La Porte, et surtout pour sa jeune et intrépide amie, et quelles promesses elle lui fit, si jamais elle voyait de meilleurs jours ? Mais Marie de Hautefort avait déjà reçu sa récompense. Elle avait senti battre dans son cœur l’énergie qui fait les héros ; elle s’était oubliée pour une autre ; elle s’était mise avec l’opprimée contre l’oppresseur ; elle avait été compatissante, charitable, généreuse, chrétienne enfin, selon l’idée qu’elle s’était faite et qu’elle soutint jusqu’à son dernier soupir de la religion du crucifié.