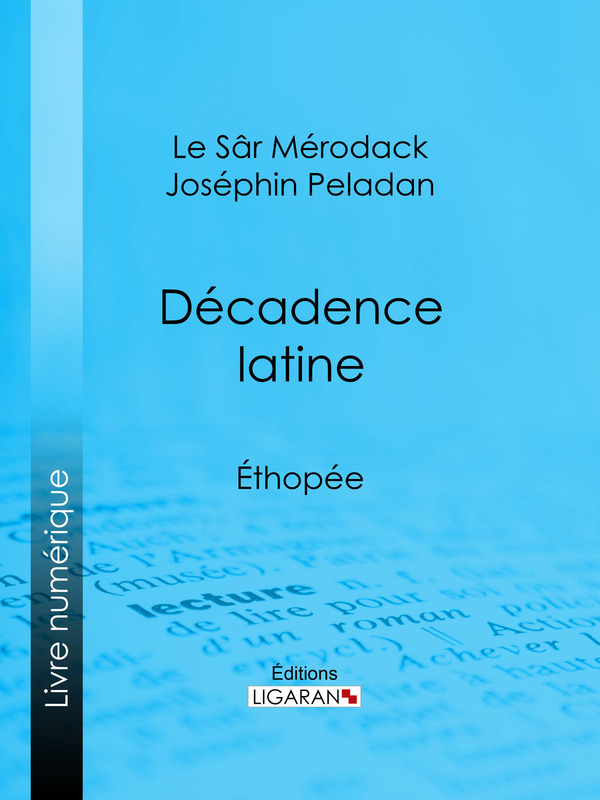
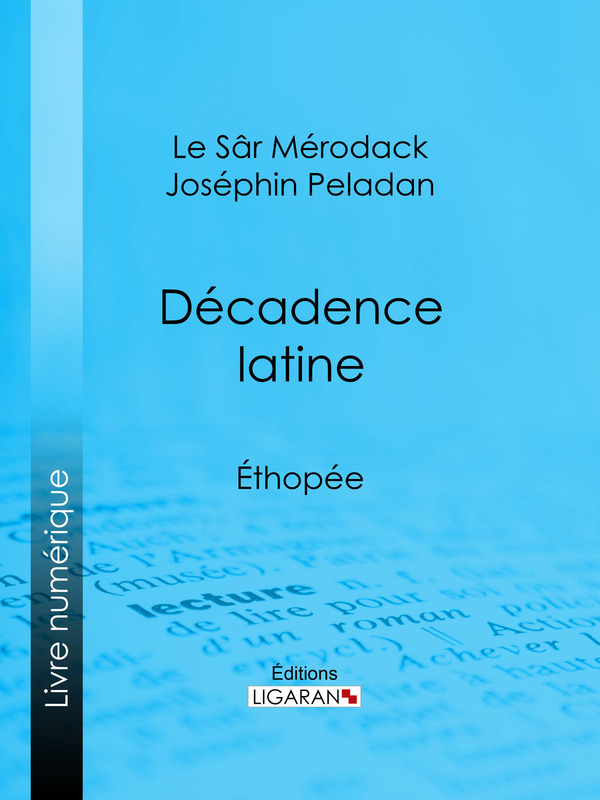
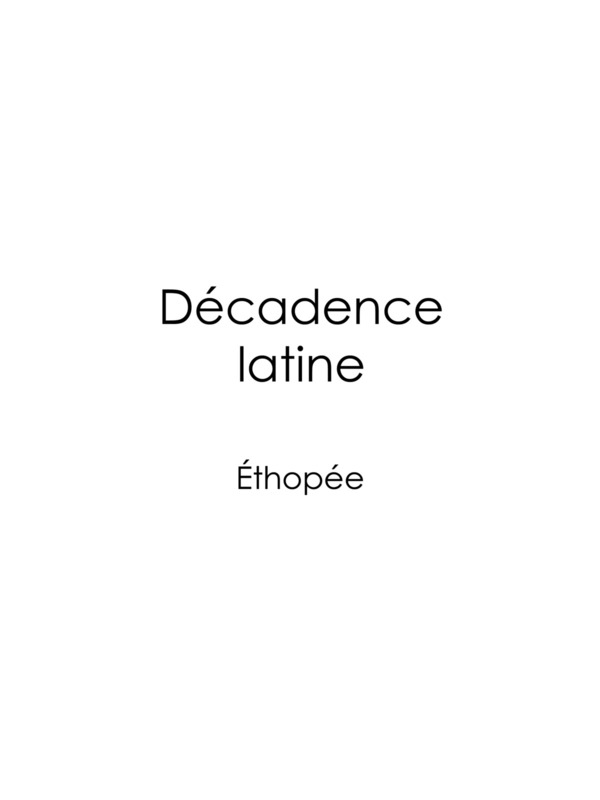
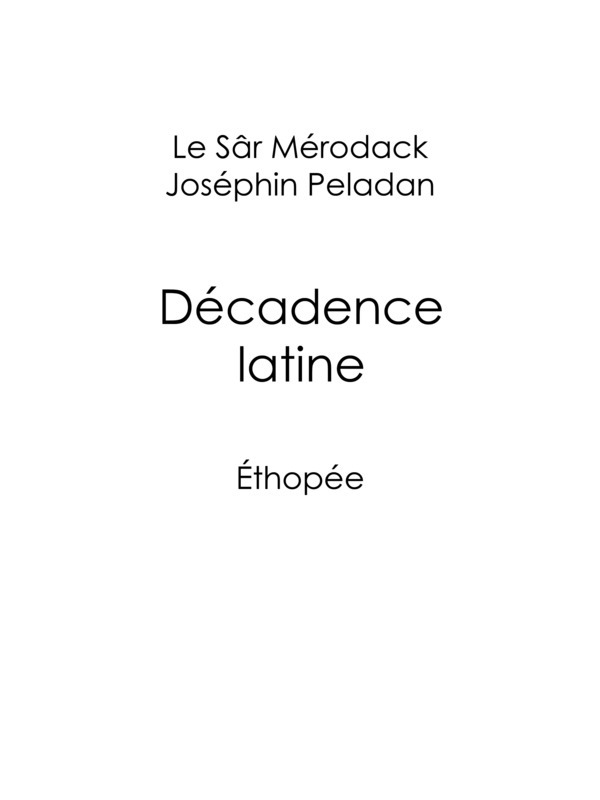
Le nimbe est ce cercle lumineux, souvent doré, dont l’art entoure la tête des saints.
L’héroïne de ce livre accomplit le grand œuvre de la sainteté, elle se sacrifie pour le soulagement de beaucoup : c’est une mystique de la pitié et de la justice.
Mais la nature de son sacrifice répugnerait tellement aux hagiographes que son nimbe doit être noir, comme celui d’une Judith de Béthulie, d’une Esther et plus près de nous d’une Charlotte Corday. Ces femmes livrèrent leur beauté pour le rachat de leurs frères.
Assombri, le signe de la sainteté réunit les deux notions d’héroïcité et de péché, sans contredire ni à la vérité ni aux traditions de notre race.
Mes yeux revenaient obstinément au petit médaillon qu’il portait en épingle de cravate. Ce n’était pas un bijou : un cercle de fer de la grandeur d’un sou entourant un verre. On ne distinguait rien sur l’espèce de parchemin clair, propre à une inscription kabbalistique. Mon interlocuteur, un des héros de la Révolution russe, n’avait jamais eu le loisir de s’intéresser au gnosticisme et à ses amulettes.
– « Pourquoi », me dit-il avec cette douceur si étonnante chez un homme d’action tragique, pourquoi ne me faites-vous pas la question qui vous brûle les lèvres ?
– « Les hommes de votre sorte », répondis-je, « sont pleins de secrets terribles ou douloureux : et on leur doit le silence de sa curiosité pour ne pas éveiller peut-être d’affreux souvenirs. »
Il sourit tristement et dit :
– « C’est une relique ! »
Comme X… est un chrétien de charité mais non d’obédience, un chrétien d’action et non de dévotion, je m’étonnai.
– « Croyez-vous », dit-il, qu’il n’y ait des saintes que dans l’Église et selon le type ecclésiastique ? En quoi consiste la Sainteté, selon vous ?
– « En l’imitation de Jésus-Christ », lui dis-je brièvement ; et, à mon étonnement, il accepta la définition d’un signe de tête.
– « Jésus a donné sa vie pour les Juifs : celle, dont vous voyez une parcelle de peau, a donné sa beauté pour la justice et pour les Russes.
– Ah ! », fis-je, « vous portez la relique d’une sainte révolutionnaire !
– Oui, d’une sainte… Oh ! » fit-il, « jamais les prêtres ne comprendront l’âme humaine, ni ses beautés spontanées… Vous autres romanciers vous racontez sans lassitude comment des femmes en chiffons et des hommes de carton employèrent leur cinq à sept : vous n’avez de l’encre que pour ce fait divers, l’adultère, non pas tragique et mortel, mais usuel et polisson… Vraiment, il se passe sur la terre d’autres choses que les petits frissons des mondains ; il existe d’autres âmes que celles de marionnettes, des Parisiens… Écoutez une histoire que le Moyen Âge aurait mise dans sa Légende dorée. »
Le temps moderne est aussi aventureux que l’ancien : mais nous ne concevons l’aventure que sous les aspects d’autrefois.
Le logis ressemble à ces eaux fortes trop noires où la pointe a exagéré le clair-obscur Rembranesque, ne laissant qu’une zone très circonscrite à la lumière.
Dans le cercle projeté par la lampe à l’abat-jour baissé, des mains tiennent un livre, des mains très belles, longues, blanches, patriciennes ; et le livre est banal et sali.
Une tête juvénile, abondamment casquée de cheveux clairs, se penche, attentive.
La vaste pièce obscure, aux meubles grossiers, au grand poêle, dort lourdement.
D’une alcôve indistincte à une extrémité, s’élève, par instants, le souffle d’un sommeil pénible.
Derrière les vitres on aperçoit les arbres givrés d’un âpre soir d’hiver.
Ces mains, étincelantes dans la clarté, semblent dépaysées au milieu de ce décor sordide.
Leur perfection contraste avec le milieu, et leur netteté atteste des soins minutieux.
Elles brillent, vermeilles sur la table grossière, semblables à de nobles lys au bord d’une route, en un blasonnement d’énigmatique infortune.
Le chef-d’œuvre, encore inaperçu chez le brocanteur où il est échoué, se détache plus extraordinaire parmi les guenilles et les ferrailles ; ainsi, cette liseuse de rêve ou de légende, dans la pénombre du triste logis, resplendit.
Quelle circonstance d’amour ou d’intrigue amena cette jeune fille dans ce réduit de faubourg ? Sa robe de lainage noir, effilochée aux poignets, luisante au coude, accuse la même misère qui l’environne. Ce n’est pas une passante ; et sa façon tranquille de tourner les feuillets du bouquin graisseux, prouve qu’elle vit dans cette ambiance de dénuement depuis longtemps, et qu’elle y est résignée.
Les âmes exhalent, comme les corps, un fluide sain ou maladif : un sensitif percevrait ici une atmosphère de fatalité, plus tragique que le tableau de pauvreté qui affecte les yeux.
Dans le silence de neige que troublent à peine la respiration de l’alcôve et le tournement des pages, imperceptible, insaisissable mais incessante, la destinée sombre fait entendre une basse de menace, le très lointain murmure de l’Ananké.
Un frappement de plusieurs coups, conventionnellement espacés, interrompit la lecture.
Svelte et d’une démarche plus noble qu’élégante, elle alla vers la porte et l’ouvrit doucement. Tandis que du doigt posé sur la bouche elle imposait silence à l’arrivant, qui atténua le bruit de ses bottes et quitta sa touloupe, la jeune fille reprenait sa place sous la lampe.
– « Schaebolof, qu’as-tu à me dire ? » demanda-t-elle.
Celui-ci ôta son bonnet fourré et découvrit ce front démesuré et inquiétant du Slave idéologue ou fanatique qui recèle ou la cervelle d’un sultan asiatique, d’un Pobedonostzev ou celle détraquée d’un Bakounine.
Maigre et las, sentant la bohème et la prison, mi-parti professeur et malfaiteur, il promenait autour de lui ce regard de l’illuminé politique, qui ne voit pas le monde extérieur, en proie à l’hallucination.
Elle attendit qu’il eût apporté un escabeau.
Schaebolof voûta le dos et parut étudier le plancher rugueux. Devant ce mutisme, elle rouvrit son livre.
Les belles mains tenaient de nouveau le volume aux pages poisseuses et cornées et il semblait plus sordide entre ces deux fleurs de chair vivante, pour supports.
Ce Schaebolof, dans l’intimité d’une si noble personne, contrastait comme si, en face de la Modestie de Léonard, eût surgi quelque figure de bassesse et de désespoir : un peintre pervers voulant mettre en présence une femme d’allégorie et un déclassé moderne.
Ses yeux ardents de maniaque contemplaient-ils l’infranchissable distance qui le séparait de la fille aux mains splendides ?
Sa prunelle se colorait d’ardeur et de colère, d’admiration et de dépit, et sa bouche souriait de cette façon effrayante qu’on ne voit qu’aux désespérés sur la table de la Morgue, muet blasphème, suprême juron du lamentable mortel écrasé par l’implacable Norme.
Au fond, dans l’alcôve, on dormait comme sous la lampe on lisait ; et le silence roulait ses ondes froides et noires autour de Schaebolof fiévreux de parler et visiblement appréhensif.
L’indifférence de la liseuse l’irritait. Ce qui lui brûlait la lèvre ne rencontrerait qu’une oreille hostile. Commensal de ce logis, il avait souvent ravalé sa parole et maintenant, à la suite d’une résolution, il s’entêtait, sans illusion sur l’issue, par orgueil.
– « Sophia ! » dit-il d’une voix sourde et timbrée d’humeur. Elle refit le geste qui commandait le silence, montrant l’alcôve d’un mouvement de tête.
Schaebolof mêla ses longs doigts avec embarras et nervosité et, à voix très basse :
– « Sophia, tu me dédaignes ! Ton attitude de Barinia me repousse, non pas quelquefois et parce que je te déplais, mais toujours. Que je me taise ou que je parle, ton dédain tombe sur mes épaules comme un knout invisible. Pourquoi ? De ceux qui t’entourent, qui me vaut ? Personne ! Je suis une tête et je suis un bras : je pense et je frappe, je conçois et je tue ; je sais faire couler l’encre et le sang ; je suis homme, Sophia, un homme complet : je peux faire un cours et un coup, sociologue et chimiste militant ! De ceux qui ont veillé sur toi nul n’a fait plus que moi ! Je t’ai donné une instruction égale à celle du gymnase impérial : je t’ai ouvert le monde mystérieux du livre, de la chose écrite qui contient la vérité. Je t’ai prodigué ce que je possède : la science ; les autres n’ont apporté que des friandises ou des rubans : enfin, si tu es une fille accomplie, tu le dois à Schaebolof. »
Il arrêta la réplique d’un geste brusque :
« Un préjugé, que rien n’a pu détruire, s’oppose à ce que tu me rendes justice. L’atavisme, l’effrayant héritage qu’on ne répudie pas et qui oblige l’âme plus encore que l’organisme ; l’atavisme, qui fait du tzar le bourreau de cent vingt millions d’hommes et de cinq cent mille autres les valets de ce bourreau, l’atavisme te possède, te meut, t’enchaîne !
Voilà pourquoi la mort des uns est le seul espoir des autres. Si j’avais eu besoin d’une confirmation à ma théorie, la seule véridique, certes tu me la fournirais ! L’homme n’oublie rien, il garde son sens d’espèce comme l’animal son instinct. Un barine sentira toujours comme un barine : et pour que le moujick vive, il faut que les barines meurent. »
La jeune fille écoutait sans étonnement cette déclaration d’amour où passait la vanité du démagogue, où le dépit passionné et les thèses révolutionnaires s’enchevêtraient.
– « Sophia… tu n’es pas des nôtres. Une lame de la vie t’a jetée sur la côte de misère ; tu as grandi parmi les déshérités et les révoltés, tu les appelles tes frères. Tu es la princesse Sophia Nariskine Mentchikoff, fille d’un grand Chambellan du tzar Alexandre. Ta mère naquit également d’une vieille souche. Oui, tu es princesse, fille de princesse ; tu appartiens à la race conquérante et guerrière. Tes ancêtres faisaient donner le knout aux miens. Est-ce que j’ai des ancêtres, moi, moi, serf, fils de serf ?
– Plus bas… Tu vas réveiller la Petrowna », fit la jeune fille.
– « La Petrowna !… » grogna sourdement Schaebolof, « la vieille sorcière ! Ah ! celle-là est bien ta nourrice. Elle ne t’a pas seulement allaitée, elle a pétri ton cœur, elle l’a pressé, comprimé jusqu’à ce que la tendresse en fût sortie ! Si tu es incapable d’aimer, c’est son ouvrage.
– La Petrowna fut fidèle à ma mère dans la détresse. La Petrowna m’aime comme sa fille. Il faut que tu sois bien fou pour t’attaquer à elle, à elle qui m’est plus chère que le reste de l’humanité. Elle m’a sauvé du même péril où ma mère a succombé, après quel martyre, grand Dieu ! »
Schaebolof étouffa une exclamation sarcastique.
– « L’atavisme, toujours l’atavisme !… la Petrowna a été la serve, la nourrice d’une princesse et, malgré que ses fils soient morts en Sibérie, malgré que sa fille ait été éventrée par les cosaques, malgré que la chair née de sa chair ait été déchiquetée aux mille baguettes de l’allée verte, malgré sa haine du tzar et de ses limiers, elle vénère en toi sa barinia, tu l’appelles mère et elle se sent toujours ta servante. Ce qu’elle a dit, elle le ferait : si l’un de vous touchait à Sophia, je lui crèverais les deux yeux ! »
– « Eh bien ? » dit Sophia, « parole généreuse. De quel droit toucherait-on à Sophia ? Ne suis-je pas maîtresse de moi-même ? »
Schaebolof baissa les yeux, mais il formula nerveusement :
– « Aucun être n’a le droit de vivre pour lui, de conserver sans l’utiliser intelligence, beauté ou fortune, alors qu’autour de lui d’autres êtres ont besoin de cette intelligence, de cette beauté, de cette fortune !
– Schaebolof, tu n’es qu’un fou, un pauvre fou ! On peut tout demander à quelqu’un, sauf lui-même !
Je donne mes soins à qui les réclame, je donnerais ma fortune, si j’en avais, jusqu’au dernier kopeck : mon corps m’appartient.
– Non », fit l’illuminé, « ta beauté représente beaucoup plus que de l’intelligence et de l’or, ta beauté représente du bonheur. En t’abandonnant comme femme, tu serais plus généreuse qu’en distribuant un trésor.
– Vraiment, tu veux que je me distribue !…
– Ta beauté passera inutile. N’est-elle pas destinée à consoler un être ?
– Cet être s’appelle Schaebolof ? » fit Sophia ironique.
Il releva son front démesuré et, du ton d’une certitude profonde :
– « Je suis le plus digne. »
Sophia enveloppa d’un regard le lamentable déclassé.
– « Toi, qui sais quelque chose sans être un savant, toi qui as osé quelquefois sans être un héros ; toi, qui ne peux t’imposer comme chef à d’autres de ton espèce et qui es seul à t’apprécier, tu t’étonnes que le tzar, entouré de courtisans, acclamé par un peuple, dise la même parole. Il croit qu’il est le plus digne ; tout le lui dit, depuis l’atavisme jusqu’au réel. Mais toi, petit professeur, qui t’a persuadé de ta dignité ? tu affirmes toujours et ne prouve jamais ; à la contradiction tu souris de ce sourire entêté qui vous marque tous comme une grimace d’espèce. Le singe se croit gracieux sans doute, il est singe cependant. Au reste, Schaebolof, une bonne fois, je te parlerai à cœur ouvert. Écoute, afin que nous puissions vivre en bonne harmonie. »
L’illuminé fronça les sourcils.
– « Je prévois ce que tu vas dire, Sophia ; je te déplais ; sordide, grisonnant, je te répugne. La misère, la souffrance m’ont marqué ; et aussi mes idées qui devancent les siècles offusquent tes traditions. Ah ! ma pensée est en avance sur tout ce qui a été écrit : je pense comme on pensera en l’an 2000. Les précurseurs ont été méconnus ; on a crucifié Jésus, et Sophia me dédaigne ! »
Elle haussa les épaules.
– « Es-tu un homme, Schaebolof ? Es-tu un chien ? C’est la même question : ose donc répondre ?
Ce qu’est un homme à mes yeux ? Le plus laid des animaux ! Avec son visage de désir, celui que je vois toujours, l’homme me paraît hideux. Il a honte de ce qu’il pense et n’ose le dire ; sa parole s’embrouille, s’exagère ; tandis qu’il feint de penser, l’instinct seul le meut, le tenaille. Tu as la contenance d’un voleur, Schaebolof. Tu voudrais me prendre ce que je ne veux pas donner. Avec plus d’audace tu saisirais ma main et tu t’élancerais sur moi comme un brigand. Ce désir qui projette sur la face de l’homme le brutisme et la violence des fauves, ce désir change en larron et en scélérat le plus honnête. Avec toi, dans une forêt, je ne serais pas en sécurité : ici, la Petrowna te fait peur. Tu es bien un homme, tu es un chien, Schaebolof !
Si j’ignorais l’affreux secret de l’amour, si j’étais innocente, je pourrais, peut-être par compassion, et comme on cède à un enfant qui pleure ou à un fou qui fait pitié, plaindre cette souffrance du désir : mais la Petrowna m’a répété une leçon plus précieuse que les tiennes : elle m’a révélé que pour la femme la liberté s’appelle la chasteté. Elle m’a peint, avec la puissance du témoin, les effroyables tortures subies par ma mère et, chaque fois qu’elle recommence son récit, je me sens plutôt prête pour la Sibérie que pour l’amour. Se donner à un être qu’on n’aime pas, c’est-à-dire me donner à Schaebolof, ce serait absurde et affreux : se donnera un être aimé, c’est pis encore. Ma pauvre mère n’a pas eu d’autres torts que d’aimer mon père, et elle en est morte.
– Ton père, Sophia, était un de ces généraux…
– C’était un homme, ni bon, ni mauvais, un homme comme les autres : il éprouvait plus vivement et plus fréquemment cet appétit qui te meut à cette heure, Schaebolof !
Or, cet appétit qui passe pour la manifestation de l’amour est au contraire sa négation, c’est lui qui entraîne au changement, et d’une façon fatale. Donne à quelqu’un des sterlets, rien que des sterlets ; au bout de peu de temps il préférera la plus grossière nourriture. Mon père ne pouvait se condamner au sterlet et ma mère fut malheureuse indiciblement, pour cette simple question.
– Moi », protesta le libertaire, « je serais fidèle !
– Ta fidélité n’intéresse qu’une femme éprise. Mais l’amour a d’autres conséquences ! L’enfant ! Ce n’est pas toi qui le porteras, ce n’est pas toi qui accoucheras au péril de ta vie ou de ta santé ; ce n’est pas toi qui l’allaiteras. Tu vas me dire, laissons la grossesse, image peu séduisante pour ma beauté. N’envisageons que toi. Parce que je t’aurai satisfait aujourd’hui, je serai à ta discrétion demain, toujours ; et si tu pars, je te suivrai, tyran qui ne peux te masquer, au moment où tu veux persuader et séduire.
– Je hais la tyrannie… » protesta-t-il.
– « Si tu étais un chien, je te croirais : tu es un homme et l’homme naît tyran.
– L’homme naît bon !
– Non, Schaebolof, les théories basées sur la bonté de l’homme sont fausses. Si tu étais tzar, tu me violerais. Dans la mesure de ton impuissance, tu m’opprimes, tu n’as que des mots à ta disposition et tu les emplois. Tu t’apitoies sur les tortures de tes frères les nihilistes et tu as raison : mais tu ne penseras pas, si tu lances une bombe, aux innocents que tu vas peut-être frapper. Si tu réfléchissais au lieu de rêver, tu saurais que les hommes qui passent enchaînés, allant aux mines de Sibérie, ne sont guère plus mauvais que ceux qui les regardent. La vodka, un accès de colère, en plus ou en moins, voilà la différence. Si tu buvais, il faudrait te chasser. Tu as un mauvais estomac, tu es sobre. Veux-tu une preuve que l’être humain est méchant : écoute-moi bien. Si j’avais des domestiques, je t’aurais déjà fait jeter dehors. Tu m’exaspères : je déteste ton esprit faux, ta vanité ridicule.
– C’est bien la barinia qui parle. Je vois le kakocnick, l’ancien diadème, sur ta tête et la sarafane blanche brodée d’or…
– Tu vois que tu m’as lassée de ta poursuite pédante et obstinée.
– La misère, le bagne m’ont fait perdre, je l’avoue, ce qu’on appelle les avantages physiques et je ne sais pas faire ma cour comme un officier de la garde : ce n’est pas l’amour lui-même que tu repousses…
– C’est l’amour lui-même ! As-tu rêvé que je me donnerais à toi ?
– On rêve ce qui charme : tous ceux qui t’ont approchée ont fait ce rêve. Élevée parmi nous, ne dois-tu pas fatalement appartenir à l’un de nous ? J’ai été le plus intime par mes leçons et aussi par tes bontés. Tu as soigné mes blessures de façon si douce, si tendre, que j’ai cru à une préférence…
– Quand tu souffrais, tu m’étais cher ; j’ai pansé et lavé tes plaies, sans répugnance, mais je ne laisserais pas ma main dans la tienne. »
Schaebolof passa ses longs doigts sur son front ; il ne comprenait pas, Sophia accusa sa pensée.
– « Je panserais des ulcères, je laverais un lépreux et je ne caresserais pas l’homme le plus semblable aux marbres de l’Ermitage. Déplore cette disposition de ma nature, mais garde-la en ta mémoire pour régler ta conduite. Les autres me regardent avec désir, c’est vrai, mais ils voilent ce désir, toi tu le manifestes et tu m’offenses.
– La Barinia !
– Je ne veux plus voir un homme me guetter comme un loup à la lisière d’un village et se demander sans cesse s’il ne court pas trop de risques à me dévorer.
– La Petrowna t’a raconté des histoires d’ivrognes, de débauchés ; elle ne t’a pas dit que l’amour résume la vie !
– Crois-tu qu’on puisse arrêter le cours de la Volga ? »
L’expression du nihiliste devint dure et ses yeux brillèrent d’une lueur plus fiévreuse.
– « Crois-tu, Sophia, qu’on puisse arrêter le cours de la nature ? Ses lois nous dominent, ce sont les vraies, celles-là ! Si tu crois que l’homme naît méchant, salue cet appétit qui le détourne de la férocité. L’amour apaise les humeurs, c’est le modérateur des passions et le ferment des héroïsmes.
On ne discute pas une impression nerveuse, on en suscite une autre qui l’emporte. Tu ressembles à quelqu’un qui ne voudrait pas ouvrir un livre parce que la couverture serait rébarbative. L’amour matériellement engendre l’enfant et moralement il engendre l’homme, une seconde fois. Il le tire de son égoïsme, il l’incite au travail ici, et là aux grandes choses. La première fois que l’homme peina ce fut pour nourrir celle qui était belle et qui lui donnait la volupté ; la première fois que l’homme combattit l’animal terrible, celui qu’on ne mange pas, ce fut pour frapper d’admiration sa compagne. Rien n’a changé depuis l’époque préhistorique. Mes pensées attendent leur essor et mon cœur implore un surcroît de courage de ta tendresse, Sophia. Ne me blâme pas de te regarder, comme disent les popes, avec concupiscence, je vois en toi un autre Schaebolof, auprès duquel je ne suis qu’une chrysalide : je ne peux me conquérir qu’en te possédant et je ne prendrai conscience de moi-même que dans tes bras ! »
La jeune fille écoutait avec une curiosité qui trompa l’illuminé.
– « Que peut faire de plus grand une femme ? Un homme ! Et non par la lente élaboration organique, mais par le mystère de la volupté. Cette idée, si tu la presses, justifie le désir. Comment se fait-il que mon esprit soit sorti de moi et habite en toi ? Mon insistance ne s’inspire pas de mon égoïsme ; ma conscience me crie : Sophia est ton génie, ta muse d’action, ta Béatrice de doctrine, tu as droit à Sophia, au nom de ce que tu veux, au nom de ce que tu peux ! »
Telles paroles ne sont plausibles que dans le milieu où elles constituent pour ainsi dire le verbiage habituel. Ces minorités, vivant à l’écart et en guerre avec la société, adoptent une phraséologie, étonnante pour ceux qui là découvriraient à l’improviste. Sophia jugeait le libertaire fâcheux, insupportable mais non ridicule. L’individu, qui s’égale au faisceau des pouvoirs et s’estime un contre cent mille, brasse son orgueil à outrance, par la nécessité même, et ses rodomontades constituent une hygiène de la personnalité.
– « La Béatrice », répondit-elle, « ne donne au poète qu’un salut de courtoisie et un sourire !
– Tu me les refuses », s’exclama-t-il.
Assombri, il baissa la tête. Le souffle qui sortait de l’alcôve s’éleva plus bruyant. Sur le front du libertaire, des modelés se déplaçaient, attestant un mouvement intérieur intense. Soudain, il saisit une des belles mains qui avaient repris le livre. Une brutale résolution brilla dans ses yeux.
Jusqu’où allait cette résolution ? Voulait-il seulement prendre un baiser ! Sophia ne cria pas : elle savait quelle fureur arracherait à son lit la Petrowna et craignit pour la malade. Offensée plutôt qu’inquiète, elle opposa une face de mépris au visage convulsé de Schaebolof.
– « Chien ! » fit-elle froidement.
L’homme lâcha la main qu’il retenait comme si on eût frappé sur son bras. L’injure l’avait blessé autant qu’un coup, il geignit.
Hautaine, Sophia le défiait. Brusquement, il contourna la table et marcha sur la jeune fille.
Celle-ci, d’un mouvement du pied, poussa un escabeau dont la chute fit résonner le plancher. Une exclamation rauque partit de l’alcôve, les rideaux brusquement s’écartèrent et une figure échevelée de vieille femme s’agita.
Le libertaire, en proie à un vertige où la réflexion n’intervenait plus, avait saisi les deux bras de Sophia et, brutalement, s’efforçait de baiser son visage.
– « Petrowna ! » cria la vierge.
Une sorte de rugissement lui répondit ; et, fantastique avec ses cheveux blancs épars, sa maigreur apparente sous la chemise, la nourrice s’élança comme une furie, d’un bond atteignit l’homme et lui planta ses ongles dans la nuque avec une telle force que Sophia put se dégager.
– « Schaebolof ! » cria la vieille femme, « pourceau, excrément, ordure, fils de chien, crasse de bagne ! Schaebolof, cosaque, ignoble brute », et, vociférante, elle suivait les murs, cherchant un bâton, une arme. Tout à coup, elle courut à un coin sombre, décrocha un objet et le brandit.
– « La nagaïka ! » et la dure lanière siffla comme un reptile.
Schaebolof d’un élan gagna la porte.
– « Vite, recouche-toi, mère ! » dit Sophia en l’aidant à se remettre au lit.
La colère agitait ce vieux corps d’un tremblement visible.
– « Le misérable ! » murmura-t-elle entre ses dents serrées, « il ne sait donc plus qui est la Petrowna ? Je lui aurais fait sauter les deux yeux de l’orbite. Oui… Un garçon qu’on a apporté ici en morceaux. On l’a caché, on l’a soigné, on l’a guéri… et voilà sa reconnaissance… c’est un traître et il finira dans la police… S’attaquer à toi, à toi, Sophia !… Personne n’aurait osé, personne… même ceux qui boivent ; vraiment, violer la princesse Sophia Nariskine et devant la Petrowna ! Mais, même morte, je ressusciterais, pour te défendre et te venger. Ah Dieu !
– Il ne songeait peut-être qu’à m’embrasser, mais je n’ai pas hésité, mère, à te réveiller.
– T’embrasser ! Est-ce que tu es née pour essuyer le museau des chiens ! Ah ! ma fille, chaque fois qu’un homme te regardera, souviens-toi de ta mère ! Le mariage lui a été plus amer que les couvents de Sousdal et de Risopogenski où on coupe la langue, où on tenaille les narines… Cependant elle aimait le prince, et l’amour fait tout supporter, l’amour, cette folie qui change l’homme en bête, la femme en femelle, la vie en bagne. Je le dénoncerai aux autres qui l’assommeront, ce Schaebolof… Quoi, la princesse Sophia Nariskine servirait de paillasse aux khokols (paysans), Dieu juste ! que les hommes sont brutes !
– Calme-toi, mère », répétait la jeune fille.
La vieille continua à grogner animalement, comme un chien après le passage d’un chemineau. Des mots indignés passaient encore par ses lèvres fiévreuses pendant qu’elle s’assoupissait.
Sophia avait regagné sa place sous la lampe. Dans la chambre la paix se refit lentement et plus profonde. Elle ne reprit pas sa lecture, les mains jointes, rêveuse, elle oubliait l’agression passionnelle. Derrière les vitres, les arbres givrés crispaient leur geste macabre, et, dans le silence de neige, elle écouta cet imperceptible son que les nerfs seuls entendent, semblable à une basse très sourde et qui annonce aux intuitifs l’approche encore lointaine du destin.
La veilleuse, suspendue à une tige de fer devant l’icône de la vierge, grésilla ; un reflet passa sur le fond d’or où, peinte de tons durs, en robe blanche et en manteau bleu, la madone byzantine, avec son hiératisme presque égyptien, solennisait le mur, d’un coin de chapelle. Les yeux de Sophia se fixèrent sur l’image, en une muette adoration.
La Panagia ne tenait pas l’enfant divin ; elle renversait ses mains ouvertes comme pour en faire couler les bénédictions figurées par des traits d’or dont les lignes nettes descendaient jusqu’au bas du panneau. Jamais la vieille peinture ne lui avait paru si belle. Dans la pénombre, le caractère farouche de la mère de Dieu s’adoucissait. Le front si pur sous le voile, le sourire si profond sur les lèvres fermées, les yeux si grands dans l’ovale exagéré exprimaient, d’une façon rude, les idées de pureté et de force. Au lieu de la frêle et jolie jeune fille, docile servante du Seigneur, le vieux moine avait peint la vierge consciente du mystère, ferme devant le septuple glaive de la douleur, confidente de la divinité et héroïque complice de la volonté du Père. Et voici que la Madone s’anima, ses yeux immenses se mouillèrent sous ses paupières immobiles et son regard rencontra celui de Sophia. Quelle tendresse douloureuse rayonnait du divin visage, quelle tendresse sororale ! À ce moment la jeune fille, en son élan enthousiaste, se vit elle-même dans le saint icône, comme dans un miroir. C’était son front que couvrait à demi le voile, le manteau d’outremer enveloppait ses épaules et la robe blanche aux plis droits cachait les beautés de son corps.
La mince flamme de la veilleuse vacilla ; des ornements gaufrés brillèrent autour du cou, au bas des manches, à la bordure du manteau : toutes les traces de dorure miroitèrent. Sophia, éblouie d’elle-même s’identifiant à la madone, renouvela son vœu de pureté et de charité, son vœu de vierge, de sainte femme.
Le même frappement qu’avait fait Schaebolof, mais plus vif et nerveux, éveilla la vieille femme qui se dressa sur son séant, tandis que Sophia sortait lentement de son extase. Les êtres qui vivent dans les trames des complots, au moindre indice pressentent l’évènement grave.
Trois hommes entrèrent. Le plus vieux, Doubrowski, à grande barbe, portait le haut bonnet des popes, il soufflait d’avoir marché vite :
– « Sophia, il faut cacher quelqu’un ! » dit-il.
– « Quelqu’un de blessé », ajouta le second, Yvanof, que son allure révélait ancien militaire et son air sombre et insolent, un déserteur.
Le dernier, petit et malingre, Kinasef, semblait un ouvrier endimanché.
– « Quelqu’un qui va mourir peut-être ici, mais qui mourra sûrement si on l’emmène plus loin. »
Aucun n’avançait sur ce plancher cependant familier. Partagés en la pitié pour leur frère et le respect du logis où ils apportaient peut-être le malheur, honnêtement ils hésitaient.
– « Qui est-ce ? » demanda Sophia.
– « Matouchenski », dit le pope.
– « Il a lancé une bombe sur le préfet de police, au moment où celui-ci se rendait au théâtre Michel ; il a manqué le coup et se trouve dans un triste état.
– « Je le crains ! on ne va pas vite avec un homme qui perd son sang », fit le déserteur.
– « Où est Matouchenski ? » dit Sophia.
– Apportez-le », dit Sophia. Cette parole si simple engageait la liberté des deux femmes. Cacher un anarchiste après son attentat, c’était la Sibérie pour tous.
La Petrowna, indécise entre son dévouement pour Sophia et son ardeur révolutionnaire s’était tue, mais la décision sereine, de celle qu’elle appelait sa fille, la remplit de joie.
Le pope et le déserteur apportèrent Matouchenski évanoui. Ses bras pendaient lamentables ; à ses mains rouges et suintantes des doigts manquaient.
Sophia s’approcha, vaillante et seulement un peu pâle, pour examiner les plaies, lorsque Sokolof entra.
– “Vite”, s’écria la Petrowna, “dans l’alcôve, derrière moi !”
– Dieu fasse qu’il reste en syncope ! » dit le pope.
Sophia courut à la fenêtre.
Ils eurent la même pensée : ils virent Sophia arrêtée, peut-être violentée et mêlée au convoi des Sibériens. Eux qui marchaient hardiment dans un sentier de guerre plus terrible que celle des Peaux-Rouges, tremblèrent pour la beauté de cette vierge, pour sa jeunesse. Ils se blâmèrent d’avoir apporté le blessé.
– « Allez ! je le veux ! »
Un officier de police promena, du seuil, un regard inquisiteur dans la pièce ; puis il s’effaça avec déférence devant deux hommes élégants, dont on devinait le costume de soirée sous la pelisse. Derrière eux, des agents entrèrent.
– « Regardez donc, Alexis, la belle fille ! »
– « Ma mère est malade ! » expliqua Sophia.
– « Le médecin des pauvres ! » fit Sophia.
Celui qui avait parlé en français se pencha vers son compagnon :
– « Où avez-vous caché le brigand ? » disait le policier en dévisageant tour à tour la Petrowna et Sophia.
– « Votre Excellence, les traces de piétinement aboutissent à cette maison », répliqua l’officier.
– « Je vous demande, avec l’instance la plus vive, de sauvegarder ces femmes. »
– « Allons-nous-en », fit-il à l’officier, le coupable n’est pas ici, et nous perdons du temps.
– Il n’y a pas de « mais », c’est moi qui ai manqué sauter, à la place de mon oncle. Cette affaire m’appartient et je la conduis à ma guise.
– Non ; mon ami restera seul, il vaut mieux que tes hommes.
Le neveu du préfet de police haussa les épaules pour toute réplique, et se dirigea vers la porte.
L’Excellence lui fit un signe pour qu’il passât devant, et, serrant la main au Français :
Celui-ci contemplait avec une admiration grandissante la jeune fille immobile à la même place : Entre les rideaux, la Petrowna avançait sa tête de gorgone.
– « Que puis-je encore pour vous, Mademoiselle ? » demanda-t-il en russe.
Le jeune homme se redressa, le sourcil froncé. À en juger par l’attitude du policier, ces femmes avaient caché le criminel, et lui qui était intervenu si généreusement trouva le remerciement étrange. Sophia voulut dissiper cette humeur, dangereuse peut-être.
Elle s’exprimait aisément.
Elle hésita, fixant ses yeux clairs sur ceux du jeune homme ; et puis, comme si elle payait ainsi l’aide prêtée, gravement elle se nomma :
– « Il y a eu des princes de ce nom, je crois », fit André.
– « Voulez-vous savoir pourquoi je me suis intéressé à vous, spontanément ? Eh bien, parce que vous ressemblez à la madonna Litta de l’Ermitage. »
Matouchenski revenait à la vie et à la douleur. Le Français comprit alors l’impatience causée par sa présence ; sa vanité s’apaisa et, admirant la trempe de ces femmes si fortes à cacher leurs angoisses :
Une autre plainte, presque un cri s’éleva.
– « Certainement ! Certainement ! » répétait Sophia en français, l’accompagnant vers la porte comme elle l’y eût poussé.