

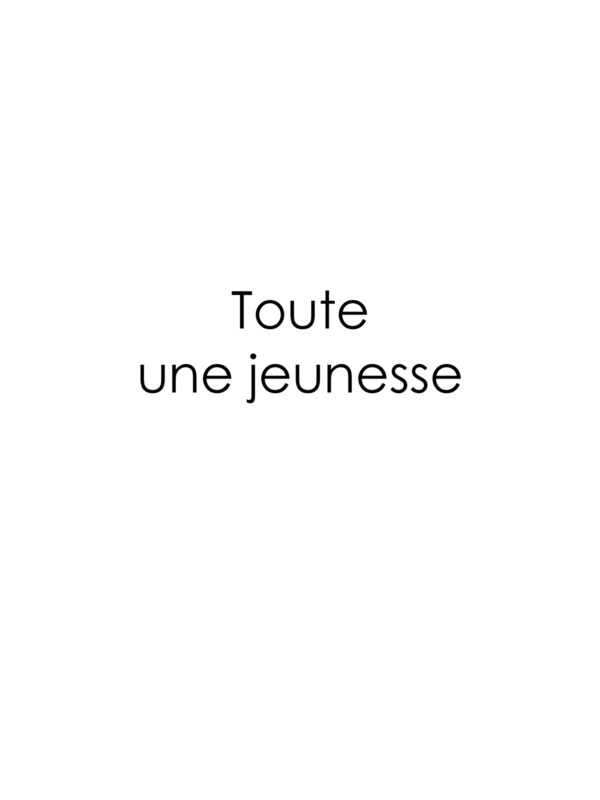

– si parva licet… – ces pages ne sont une autobiographie, une confession. Seulement, je l’avoue, Amédée Violette, personnage imaginaire dans une action imaginaire, sent la vie comme je la sentais quand j’étais un enfant et quand j’étais un jeune homme. Tel que le voici, le livre est sincère. Puisse-t-il vous plaire, mon cher Dépret, avec ses attendrissements et ses ironies.
À vous de cœur,
FRANÇOIS COPPÉE.
Au fond, tout au fond de ses souvenirs, Amédée Violette se voyait, petit bonhomme coiffé en « enfant d’Édouard », sur un balcon au cinquième étage, fleuri de volubilis. L’enfant étant tout petit, ce balcon lui semblait très grand. On avait donné à Amédée pour sa fête, ou pour son jour de naissance, une boîte de couleurs à l’aquarelle, et, vautré sur un vieux tapis, passionnément attentif, mouillant de temps en temps son pinceau dans sa bouche, il enluminait les gravures sur bois d’un volume dépareillé du Magasin pittoresque. Chez les voisins, dont l’appartement était contigu à celui de ses parents et qui avaient la jouissance d’une moitié du balcon, on jouait au piano une valse de Marcailhou, fort à la mode alors et intitulée Indiana. Tout homme né dans les environs de 1845, qui ne sent pas ses yeux se mouiller de larmes nostalgiques en feuilletant un ancien tome du Magasin pittoresque ou en entendant un piano suranné jouer l’Indiana de Marcailhou, est doué de bien peu de sensibilité.
Lorsque l’enfant, fatigué de mettre de la « couleur chair » sur les visages et sur les mains de tous les personnages des estampes, se levait et allait regarder entre les barreaux de la balustrade, il voyait se développer, à droite et à gauche, avec une courbe gracieuse, la rue Notre-Dame-des-Champs, une des plus paisibles du quartier du Luxembourg, une rue alors à peine bâtie à moitié, où des branches d’arbres dépassaient les clôtures en planches des jardins, et si tranquille, si silencieuse, que le passant solitaire y entendait chanter les oiseaux en cage.
C’était par des après-midi de septembre, devant des ciels vastes et purs, où glissaient avec une majestueuse lenteur de grands nuages pareils à des montagnes d’argent.
Tout à coup, une voix douce l’appelait :
– « Amédée, ton père va revenir de son bureau… Il faut te laver les mains avant de te mettre à table, mon mignon. »
Et sa mère venait le chercher sur le balcon. Sa mère ! Qu’il l’avait peu connue ! Il avait besoin d’un effort pour l’évoquer, dans la brume de ses souvenirs, humble et jolie, si pâle avec de charmants yeux bleus, penchant toujours un peu la tête de côté, comme si le poids de ses admirables cheveux châtains eût été trop lourd pour elle, et souriant du sourire douloureux et fatigué de ceux qui n’ont pas longtemps à vivre.
Elle lui faisait sa toilette, l’embrassait sur le front après l’avoir peigné ; puis elle dressait elle-même le modeste couvert, toujours orné de quelques fleurs dans un joli vase.
Le père arrivait alors. Oh ! pas un faiseur d’embarras non plus, celui-là. Encore un timide, un raseur de murailles. Il essayait pourtant d’être gai, en rentrant au logis, et il enlevait son petit garçon bien haut, à bout de bras, avant de l’embrasser : « Houp là ! » Mais, un moment après, lorsqu’il avait baisé sa jeune femme sur les yeux et qu’il la retenait pendant une minute, d’un geste si tendre, contre son épaule, comme il avait l’air inquiet en lui disant :
– « Tu n’as pas toussé, aujourd’hui ? »
Elle répondait toujours : « Non, pas trop, » mais en baissant le regard, comme les enfants qui mentent.
Le père alors mettait sa vieille redingote, – celle qu’il venait de quitter n’était pourtant pas bien neuve ; – on installait Amédée devant sa timbale, sur sa chaise haute ; la jeune maman revenait de la cuisine, portant la soupière ; et, après avoir déployé sa serviette, le père rejetait derrière son oreille, d’un geste brusque de la main, la longue mèche de cheveux qui lui retombait toujours sur les yeux, du côté droit.
– « Il n’y a pas trop d’air, ce soir ?… Tu n’as pas peur d’aller sur le balcon, Lucie ?… Mets donc un châle, – disait M. Violette, tandis que sa femme versait le restant de la carafe dans la caisse verte où poussaient les capucines.
– Mais non, Paul, je t’assure… Fais descendre Amédée de sa chaise, je te prie, et venez sur le balcon. »
Il faisait frais, sur la haute terrasse. Le soleil s’était couché. Les grands nuages ressemblaient maintenant à des montagnes d’or, et une bonne odeur de verdure montait des jardins environnants.
– « Bonsoir, monsieur Violette, – disait soudain une voix cordiale ; – j’espère que voilà une belle soirée ! »
C’était le voisin, M. Gérard, un graveur au burin, qui venait respirer, lui aussi, sur son bout de balcon, après avoir passé toute la journée courbé sur sa planche. Un gros homme à l’air bon enfant, ce Gérard, chauve, avec une barbiche rousse mêlée de poils blancs, en vareuse débraillée, et qui, tout de suite, allumait sa pipe en terre, dont le fourneau représentait le visage d’Abd-el-Kader très culotté, sauf le turban et les yeux, qui étaient en émail blanc.
La femme du graveur, une boulotte aux yeux gais, ne tardait pas à rejoindre son mari. Elle arrivait, en poussant devant elle ses deux fillettes ; l’une, la toute petite, avait deux ans de moins qu’Amédée ; l’autre – dix ans et déjà l’air d’une personne raisonnable – était la pianiste qui tapotait, une heure par jour, l’Indiana de Marcailhou.
Les enfants bavardaient à travers le treillage qui séparait le balcon par moitié. Louise, l’aînée des fillettes, qui savait lire, racontait à voix basse aux deux tout petits de très belles histoires : Joseph vendu par ses frères, Robinson découvrant des traces de pas humains.
Amédée, qui maintenant a les tempes grises, se rappelle encore le frisson qui lui passait dans le dos au moment où le loup, caché sous les couvertures et sous le bonnet de la Mère-Grand, disait avec un grincement de dents au Petit Chaperon rouge : « C’est pour mieux te croquer, mon enfant ! »
Il faisait alors presque nuit sur la terrasse. Songez donc ! C’était terrible !
Pendant ce temps-là, les deux ménages, conjugalement accoudés sur leur balcon respectif, causaient familièrement. Les Violette, gens silencieux, se contentaient le plus souvent d’écouter leurs voisins, avec de brèves réponses de politesse… « Ah ! bah !… Est-ce possible ?… Vous avez bien raison… » Mais les Gérard aimaient à parler. Mme Gérard, bonne femme de ménage, agitait quelque question d’économie domestique, racontait, par exemple, qu’elle était sortie dans la journée et qu’elle avait vu, dans un magasin de la rue du Bac, À la Fileuse, un certain mérinos : « quelque chose de très avantageux, je vous assure, madame, et grande largeur ! » Ou bien c’était le graveur, politiqueur naïf à la mode de 48, qui déclarait qu’il fallait accepter la République : « oh ! pas la rouge, vous savez, mais la vraie, la bonne ! » ou qui souhaitait que Cavaignac fût élu Président au scrutin de décembre, bien que l’artiste fût précisément en train de graver – il faut vivre, après tout ! – un portrait du prince Louis-Napoléon, destiné à la propagande électorale. M. et Mme Violette laissaient dire ; peut-être même n’étaient-ils pas toujours à la conversation ; et, quand la nuit était tout à fait venue, ils se prenaient doucement la main dans l’obscurité et regardaient les étoiles.
Ces belles soirées du commencement de l’automne, dans la fraîcheur, sur le balcon, devant le firmament constellé, c’étaient les plus lointains des souvenirs d’Amédée. Puis une lacune se faisait dans sa mémoire, comme dans un livre dont on a arraché plusieurs feuillets, et il revivait des jours sombres.
L’hiver était arrivé ; on n’allait plus sur le balcon, et par les fenêtres fermées on ne voyait plus qu’un ciel d’un gris morne. La mère d’Amédée était malade et restait toujours couchée. Quand il était installé près du lit, devant une petite table, en train de découper avec des ciseaux tous les hussards d’une page d’Épinal, elle l’effrayait presque, sa maman, accoudée dans l’oreiller, sa pauvre maman qui le regardait si longtemps et si tristement, sa maigre main crispée dans ses beaux cheveux en désordre, et deux petites fumées d’ombre sous la maigreur de ses pommettes.
Ce n’était plus elle, à présent, qui venait le prendre, le matin, dans son lit, mais une vieille femme en camisole, qui ne l’embrassait pas et qui infectait le tabac à priser.
Son père, non plus, ne faisait guère attention à lui, quand il revenait, le soir, de son bureau, rapportant toujours des fioles et des petits paquets de chez le pharmacien. Quelquefois, il était accompagné du médecin, un gros monsieur très paré, très parfumé, et soufflant d’avoir grimpé les cinq étages. Une fois, Amédée avait vu cet inconnu prendre dans ses bras sa mère assise sur son lit, et appliquer longtemps sa tête contre le dos de la malade, et l’enfant avait demandé : « Pourquoi, maman ? »
M. Violette, plus nerveux que jamais et rejetant à chaque instant sa mèche rebelle derrière son oreille, reconduisait le médecin jusqu’à la porte, s’attardait à parler avec lui. Amédée, appelé par sa mère, grimpait alors sur le lit ; elle fixait sur lui des yeux brillants, le serrait avec passion sur sa poitrine dont il sentait la maigreur, et lui disait d’une voix douloureuse : « Mon petit Médée ! Mon pauvre petit Médée ! » comme si elle le plaignait. Pourquoi ? Pourquoi donc ?
Le père revenait, avec un sourire forcé qui faisait mal à voir.
– « Eh bien, que dit le docteur ?
– Rien, rien… Tu vas beaucoup mieux… Seulement, ma pauvre Lucie, il va falloir mettre encore un petit vésicatoire, cette nuit. »
Oh ! qu’elles sont lentes, qu’elles sont monotones, les journées du petit Amédée auprès du lit de la malade assoupie, dans la chambre close et sentant la pharmacie, où la vieille priseuse entre seulement, d’heure en heure, pour apporter une tasse de tisane et mettre du charbon de terre dans la cheminée !
Mais quelquefois la voisine, Mme Gérard, vient demander des nouvelles.
– « Toujours bien faible, ma bonne madame Gérard… Ah ! je commence à me décourager. »
Mme Gérard, la boulotte aux yeux gais, ne veut pas qu’on se laisse aller comme ça.
– « Voyez-vous, madame Violette, c’est ce maudit hiver qui n’en finit plus. Mais nous voici bientôt en mars, et l’on vend déjà des bottes de primevères dans les petites charrettes, le long des trottoirs… Bien sûr que vous irez mieux, au premier rayon de soleil… Si vous voulez, je vais emmener Amédée jouer avec mes petites filles… Ça le distraira, cet enfant. » Maintenant, la bonne voisine garde le petit Amédée pendant toutes les après-midi, et il se plaît beaucoup chez les Gérard.
Quatre petites chambres, voilà tout, mais avec un tas de vieux meubles amusants, et des gravures, des moulages, des esquisses peintes par des camarades sur toutes les murailles ; et les portes sont toujours ouvertes, et les enfants peuvent jouer où ils veulent, se poursuivre à travers le logement, le mettre au pillage. Dans le salon, transformé en atelier, l’artiste est assis sur un haut tabouret, la pointe à la main, et la lumière de la fenêtre sans rideaux, tamisée par le transparent, fait reluire son crâne de brave homme, penché sur la planche de cuivre. Il pioche toute la journée, – une maison lourde et deux filles à élever, n’est-ce pas ? – et, malgré ses opinions avancées, il continue à graver son prince Louis, « un farceur qui va nous escamoter la République ». C’est tout au plus s’il s’interrompt, deux ou trois fois par jour, pour fumer son Abd-el-Kader. Rien ne le distrait de sa besogne, pas même les petites, qui, lasses d’exécuter leur morceau à quatre mains sur le piano en ruines, viennent d’organiser avec Amédée une partie de cache-cache, tout près du père, derrière le canapé Empire, orné de gueules de lion en bronze. Mais la maman Gérard, du fond de sa cuisine, où elle est toujours à fricoter quelque chose de bon pour le dîner, trouve qu’on fait vraiment trop de tapage. Justement Maria, la plus petite, une vraie folle, en poussant, pour attraper sa sœur aînée, un fauteuil contre le bahut Renaissance, vient de faire trembler toutes les faïences de Rouen.
– « Allons, allons, mes enfants ! – crie, sans colère dans la voix, maman Gérard, du fond de son antre, d’où s’échappe un délicieux parfum de lardons. – Laissez un peu votre père tranquille, et allez jouer dans la salle à manger. »
On obéit ; car, là, on peut remuer les chaises à sa guise et s’en faire des maisons, pour jouer aux visites. Cette folle de Maria – a-t-on idée d’imaginations pareilles ? à cinq ans ! – a pris le bras d’Amédée, qu’elle appelle son petit mari ; elle va rendre visite à sa sœur Louise et lui présente son enfant, une poupée de carton, à grosse tête, emmaillotée dans une serviette.
– « Alors, comme vous voyez, madame, c’est un garçon.
– Et qu’est-ce que vous comptez faire de lui quand il sera grand ? – demande Louise, qui se prête au jeu par complaisance ; car elle a dix ans, s’il vous plaît, et c’est une petite demoiselle.
– Mais, madame, – répond Maria avec gravité, – il sera militaire. »
En ce moment, le graveur, qui a quitté son établi pour se dégourdir un peu les jambes et pour allumer son troisième Abd-el-Kader, est sur le seuil de son atelier ; et Mme Gérard, rassurée sur le sort de son ragoût qui cuit à petit feu, – oh ! que ça sent bon, dans la cuisine ! – vient d’entrer dans la salle à manger. Ils regardent tous deux les enfants, si drôles, si gracieux en faisant leurs petites mines. Puis l’homme regarde sa femme, la femme regarde son mari, et ils partent ensemble d’un joyeux éclat de rire.
Mais on ne rit pas, on ne rit jamais dans le logement à côté, chez les Violette. On tousse, on tousse, on tousse ! Jusqu’à l’étouffement, jusqu’au râle ! Elle va s’en aller, la timide jeune femme aux cheveux trop lourds, et quand les belles soirées seront revenues, elle ne s’attardera plus sur le balcon à serrer dans l’ombre la main de son mari, en regardant les astres. Il n’y comprend rien, le petit Amédée, mais il est pris d’une vague terreur. Il sent qu’il se passe quelque chose d’effrayant à la maison. Tout le monde lui fait peur, maintenant. Il a peur de la vieille qui sent le tabac et qui, en l’habillant, le matin, le regarde d’un air de pitié ; peur du médecin si bien mis, qui monte deux fois par jour les cinq étages, à présent, et laisse dans l’appartement une traînée de parfumerie ; peur de son père, qui ne va plus à son bureau, qui a une barbe de trois jours, et qui arpente fébrilement le petit salon, en rejetant, avec un geste de maniaque, sa mèche de cheveux derrière son oreille. Il a peur de sa mère, hélas ! de sa mère qu’il a vue, ce soir encore, à la lueur de la veilleuse, la tête enfoncée dans l’oreiller, le nez si mince, le menton en l’air, et qui n’a pas paru le reconnaître, malgré ses grands yeux ouverts, quand le père a pris son enfant dans ses bras et l’a penché vers elle pour qu’il l’embrassât sur son front couvert de sueur froide !
Enfin, il est arrivé, le jour terrible, le jour qu’Amédée n’oubliera jamais, quoiqu’il ne fût alors qu’un petit, un bien petit enfant.
Ce qui l’a réveillé, ce jour-là, c’est l’étreinte de son père, qui est venu le prendre dans son lit, de son père qui a des yeux de fou, des yeux sanglants à force d’avoir pleuré. Le voisin, M. Gérard, – à quel propos est-il là de si bonne heure ? – roule de grosses larmes sous ses paupières, lui aussi. Il se tient tout à côté de M. Violette, comme s’il veillait sur lui, et lui frappe le dos affectueusement avec le plat de la main.
– « Allons, mon pauvre ami !… du courage ! du courage !… »
Mais le pauvre ami n’en a plus. Il se laisse enlever son enfant des mains par M. Gérard, et voilà que sa tête tombe, comme morte, sur l’épaule du brave graveur, et qu’il se met encore à pleurer, à pleurer, avec de gros sanglots qui lui soulèvent les épaules.
– « Maman !… Voir maman !… » crie le petit Amédée plein d’épouvante.
Hélas ! il ne la verra plus jamais ! Chez les Gérard, où on l’emporte et où la bonne voisine l’habille, on lui dit que sa maman est partie, partie pour longtemps, pour très longtemps ; qu’il doit bien aimer son papa, ne plus penser qu’à son papa ; et d’autres paroles qu’il ne comprend guère, dont il n’ose pas demander l’explication, et qui le consternent.
C’est étrange ! Le graveur et sa femme ne s’occupent que de lui, le regardent à chaque instant. Les petites, elles aussi, ont devant lui un air singulier, presque respectueux. Qu’est-ce qu’il y a donc de changé ? Louise n’ouvre pas son piano, et quand la petite Maria a voulu prendre sa « ménagerie » dans le bas du buffet, Mme Gérard lui a dit brusquement, en essayant de faire les gros yeux : « On ne joue pas, aujourd’hui. »
Après le déjeuner, Mme Gérard a mis son châle et son chapeau, et est sortie en emmenant Amédée. Ils sont montés dans un fiacre, qui a suivi des rues que l’enfant ne connaissait pas, a traversé un pont au milieu duquel se dressait un grand cavalier d’airain, la tête nue et couronnée de lauriers, et s’est arrêté devant une grande maison, où ils sont entrés avec de la foule, et où un jeune homme, très agile et très empressé, a fait mettre à Amédée des vêtements noirs.
Au retour, l’enfant a trouvé son père et M. Gérard assis à la table de la salle à manger, et tous deux écrivant des adresses sur de grandes feuilles encadrées de noir. M. Violette ne pleurait pas, mais sa figure était comme creusée de douleur, et il laissait tomber sur son œil droit sa mèche de cheveux navrée.
À la vue de son fils dans ses vêtements neufs, il a poussé un gémissement, s’est levé en chancelant comme un homme ivre, et a de nouveau fondu en larmes.
Oh ! non, il n’oubliera jamais ce jour-là, le petit Amédée, ni l’horrible lendemain, où Mme Gérard est venue, dès le matin, le vêtir de son costume noir, tandis qu’il écoutait, dans la chambre à côté, un bruit de lourds souliers traînés et de coups de marteau. – Il se rappelle tout à coup qu’il n’a pas vu sa mère depuis l’avant-veille.
– « Maman !… Voir maman !… »
Il faut bien alors tâcher de lui faire comprendre la vérité. Mme Gérard lui répète qu’il doit être très sage, très bon, pour consoler son père qui a beaucoup de chagrin, et elle ajoute que sa maman s’en est allée pour toujours, et qu’elle est au ciel.
Au ciel ! C’est bien haut et c’est bien loin, le ciel. Mais si sa mère est au ciel, qu’est-ce donc qu’emportent ces portefaix en deuil dans cette lourde boîte qu’ils cognent à tous les angles de l’escalier ? Qu’est-ce donc que traîne la lugubre voiture qu’il suit sous la pluie, en allongeant ses pas enfantins, sa petite main serrée dans la main gantée de noir de son père ? Qu’est-ce donc qu’on enfouit dans ce trou d’où sort une odeur de terre fraîchement remuée, dans ce trou entouré de gens en noir et devant lequel son père détourne la tête avec horreur ? Qu’est-ce donc que l’on cache au fond de la fosse béante, dans ce jardin plein de croix et d’urnes de pierre, où les arbres aux bourgeons de bronze des premiers jours de mars, luisants au soleil après l’averse, laissent tomber de leurs branches de grosses gouttes d’eau qui ressemblent à des larmes ?
Sa mère est au ciel !… Amédée n’ose plus demander à « voir maman », le soir de cet effrayant jour-là, quand il s’assied auprès de son père à cette table où, depuis longtemps déjà, la vieille femme en camisole ne met plus que deux couverts. Le pauvre veuf, qui vient encore de s’essuyer les yeux avec sa serviette, a mis dans une assiette un peu de viande pour Amédée et la lui coupe en petits morceaux ; et, tout pâle sur sa chaise haute, l’enfant se demande s’il doit reconnaître un jour le regard de sa mère, ce regard si caressant et si doux, dans une de ces étoiles qu’elle aimait à contempler, sur le balcon, par les fraîches nuits de septembre, en serrant la main de son mari dans l’obscurité.
Les arbres sont comme les hommes ; il y en a qui n’ont pas de chance. Mais un arbre véritablement infortuné était le pauvre diable de platane qui avait poussé au milieu de la cour de l’institution de jeunes gens, située rue de la Grande-Chaumière, et dirigée par M. Batifol.
Le hasard aurait aussi bien pu faire pousser ce platane au bord d’une rivière, sur une jolie berge, où il eût regardé passer les bateaux, ou bien encore sur le mail d’une ville de garnison, où il aurait eu du moins, deux fois par semaine, la distraction d’écouter la musique militaire. Eh bien, non ! Il était écrit, au livre des destinées, que ce malheureux platane perdrait son écorce, tous les étés, comme un serpent change de peau, et joncherait le sol de ses feuilles mortes, à la première gelée, dans la cour de l’institution Batifol, qui était un endroit sans agrément.
D’abord, cet arbre solitaire – oh ! mon Dieu, un platane comme un autre (platanus orientalis), entre deux âges, sans originalité – devait avoir le sentiment pénible qu’il servait à tromper le public. En effet, sur l’enseigne de l’institution Batifol (Cours du lycée Henri IV. Préparation au baccalauréat et aux écoles de l’État), on lisait ces mots fallacieux : Il y a un jardin ; et, en réalité, il n’y avait qu’une vulgaire cour, sablée de sable de rivière, avec un ruisseau pavé autour, une cour dans laquelle on n’aurait pu récolter – et après la récréation encore ! – qu’une demi-douzaine de billes perdues, une toupie cassée en deux et un certain nombre de clous de souliers. Le seul platane justifiait l’illusion, la fiction du jardin promis par l’enseigne. Or, comme les arbres ont certainement le sens commun, celui-ci devait bien avoir conscience qu’il n’était pas un jardin à lui tout seul.
Et puis, c’est vraiment un sort bien injuste pour un arbre inoffensif, qui n’a jamais rien fait à personne, que de s’épanouir à côté d’un portique de gymnase, dans un rectangle parfait formé par un mur de prison hérissé de culs de bouteilles et par trois corps de logis d’une symétrie affligeante, et offrant, au-dessus des nombreuses portes du rez-de-chaussée, des inscriptions dont la lecture seule invitait au bâillement : Salle 1. Salle 2. Salle 3. Salle 4. Escalier A. Escalier B. Entrée des dortoirs. Réfectoire. Laboratoire.
Le pauvre platane crevait de chagrin dans ce lieu morne. Ses seuls bons moments – les heures de récréation où la cour s’égayait des cris et des rires des gamins – étaient gâtés pour lui par la vue des trois ou quatre élèves punis qu’on mettait au piquet au pied de son tronc. Les oiseaux parisiens, qui ne sont pourtant pas difficiles, se posaient à peine sur les branches et n’y avaient jamais construit un nid. Il est même supposable que cet arbre désenchanté, lorsque le vent d’avril agitait son feuillage et que les gavroches du ciel venaient polissonner chez lui, leur murmurait charitablement : « Croyez-moi ! l’endroit ne vaut rien. Allez faire l’amour ailleurs ! »
À l’ombre de ce platane, planté sous une mauvaise étoile, devait s’écouler la majeure partie de l’enfance d’Amédée.
Employé de ministère, M. Violette était condamné à sept heures de prison par jour, dont une ou deux étaient consacrées par lui à remplir avec dégoût un tas d’imprimés probablement superflus, et les autres heures à diverses occupations aussi variées qu’intellectuelles, telles que bâiller, se ronger les ongles, dire du mal des chefs, geindre sur la lenteur de l’avancement, faire cuire une pomme ou une saucisse dans le four du poêle, pour le déjeuner, et lire le journal jusqu’au tuf, jusqu’à la signature du gérant, jusqu’aux réclames dans lesquelles un curé de campagne exprime sa naïve gratitude d’être enfin guéri d’une constipation opiniâtre. En récompense de cette captivité quotidienne, M. Violette recevait à la fin du mois une somme exactement suffisante pour assurer à son ménage la soupe et le bœuf, avec très peu de cornichons autour.
Afin de faire parvenir son fils à une position aussi distinguée, le père de M. Violette, horloger à Chartres, s’était saigné à blanc et était mort sans laisser d’économies. Le Silvio Pellico administratif, dans ces heures d’ennui exaspéré, regrettait parfois de n’avoir pas tout bonnement succédé à l’auteur de ses jours, et il se voyait en imagination dans la claire petite boutique près de la cathédrale, une loupe fixée dans son arcade sourcilière, en train de visiter le vieil oignon d’un fermier, et ayant devant lui, suspendues au-dessus de son établi, une trentaine de montres d’or ou d’argent marchant toutes ensemble avec un crépitement joyeux, que des cultivateurs lui avaient données à réparer la semaine d’avant et qu’ils devaient venir reprendre tout à l’heure, en profitant du jour du marché.
Mais une profession aussi basse eût-elle été digne, je vous le demande, d’un jeune homme avant fait des études complètes, d’un bachelier ès-lettres bourré de Racines grecques et de Conciones, pouvant vous débiter, d’une haleine, les preuves de l’existence de Dieu, et capable de vous dire, sans broncher, les dates des règnes de Nabonassar et de Nabopolassar ? Non ! messieurs, et ce petit horloger chartrain, ce simple artisan, comprenait mieux l’esprit moderne. – (Très bien. Très bien. Écoutez.) – Sommes-nous encore en Égypte, au temps des Pharaons, pour qu’un fils succède forcément à son père dans son métier ? – (Approbation.) – Non ! ce modeste boutiquier avait agi, messieurs, d’après la loi de la démocratie, avait suivi l’instinct d’une noble et sage ambition. – (Applaudissements sur un grand nombre de bancs.) – Et il avait fait de son fils, d’un garçon intelligent et sensible, une machine à remplir des imprimés, ayant perdu tant de jours à deviner les rébus de l’Illustration, qu’il les lisait aussi couramment que M. Ledrain pourrait déchiffrer l’inscription cunéiforme d’une brique assyrienne. Aussi, – résultat admirable et qui devait réjouir les mânes du vieil horloger ! – son fils était-il devenu un monsieur, un fonctionnaire, si honorablement rétribué par l’État qu’il était obligé de faire mettre à ses fonds de culotte des pièces d’un drap à peu près pareil, et que sa pauvre jeune femme, de son vivant, avait toujours été forcée, aux approches du terme, de porter au mont-de-piété la louche et les six couverts d’argent.
Quoi qu’il en fût, M. Violette, étant veuf à présent et ayant toute sa journée prise, était fort embarrassé de son petit garçon.
Sans doute, ses voisins, les Gérard, étaient excellents pour Amédée et continuaient à le garder chez eux toute l’après-midi. Mais cet état de choses ne pouvait pas durer toujours, et M. Violette se faisait scrupule d’abuser ainsi de la complaisance de ces braves gens.
Amédée ne les gênait pourtant guère, et la maman Gérard l’aimait déjà comme un des siens. L’orphelin était maintenant l’inséparable de la petite Maria, un diable tout à fait, qui devenait plus gentille, de jour en jour. Le graveur ayant retrouvé dans un placard son ancien bonnet à poils de grenadier de la garde nationale, coiffure supprimée depuis 48, l’abandonna aux deux enfants. Jouet magnifique, convenez-en ! et bien fait pour exciter leur imagination. Il fut immédiatement transformé dans leur esprit en un ours d’une taille et d’une férocité effroyables, qu’ils se mirent à chasser à travers le logement, le guettant, embusqués derrière les fauteuils, le visant avec des bâtons et gonflant leurs petites joues de toutes leurs forces pour faire : « Poum ! » et imiter les coups de fusil. Ce divertissement cynégétique acheva la ruine du vieux mobilier. Pendant ce temps-là, les gammes de la grande Louise s’écoulaient avec un bruit de torrent musical ; dans la cuisine, la friture gazouillait sur les fourneaux de maman Gérard ; et, tranquille au milieu de ce joyeux désordre et de ce tapage à ne pas s’entendre, le graveur, tout à son affaire, fignolait le grand-cordon de la Légion d’honneur et les épaulettes à graines d’épinards du Prince-Président, que, républicain soupçonneux et flairant le coup d’État, il détestait pourtant de tout son cœur.
– « Vraiment, monsieur Violette, – disait la mère Gérard à l’employé, quand, au retour du bureau, il venait chercher son fils et s’excusait du mal que l’enfant devait donner aux voisins, – vraiment, je vous assure, il ne nous gêne en rien… Attendez un peu avant de l’envoyer en classe… Il est très paisible, et si Maria ne l’excitait pas à jouer (ma parole d’honneur, c’est elle, des deux, qui est le garçon !), votre Amédée serait toujours à regarder les images. Ma grande Louise lui fait lire, tous les jours, deux pages de la "Morale en actions", et hier encore, il a bien amusé Gérard en lui racontant l’Histoire de l’Éléphant reconnaissant… Il ira en pension plus tard… Attendez un peu. »
Mais M. Violette est décidé à envoyer Amédée chez M. Batifol. Oh ! comme externe, bien entendu. C’est si commode, c’est à deux pas. Cela n’empêchera pas Amédée de voir souvent ses petites amies. Mais il va sur ses sept ans ; il est très en retard ; c’est à peine s’il sait former ses lettres. On ne saurait « commencer » les enfants trop tôt, etc., etc.
C’est pourquoi, par un beau jour de printemps, M. Violette est introduit avec son petit garçon dans le cabinet de M. Batifol, qui va venir dans un instant, le domestique l’a promis.
Il est hideux, le cabinet de M. Batifol. Dans les trois corps de bibliothèque, que n’ouvre jamais le maître de céans, parfait cuistre et cupide marchand de soupe, quelques-uns de ces ouvrages qu’on se procure sur les quais, au mètre courant, tels que le Cours de littérature de Laharpe et un Rollin qui n’en finit plus, laissent suinter l’ennui à travers leurs reliures. Le bureau de travail à cylindre, un de ces chefs-d’œuvre d’acajou plaqué dont le faubourg Saint-Antoine conserve encore le secret, est surmonté d’une sphère terrestre.
Tout de suite, par une fenêtre ouverte, le petit Amédée remarque le platane au milieu de la cour, qui s’embête à vingt francs l’heure, malgré le soleil, le ciel bleu et le vent printanier.
Un jeune merle, qui ne connaît pas encore le quartier, est venu, il n’y a qu’un instant, se poser sur une de ses branches. Mais l’arbre lui a dit sans doute :
– « Qu’est-ce que tu viens faire ici ?… Le Luxembourg est à trois coups d’aile. C’est charmant, le Luxembourg. Il y a des enfants qui font des pâtés avec du sable, des bonnes qui causent, sur les bancs, avec des militaires, des amoureux qui se promènent en se tenant les mains… Vas-y donc, imbécile ! »
Et le merle s’est envolé ; et l’arbre universitaire, rendu à sa solitude, laisse pendre ses feuilles désillusionnées.
Amédée, dans sa confuse intelligence d’enfant, est en train de se demander pourquoi ce platane a l’air si morose, lorsqu’une porte s’ouvre, et M. Batifol paraît.
D’aspect farouche, en dépit de son nom presque inconvenant, le maître de pension ressemble à un hippopotame vêtu d’une ample lévite de drap noir. Il s’avance pesamment, salue M. Violette avec dignité, s’assied dans son fauteuil de cuir, devant ses paperasses, ôte sa calotte de velours et découvre une calvitie telle, une calvitie si volumineuse, si ronde et si jaune, que le petit Amédée la compare avec terreur à la sphère terrestre placée au sommet du bureau.
C’est tout à fait la même chose. Ces deux boules sont jumelles. Il y a même, sur le crâne de M. Batifol, une éruption de petits boutons de sang à peu près groupés comme les archipels de l’Océan Pacifique.
– « À quoi dois-je l’honneur ?… » demande l’instituteur d’une voix grasse, d’une voix excellente pour crier les noms d’un palmarès dans les distributions de prix.
M. Violette n’est pas hardi. C’est stupide, mais quand son chef de bureau le fait appeler dans son cabinet pour affaire de service, voilà qu’il est pris d’une espèce de bredouillement et que ses jambes flageolent. Un personnage aussi imposant que M. Batifol n’est pas fait pour lui donner de l’assurance. Amédée est timide comme son père, et, tandis que l’enfant, épouvanté par la ressemblance de la sphère avec la calvitie de M. Batifol, commence à trembler déjà, M. Violette se trouble, taquine sa mèche rebelle, cherche ses mots et ne dit rien qui vaille.
Cependant, il finit par répéter à peu près ce qu’il a dit à la maman Gérard : « Son fils va sur ses sept ans ; il est très en retard ; etc., etc. »
L’instituteur paraît écouter M. Violette avec un bienveillant intérêt, en inclinant de temps à autre son crâne géographique. Mais, en réalité, il observe et juge ses visiteurs. La redingote étriquée du père, le teint pâlot du petit bonhomme, tout cela sent la pauvreté. Il s’agit d’un externe à trente francs par mois. Rien de plus.
Aussi M. Batifol abrège-t-il le « speach » qu’il adresse, en pareille circonstance, à ses nouveaux clients.
Il se chargera de son « jeune ami » (trente francs par mois, c’est bien entendu, et l’enfant apportera son déjeuner dans un petit panier), de son jeune ami, qui sera d’abord placé dans une classe élémentaire. (Certains pères de famille préfèrent, et ont raison de préférer, la demi-pension, avec un repas à midi, sain et abondant ; mais M. Batifol n’insiste pas.) Son jeune ami sera donc mis d’abord dans une classe enfantine ; mais il y sera préparé tout de suite, ab ovo, à recevoir un jour les leçons de cette Université de France, alma parens (l’enseignement des langues étrangères n’est pas compris dans le prix ordinaire, naturellement), de cette illustre Université, qui, par le travail en commun, par l’émulation entre les élèves (les arts d’agrément : danse, musique, escrime, se paient aussi à part, cela va sans dire), prédispose les enfants à la vie sociale et en fait des hommes et des citoyens.
M. Violette se contente, et pour cause, de l’externat à trente francs. C’est une affaire bâclée. Dès le lendemain, Amédée entrera en « neuvième préparatoire ».
– « Donnez-moi la main, mon jeune ami, » lui dit le maître de pension, quand le père et le fils se sont levés pour prendre congé.
Amédée, très troublé, tend sa main, et M. Batifol y dépose la sienne, qui est si énorme, si lourde et si froide, que l’enfant frissonne au contact et croit toucher un gigot de mouton de sept à huit livres, tout frais arrivé de la boucherie.
Enfin, on s’en va. C’est fini. Mais le lendemain, dès le matin, Amédée, muni d’un panier où la vieille femme qui sent le tabac a mis une petite bouteille d’eau rougie, un peu de veau piqué et deux tartines de confitures, se présente à la pension Batifol, pour y être préparé, sans délai, aux leçons de l’alma parens.
L’hippopotame, vêtu de drap noir, sans ôter sa calotte cette fois, – au grand regret de l’enfant, qui voudrait s’assurer si le crâne de M. Batifol est quadrillé, comme le globe terrestre, par les degrés de latitude et de longitude, – conduit immédiatement son élève à la classe de « neuvième préparatoire » et le présente au maître.
– « Voici un nouvel externe, monsieur Tavernier… Vous verrez où il en est pour la lecture et l’écriture, n’est-ce pas ? »
M. Tavernier, long jeune homme au teint jaune, – encore un bachelier, celui-là, qui, s’il était aujourd’hui, comme feu son père, brigadier de gendarmerie dans un joli coin d’herbages et de pommiers en Normandie, n’aurait peut-être pas cette mine de papier mâché et ne serait pas vêtu, à huit heures du matin, d’un habit noir dans le genre de ceux qu’on voit pendus à la Morgue, – M. Tavernier accueille le « nouveau » avec un pâle sourire, qui disparaît aussitôt que M. Batifol s’est retiré.
– « Allez vous asseoir à cette place vide… là… au troisième gradin, » dit M. Tavernier d’un ton plein d’indifférence.
Il daigne pourtant conduire Amédée à la place qu’il doit occuper. Mais le voisin du petit Violette, l’un des futurs citoyens qui se préparent à la vie sociale, – plusieurs ont encore des culottes fendues par derrière, – a eu le tort d’apporter en classe une poignée de hannetons. Il attrape un quart d’heure de piquet, qu’il fera tout à l’heure au pied du platane rechigné de la grande cour.
– Vous verrez comme il est « chien, » murmure l’élève puni à l’oreille d’Amédée, dès que le pion est remonté dans sa cathèdre.
Mais M. Tavernier frappe avec une règle sur le bois de la chaire, et, ayant rétabli le silence, invite l’élève Godard à réciter sa leçon.
L’élève Godard, gros joufflu aux yeux endormis, se lève automatiquement. D’un seul jet, sans prendre haleine, pareil à un robinet qui coule, il commence à réciter : Le Loup et l’Agneau, et le texte de La Fontaine se déroule avec une rapidité folle, comme le fil d’une bobine mue à la vapeur.
« La-raison-du-plus-fort-est-toujours-la-meilleure-nous-l’allons-montrer-tout-à-l’heure-un-agneau-se-désaltérait-dans-le-courant-d’une-onde-pure… »
Tout à coup, l’élève Godard se trouble, il hésite. La machine a été mal graissée. Il y a un rat qui obstrue le robinet.
« Dans-le-courant-d’une-onde-pure… Dans-le-courant-d’une-onde-pure… »
Puis il se tait brusquement. Le robinet est fermé. L’élève Godard ne sait pas sa leçon ; il est condamné, lui aussi, à rester en faction sous le platane.
Après l’élève Godard, c’est l’élève Grosdidier, puis l’élève Blanc, puis l’élève Moreau (Gaston), puis l’élève Moreau (Ernest), puis l’élève Malapert, puis un autre, puis un autre, puis un autre encore, qui débagoulent, avec la même volubilité, avec la même inintelligence, avec la même voix de serinette, la cruelle et admirable fable. C’est agaçant et monotone comme une pluie fine. Tous les élèves de la « neuvième préparatoire » resteront dégoûtés, pendant quinze ans au moins, du plus exquis des poètes français.
Le petit Amédée a envie de pleurer. Il écoute avec une stupéfaction mêlée d’effroi les écoliers dévider tour à tour leur bobine.
Dire que, demain, il faudra qu’il en fasse autant. Jamais il ne pourra. M. Tavernier l’inquiète fort, aussi. Nonchalamment assis dans sa chaire, le pion au teint jaune, qui n’est pas exempt de prétention, malgré son habit noir du « décrochez-moi ça », se lime soigneusement les ongles et n’ouvre la bouche de temps à autre que pour en laisser tomber une menace ou une punition.
C’est donc cela, l’école !… Amédée se rappelle les gentilles leçons de lecture que lui donnait l’aînée des petites Gérard, cette bonne Louise, déjà si sage et si sérieuse à dix ans, quand elle lui montrait les lettres d’un alphabet à images, avec tant de patience et de douceur, du bout d’une aiguille à tricoter ; et l’enfant, pénétré, dès la première heure, de l’accablant ennui scolaire, regarde au dehors, derrière les vitres du châssis qui éclaire la classe, se mouvoir sans bruit les larges feuilles dentelées du platane mélancolique.