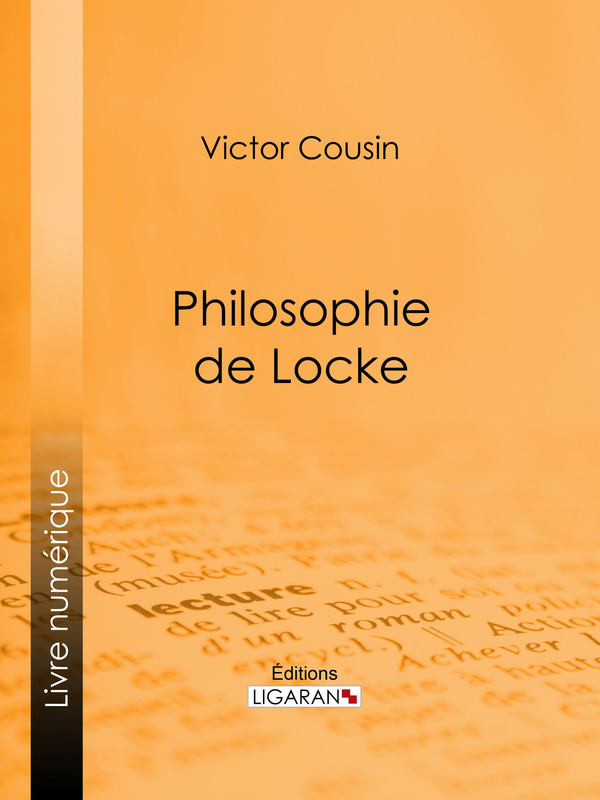
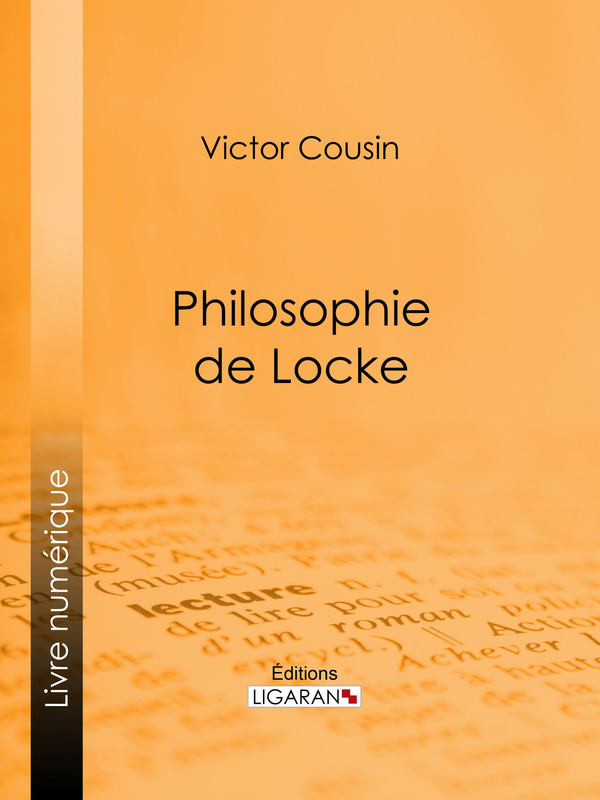

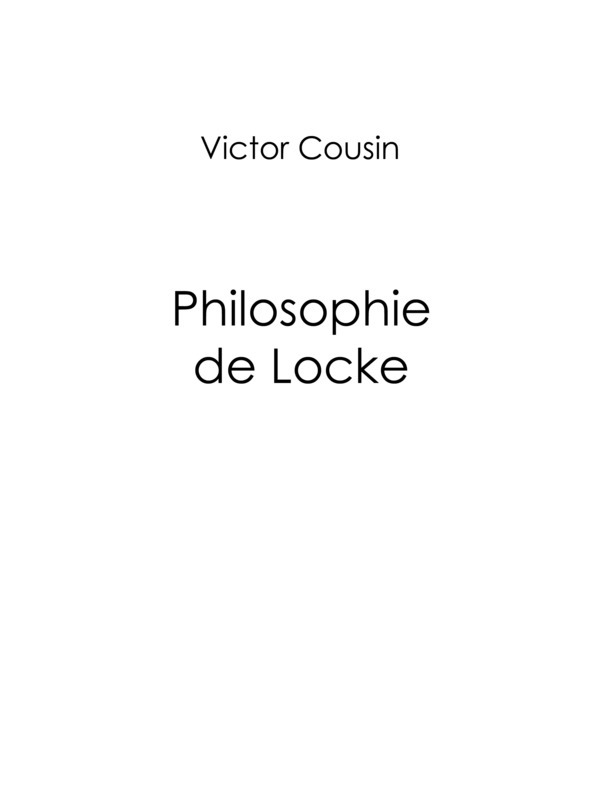
Voici de nouveau ces leçons de 1828 et 1829, si amèrement censurées par les uns et si vivement applaudies par les autres, durant cette courte et brillante époque de la Restauration à laquelle est attaché le nom de M. de Martignac. Il nous semble qu’aujourd’hui, à la distance de plus de trente années, nous en pouvons parler nous-même avec une vraie impartialité.
Pour être équitable, il faut un peu se mettre à notre place et se rappeler ce temps, si différent du présent.
Mes amis et moi nous sortions de la longue disgrâce qui, de 1820 à 1827, avait successivement atteint tout ce qui était libéral en France. M. Royer-Collard avait quitté la présidence du conseil de l’instruction publique, et on l’avait chassé du conseil d’État. On avait suspendu mon cours et celui de M. Guizot. Mes liaisons avec M. de Santa-Rosa, le noble chef de la révolution piémontaise de 1821, m’avaient rendu suspect à la triste police de M. Franchet, et elle m’avait dénoncé à celle de l’Allemagne pendant un voyage que je fis alors au-delà du Rhin. Accusé de je ne sais plus quelles extravagances, arrêté à Dresde, jeté en prison à Berlin, tenu au secret le plus rigoureux pendant plus de six mois, ma conduite en cette circonstance, les premières rudesses, puis la loyauté du gouvernement prussien qui s’était plu à reconnaître qu’on l’avait trompé, ses offres généreuses, celles du roi des Pays-Bas, mon refus de me séparer de mon pays dans la douloureuse épreuve qu’il traversait, tout cela m’avait composé une renommée bien au-dessus de mon mérite ; en sorte qu’après les élections de 1827, qui renversèrent le ministère de M. de Villèle et portèrent M. Royer-Collard, l’élu de sept collèges, à la présidence de la Chambre des députés, la nouvelle administration s’empressa de me rappeler avec M. Guizot à la Faculté des lettres, et nous reprîmes nos cours presque en triomphateurs.
Il n’est pas aisé, dans nos jours d’abaissement et d’affaissement intellectuel, de se faire une idée de la noble ardeur qui enflammait alors le génie français dans les lettres et dans les arts, aussi bien qu’en politique. L’esprit public faisait des chaires de M. Guizot, de M. Villemain et de la mienne, de véritables tribunes. Depuis les grands jours de la scolastique au douzième et au treizième siècle, il n’y avait pas eu d’exemple de pareils auditoires dans le quartier Latin. Deux à trois mille personnes de tout âge et de tout rang se pressaient dans la grande salle de la Sorbonne. Cette foule immense agissait inévitablement sur le professeur, animait, élevait, précipitait sa parole. Ajoutez qu’aussitôt prononcée, chaque leçon, sténographiée et à peine revue, paraissait bien vite, se répandait d’un bout de la France à l’autre, et devenait dans la presse le sujet d’une ardente polémique. Faut-il donc juger de tels cours comme des livres composés à loisir dans le silence du cabinet, et doit-on s’étonner d’y rencontrer bien des répétitions, bien des disparates, un style inégal, des mouvements abrupts, enfin l’improvisation prise en quelque sorte sur le fait, et jetée au vent de la publicité avec ses innombrables défauts ?
Mes premières leçons, celles de l’été de 1828, se ressentent fort, j’en conviens, de la promptitude avec laquelle M. Guizot et moi nous crûmes devoir faire usage de la parole qui nous était rendue.
Faute du temps nécessaire à une juste préparation, je dus prendre un sujet très général, qui ne demandât aucune recherche, aucun travail préliminaire, une Introduction à l’histoire de la philosophie, où les plus hautes questions furent abordées avec bonne foi et courage, et les solutions qu’en donnait la philosophie nouvelle exposées à grands traits, bien plus que véritablement établies. Sans venir ici témoigner contre moi-même, je n’ai pas besoin d’une grande modestie pour reconnaître que dans ce cours, tout à fait improvisé, il y a plus d’une proposition hasardée et des excès de langage que j’aurais fait bien volontiers disparaître, si la calomnie en les envenimant ne me les avait rendus irrévocables. L’honneur ne m’a pas permis de me corriger, et j’ai dû tout conserver pour n’avoir pas l’air de rien dérober à une critique ennemie. Je n’ai changé que des détails sans importance ; les passages incriminés subsistent, avec quelques noies explicatives et des éclaircissements tirés de mes propres écrits, antérieurs et postérieurs à ces leçons.
Oui, j’ai défendu, avec un peu de vivacité peut-être, l’indépendance de la philosophie, les droits de la lumière naturelle qui a découvert aux hommes assez de vérités, ce semble, et fait d’asse grandes choses dans le monde. Mais n’oubliez pas que c’était alors le temps de la guerre violente que faisait à la raison humaine l’abbé de Lamennais, et à sa suite tout ce qu’il y avait de jeunes talents dans le clergé. N’oubliez pas aussi que la philosophie n’avait pas été combattue seulement en paroles, et que j’attestais moi-même la proscription qu’elle avait soufferte. Mais à Dieu ne plaise que jamais il soit entré dans mon esprit et dans mon cœur la pensée vulgaire et coupable de rendre au christianisme le mal qu’on m’avait fait en son nom ! Ici, comme partout ailleurs, je montre pour la religion chrétienne un respect que nulle épreuve n’a troublé ni diminué, parce qu’il est emprunté à mes convictions les plus intimes et à la philosophie elle-même.
Encore un aveu, et qui ne me coûte point. J’avais autrefois rencontré à Heidelberg, encore obscur mais déjà rempli de vastes desseins, celui qui devait être M. Hegel. Sans le bien comprendre, dès 1817 je l’avais en quelque sorte deviné et annoncé. Je le retrouvai en 1824, à Berlin, à la tête d’une école florissante, et en 1826 il était venu me faire visite à Paris. J’aimais M. Hegel ; j’admirais la vigueur de son esprit, et cette fermeté imperturbable avec laquelle il appliquait l’ancien système de M. Schilling, méthodiquement développé, à toutes les parties des connaissances humaines, même à celles qui s’y prêtaient le moins ; par exemple, à l’histoire de la philosophie, où M. Hegel comme M. Schelling n’avait que des vues fort générales, sans nulle étude approfondie. En 1828 j’étais encore trop près de mes souvenirs d’Allemagne pour que les grandes généralisations et les formules un peu altières auxquelles j’étais accoutumé ne déteignissent pas un peu, si on me passe cette expression, sur ma pensée et sur mon langage ; et il se peut que mes paroles aient quelquefois présenté à des esprits prévenus ou peu familiers avec ces matières délicates, l’apparence d’une doctrine assez favorable au panthéisme. Mais certes jamais apparence ne fut plus loin de la réalité ; car, bien avant 1828, l’amitié dont m’honorait M. Schelling m’avait fait connaître le changement, ou, si l’on veut, le développement nouveau qui s’était fait dans ce grand esprit, et j’y avais fort applaudi. J’avais l’habitude, même avec M. Hegel et ses plus dévots disciples, de me licencier un peu sur le compte de ce fameux Être en soi, das reine Seyn, pur de toute détermination, et qui par une suite de métamorphoses merveilleuses devient le principe de toute détermination, de la qualité comme de la grandeur. Partout dans notre enseignement de 1828 et de 1829, comme dans celui de 1815 à 1821, règne la doctrine la plus opposée au panthéisme, celle de l’intelligence, comme enfermant la conscience et la personnalité ; en sorte qu’il faut choisir entre un Être premier, dépourvu d’intelligence, s’il est sans personnalité et sans conscience, ce qui est l’athéisme ordinaire, et un Être premier, véritablement intelligent, qui se connaît lui-même, ainsi que l’univers et l’homme, et préside à la destinée de son ouvrage. C’est là le théisme à proprement parler : quelques inexactitudes de détail, loyalement expliquées, ne l’altèrent point ; il est le fond permanent de tous nos écrits, l’âme de notre philosophie. Qui le professe est avec nous ; qui s’en écarte est contre nous, eût-il été jadis dans notre auditoire et nous fût-il cher à d’autres titres. Le spiritualisme n’est qu’un mot s’il n’aboutit à un théisme nettement déclaré et solidement établi. Voilà pourquoi la philosophie française de M. Royer-Collard et de M. de Biran, celle qui veut bien nous reconnaître pour interprète et nous permettre de la guider à travers les écueils semés sur sa route, n’a rien à voir avec la philosophie d’au-delà du Rhin. Comme nous le disions il y a près de vingt années : « À mesure que la philosophie allemande s’est plus développée et que nous l’avons mieux connue, nous nous en sommes séparé plus ouvertement, et on peut dire que l’école qui se prétend aujourd’hui héritière de M. Hegel n’a pas d’adversaires plus décidés que mes amis et moi pour la forme, pour les principes comme pour la méthode. »
Les leçons de 1829 présentent, on a bien voulu le reconnaître, un tout autre caractère que celles de la précédente année. La préparation nécessaire, qui nous avait manqué jusqu’alors, nous ayant été permise, nous pûmes choisir des sujets précis et bien déterminés sur lesquels s’établit un sérieux et régulier enseignement, qui, en rappelant et continuant nos cours de 1815 à 1821, en étendit la portée, en agrandit l’influence. L’analyse et la dialectique reprirent le rang qui leur appartenait à côté de l’histoire. Les trop éclatants succès de 1828 servirent du moins à retenir la foule et à lui faire supporter des expositions plus solides que brillantes et des discussions sévères. C’était un assez curieux spectacle de voir un si nombreux auditoire assister avec un intérêt soutenu à l’examen critique des diverses écoles de l’Inde, de la Grèce, du Moyen Âge et des temps modernes, et à l’analyse méthodique et détaillée des idées de l’espace et du temps, de l’infini, de la personnalité, de la cause, du bien et du mal. Ces nouvelles leçons, fort différentes de leurs aînées, ont fait autrefois quelque bien, et nous avons l’espoir que les deux volumes qui les représentent en feront encore.
Le premier de ces volumes offre une esquisse de l’Histoire générale de la Philosophie, depuis ses plus faibles commencements jusqu’au dix-huitième siècle, qui devait être le sujet spécial du cours. Oserons-nous dire que cette esquisse, si imparfaite qu’elle soit, a jeté en France les fondements de l’étude vraiment philosophique de l’histoire de la philosophie ? Tous les systèmes y sont ramenés à quatre systèmes élémentaires, qui ont de si fortes racines dans la nature humaine qu’elle les reproduit sans cesse. Leur lutte constante est le fond même de l’histoire. Discerner en eux le vrai et le faux, le faux qui passe et le vrai qui dure ; mettre à profit les erreurs en montrant les causes, à savoir l’exagération même du vrai, l’ambition des principes absolus, l’imprévoyance et la précipitation de l’esprit humain ; surtout recueillir les vérités qui sont nécessairement dans tout système un peu célèbre, qui l’ont fait naître et qui l’ont soutenu, et porter ces vérités dégagées, épurées, réunies à la lumière de notre siècle, comme l’enfantement légitime du temps, ainsi que parle Bacon, le legs du passé et la dot de l’avenir, telle est, selon nous, la tâche de l’historien philosophe, telle est l’œuvre ou du moins tel est l’objet de l’éclectisme. L’éclectisme n’est point un système, c’est une méthode, une certaine manière de considérer les choses, trop élevée sans doute pour être populaire et courir le monde, mais aussi trop raisonnable pour être entièrement nouvelle. L’éclectisme est déjà, en effet, dans Platon et dans Aristote, autant et mieux que dans Plotin lui-même Au faîte du plus grand siècle qui fut jamais, Leibniz croit se proposer un assez haut dessein de chercher et de rassembler les membres épars de la philosophie immortelle disséminée à travers tous les systèmes : son école est ouvertement éclectique. L’éclectisme, c’est l’intelligence en histoire, c’est le discernement assuré du vrai et du faux, fondé sur l’expérience des siècles. Il n’étouffe pas sous l’érudition, comme on l’a prétendu, la vraie, la grande originalité, qui vient de Dieu, mais il confond la petite et la fausse, née d’une vanité impuissante. Il ne coupe pas les ailes au génie, mais il le protège contre les attraits des principes extrêmes dont l’histoire montre la fragilité. Il recommande la modération, si nécessaire à la force. Il enseigne la prudence et la sagesse, auxquelles seules la durée a été promise dans la philosophie comme dans tout le reste. Où est aujourd’hui, je vous prie, cet insolent système qui un moment éblouit et pensa subjuguer l’Église, qui se vantait d’avoir mis à jamais la religion au-dessus de toute controverse en foulant aux pieds la raison, en lui refusant le pouvoir d’arriver par elle-même à aucune vérité, en proscrivant à tort et à travers toute philosophie, la bonne comme la mauvaise et la bonne plus encore que la mauvaise, comme plus capable de séduire l’humanité ? Son auteur même l’a répudié, pour se jeter dans un autre excès : esprit puissant et extravagant, qui ne pouvait habiter que des abîmes. Et qu’est aussi devenue cette métaphysique hégélienne qu’on nous donnait, pendant les jours néfastes de 1848, comme le dernier mot, non seulement de la philosophie allemande, mais de toute spéculation philosophique, et qui n’était qu’un renouvellement passager d’un mal, hélas ! trop ancien, le vieil athéisme, rajeuni sous le nom de panthéisme, et décoré des livrées de la démagogie ? L’éclectisme n’a connu ni ces triomphes éphémères, ni ces chutes profondes. En dépit des attaques qui lui ont été prodiguées par tous les partis extrêmes, il a résisté comme le sens commun, et il est encore la lumière du petit nombre d’hommes qui ont consacré leurs veilles à l’histoire de la philosophie. On a remarqué axant nous que s’il périssait avec nos ouvrages, on le retrouverait dans beaucoup d’historiens qui s’en inspirent en le combattant.
N’étant point ici retenu par des scrupules d’honneur, comme pour nos leçons de 1828, nous avons pu corriger plus d’une erreur qui nous était échappée, réparer quelques lacunes, et soit dans les notes, soit dans le texte même, étendre et fortifier diverses parties de cette esquisse, particulièrement tout ce qui se rapporte à la grande philosophie du dix-septième siècle, à Descartes, à Spinoza, à Malebranche, à Leibniz.
Nous avertissons aussi le lecteur studieux qu’il peut se fier à la scrupuleuse exactitude de nos citations. Il n’y en a pas une qui soit de seconde main. Nous les avons tirées, non des historiens qui nous ont précédé, mais des auteurs eux-mêmes, dans les éditions les meilleures et quelquefois les plus rares, que des recherches assidues nous ont permis de rassembler.
Le second volume de l’année 1829 (le troisième de cette collection) est consacré à l’examen critique de la PHILOSOPHIE DE LOCKE. L’état de la philosophie en France, où les restes de l’école de Condillac et des Encyclopédistes du dix-huitième siècle s’agitaient contre la philosophie nouvelle, nous imposait cet examen qui, à travers Locke, atteignait ses modernes disciples, et couvrait l’école spiritualiste en livrant un sérieux combat à ses adversaires. Sans doute, avant nous, Leibniz dans ses Nouveaux Essais sur l’Entendement humain, avait donné une admirable réfutation de Locke ; mais cette réfutation, très solide en elle-même, avait perdu son autorité par le mélange des hypothèses leibniziennes, depuis longtemps abandonnées et décriées, la monadologie et l’harmonie préétablie. Il fallait une critique nouvelle pour des temps nouveaux : celle-ci a été jugée capable d’arrêter un esprit sincère à l’entrée ou sur la pente du sensualisme. On n’ose rappeler l’éloge qu’en a fait le plus grand critique de notre temps, sir William Hamilton. Un philosophe américain, M. Henry, en a tiré un traité complet de psychologie qui sert aujourd’hui de manuel de philosophie dans la plupart des universités américaines. En Angleterre, ce volume a été le sujet d’une vive et utile controverse qui dure encore. Notre illustre maître, le juge austère et vénéré de nos intentions et de nos travaux, M. Royer-Collard, considérait comme les moins imparfaits de nos ouvrages, les moins indignes de le rappeler, la PHILOSOPHIE ÉCOSSAISE et la PHILOSOPHIE DE KANT, dans nos premiers cours, et cette PHILOSOPHIE DE LOCKE qui couronne les seconds.
La révolution de Juillet a mis fin à nos leçons publiques, mais non pas à notre carrière de professeur. Nous l’avons poursuivie, de 1830 à 1840, dans les conférences que nous faisions à l’École normale, quand nous avions l’honneur de diriger cette grande école. Nous étions ramené pour ainsi dire à notre berceau ; c’est là que nous avions commencé, c’est là que nous avons terminé notre enseignement. Ces sérieuses et intimes conférences comprennent et représentent l’âge mûr de notre vie et de notre pensée. On en peut voir des traces de plus en plus marquées dans les écrits que nous avons publiés depuis 1830. Mais leurs meilleurs fruits ont été ces excellents élèves devenus à leur tour des maîtres dignes de continuer leurs devanciers. C’est à eux, comme à leurs rivaux dans les luttes de l’agrégation et dans les concours académiques, qu’il appartient de défendre et d’honorer la philosophie sortie du sein de l’Université. Quand on est arrivé à l’âge du repos, on peut remettre avec confiance ses armes à une pareille milice. Cæstus artemque repono.
V. COUSIN.
1er février 1861.