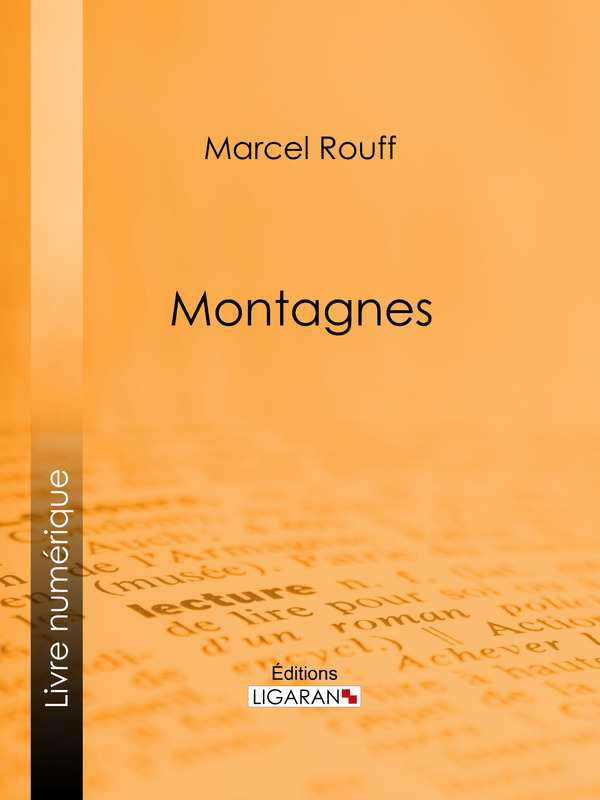
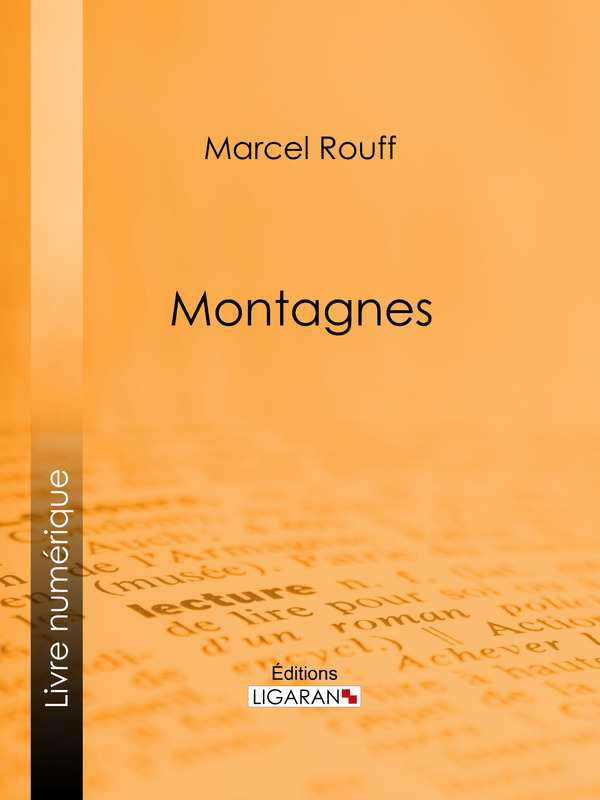

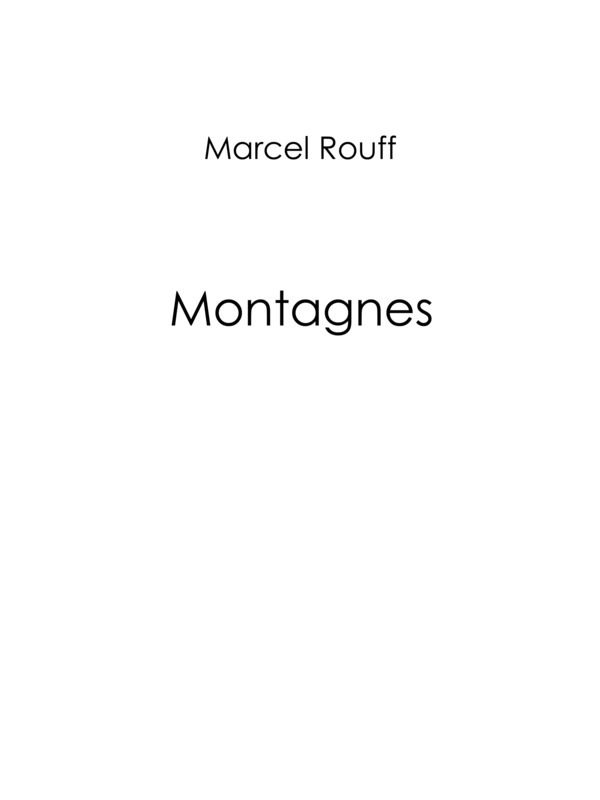
À MA MÈRE
qui, au temps de ma jeunesse, a si souvent attendu avec anxiété mon retour de là-haut.
M. R.
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin. »
MUMMERY.
Pour les âmes – rares – qui ne goûtent pleinement les voluptés du destin terrestre que dans les formes ardentes, excessives et métaphysiques de la nature, il n’y a pas de choix à faire entre la Mer et la Montagne. Pas plus que pour le grand buveur entre le Bourgogne et le Bordeaux. Seul l’amateur de petit pinard ergote sur les deux glorieux vignobles. Seul aussi le dégustateur des boulingrins de banlieue, bordés des honnêtes fusains boutiquiers, croit que s’il penche son âme inconsistante sur les glaces éternelles, ce doit être aux dépens du ressac des plages marines et qu’il est tenu d’opter. Allons donc ! Est-ce que don Juan, l’Amateur-Roi et l’un des seuls authentiques chercheurs de son âme, a jamais préféré la châtaine à la rousse, la brune à la blonde ?
Au vrai, quiconque est capable d’atteindre les allégresses éternelles, de savourer l’Infini et l’Absolu qui le tourmentent dans le hululement, doux comme les soupirs de volupté, d’une voile pleine de vent, dans la crispation de la main sur la barre qui gouverne au grand large, dans l’odeur de sel et d’iode qui grise comme un opium, dans le bondissement du soleil marin sur les crêtes de chaque houle dont il fait des millions de joies, dans le crissement de la barque, libérée de ses entraves et courant sur l’océan sans forme vers les aventures du destin, dans des heures anormales de liberté et d’euphorie, quiconque s’exalte au-dessus de lui-même et baise l’ombre du grand Pan sur la bouche dans un matin d’évasion océane où l’on a largué les amarres de la vie coutumière pour voguer dans l’indéterminé de l’eau et de la lumière, se haussera également jusqu’à sa propre personnalité divine – épurée, épanouie, joyeuse – au contact de la montagne. Prendre par-dessus le bord, au glissement du bateau, la mer tiède et douce dans ses mains, comme on caresse le sexe d’une maîtresse, ou se coucher sur la roche chaude d’une arête comme on se couche sur le corps nu d’une femme, c’est toujours posséder physiquement et psychiquement l’Univers. L’odeur des pins monte vers la senteur fraîche de la neige, les parfums de salpêtre et de soleil qui émanent des pierres géantes, coulent à leur rencontre, étreinte d’haleines mystérieuses unies par le vent. Dans le silence, qui n’est plus ici la trêve des bruits, mais une vraie pensée enfermée éternellement en elle-même, le craquement du glacier semble le cri bref de quelque cauchemar monstrueux ; le bruissement des séracs qui s’écroulent ou des cailloux qui glissent sur les pentes luisantes de neige souligne et accuse l’immobilité muette et définitive de ce monde désert. Le soleil, frère ardent de ces froides étendues cosmiques, verse la débauche de toutes ses dorures éclatantes ou mauves, rutilantes ou roses, vermeilles ou pâles sur un univers bouleversé de granit, et partage en bleu d’eau pure, suivant sa position, et en scintillements diamantaires tous les dômes, toutes les crêtes, toutes les lames, toutes les arêtes, toutes les vagues figées de glace.
Là-bas, sur un ressaut d’une falaise vertigineuse, monte une fumée droite dans le ciel sans souffle. En quoi les intrépides qui campent là, au milieu de cette tentative géante de la terre pour escalader le ciel, dans les solitudes de cette cathédrale surnaturelle et bouleversée dont toutes les lignes blanches ou ambrées ou grises ou rousses s’élancent et jaillissent comme une forêt de pierres, en quoi diffèrent-ils dans leur âme des coureurs d’horizon qui, sur l’océan, tendent leur voile vers un infini qu’ils n’aborderont jamais ? Navigateurs ou montagnards, leur volupté réelle consiste à s’absorber dans l’immense, à s’affranchir des règles et des lois de la terre, à se grandir jusqu’aux proportions du monstre d’eau ou de roc qu’ils défient. Les Alpes et l’Océan se savent de la même famille dans leurs colères identiques qui mettent trop souvent leurs sectateurs et leurs vainqueurs d’accord.
La montagne et la mer sont les plus sublimes des jeux de l’homme avec la mort, parce que ce sont des jeux inutiles. Leur éthique et leur esthétique ne se servent des sens qu’en tant qu’agents transmetteurs. Mais leur vraie beauté réside ailleurs que dans le monde perceptible. Leur action dépasse de beaucoup les allégresses corporelles, si nobles soient-elles. Elle atteint la béatitude éternelle de l’être harmonieux et épanoui. Whymper, le dieu des Alpes, a déclaré qu’il n’a jamais regardé la vue d’un sommet. Les coureurs de grand large ne cinglent pas vers des horizons précis, ne se donnent pas au désert d’eau monotone ni à la ligne droite qui se dérobe sans cesse devant la pointe de leur beaupré. Du vent qui les dilate les uns et les autres et les fait éclater d’aise, de la lumière qui brutalise leurs yeux et les fait déborder, de la caresse des rudes senteurs qu’ils respirent avec toute la peau de tout leur corps, ils n’attendent que cette fièvre supérieure, que cette eurythmie de l’âme où toutes ses vertus s’exaltent et se balancent, où la vie s’équilibre paisible, totale, purifiée au bord de la mort. C’est cela qu’ils vont chercher là-haut et là-bas. Jamais Mummery ne s’est aussi souverainement senti calme, joyeux dans la possession de soi-même, apaisé dans un cœur qui bat normalement, conscient d’une plénitude sans ombre que pendant les deux jours et la nuit qu’il a passés sur la pente de glace hallucinante de l’Aiguille du Plan en tête à tête avec le danger. Il y a quelque chose de plus beau et de plus heureux que le spectacle de mille pics à la parade, de cent glaciers étalés, de croupes monstrueuses, de rocs crénelés et déchirés : se rencontrer, se posséder soi-même, prendre au-dessus, à côté du gouffre qui est prêt à vous accueillir, la mesure complète de la vie.
Jeu inutile ? Plus exactement dénué de toute utilité pratique et même directement altruiste. Mais quand même ! Quel gain pour l’humanité, en fin de compte, de pouvoir inscrire à ses bénéfices des Volontés qui se sont réalisées et grandies à la taille du monde lui-même. J’ai entendu souvent, au retour de caravanes épuisées, murmurer sur leur passage : « À quoi cela sert-il de monter là-haut ? » Réflexion de pauvres larves rampantes ! L’effort dangereux seul compte parce que la vie personnelle et mesquine ne se dilate jusqu’à se fondre dans la vie universelle, ne prend son sens et sa valeur et n’irradie sa profonde lumière que conférée avec la mort qui l’escorte.
Telle a été du moins la trempe des pionniers, des ancêtres. Telle a été la saveur de leurs premières victoires. Nous répéterons souvent qu’ils ont surtout demandé aux rudes et meurtrières batailles contre la montagne inconnue la révélation d’eux-mêmes. Au sommet du Cervin, enfin conquis après tant de tentatives passionnées et vaines, Whymper et Douglas auraient échangé ces phrases que rapporte Carl Haensel et qui, vraies ou fausses, expriment bien l’être profond :
DOUGLAS.– Dites-moi, que feriez-vous donc si un nuage nous recouvrait en ce moment ?
WHYMPER.– Exactement ce que je fais maintenant. Jamais je n’ai gravi un sommet pour le plaisir de la vue.
DOUGLAS.– Oui, je suis tenté de croire que, fussiez-vous même né aveugle, vous vous seriez fait hisser jusqu’ici.
WHYMPER.– Et j’aurais alors palpé de mes pieds le sommet, j’aurais éprouvé des sensations toutes pareilles à celles de l’instant présent. La même plénitude.
La Plénitude ! L’épanouissement de l’effort calmé, de la volonté victorieuse ! La vie d’en bas vaincue et dominée en même temps que la cime ! La conquête d’un sommet et de soi-même !
Aujourd’hui les choses ont bien changé. Mais même sur le terrain sportif où il est désormais placé, l’alpinisme a une valeur et une portée spéciales. « Vaincre » au tennis, au rugby, à la boxe veut dire « dominer un ou d’autres êtres ». La victoire d’un conquérant de sommets est d’une autre essence. Vaincre les cimes, c’est autre chose qu’opposer sa matière musculaire à leur matière. C’est les dompter par son intellectualité et sa sensibilité.
L’histoire des Alpes est balancée entre deux esprits : la période héroïque – qui s’est prolongée longtemps, jusqu’à la fin du XIXe siècle – la période héroïque fait de la montagne un amour, une école morale, une métaphysique. Les premiers conquérants, bafoués, repoussés par les cimes, reviennent obstinément chaque année au rendez-vous fervent qu’elles leur donnent traîtreusement jusqu’à ce qu’ils aient enfin violé la maîtresse imprenable. Ils ne possèdent pas la montagne, c’est la montagne qui les possède. Cette passion leur apporte ce qu’apporte toute passion : le moyen de s’élever au-dessus d’eux-mêmes, de réaliser leur âme. Assurément le corps à corps avec la difficulté et le péril est déjà en soi-même un assez bel enseignement et une assez haute leçon. Mais il ne leur suffit pas encore de déguster les joies des volontés tendues et victorieuses, les ivresses de la peur vaincue et de l’instinct dompté, la sérénité du courage qu’on s’impose et la domination de ses nerfs qu’on s’inflige. Ils portent obscurément leur siècle. Au romantisme finissant et qui, dans sa ferveur d’exalter l’individu, a tout permis, tout autorisé – même le crime parfois – Nietszche a mêlé l’encens de la surhumanité, paroxysme d’individualisme, appel aux êtres de trempe, incitation à se mesurer avec la Nature et avec Dieu. Les grands élans d’idéalité ont rallumé dans les cœurs, nés conquérants, l’orgueil de Prométhée. Au sommet du Cervin comme du Weisshorn, du Grépon comme du Tour Noir, les yeux visionnaires découvrent la flamme à arracher pour la rapporter sur la terre.
Les victoires successives des hommes de fer que nous allons retrouver tout à l’heure et qui mirent un à un les sommets les plus rebelles sous leurs piolets, entraînèrent après elles le flot boueux des trains de plaisir et des billets de famille. Le temps des Tartarins, qui dure toujours – des Tartarins et des Périchons – vint rapidement et les Alpes, domaine des élites morales, connurent bientôt la popularité discutable des peaux de saucisson, des papiers gras et des boîtes de sardines vides.
Pourtant, elles n’ont toléré ce viol que dans une certaine mesure. On ne va pas encore pique-niquer sur l’arête des Courtes ni sur les parois du Grand Dru. Il y a encore d’immenses domaines réservés aux aristocraties de l’audace, de la fermeté, du courage et du sang-froid. Seulement ce n’est plus l’esprit des temps héroïques qui passe là-haut dans le vent des arêtes, dans le rude travail des piolets contre les murs de glace. Pas plus qu’un fervent du football ne dédie – tel autrefois le chevalier dans la lice – le coup d’envoi à quelque dame mystique ou terrestre, les grimpeurs de la période moderne n’apportent aux escalades la ferveur sentimentale, l’amour passionnel. Ils font du sport, du grand et du beau sport, qui exige assurément plus de vertus psychiques que le golf ou le tennis et qui, toujours, a la vie comme enjeu. Mais du sport quand même avec tout ce que ce mot comporte désormais de sèchement, de spécifiquement physique, d’exclusivement musculaire, de recherche d’exceptionnel, de préoccupation de records. Même un Mummery, qui assura la transition entre la période morale et la période sportive en introduisant dans l’Alpinisme la notion acrobatique et en en fixant la technique, même un Mummery a été durant toute sa vie de conquérant de sommets, dominé par des notions plus hautes que la valeur des muscles ou les appels de l’orgueil. Durant cette nuit de l’Aiguille du Plan, sur ce mur où il semble impossible à des êtres humains de s’aventurer, devant le pas fameux de la Dent du Requin qu’il fut le premier à oser forcer, au cours de sa fantastique première escalade des falaises inaccessibles du Grépon, les joies de Mummery se sont épurées au cours de la bataille de tout ce qu’il y a de spécifiquement matériel dans l’effort, de ce qu’il y a de purement sportif dans l’accomplissement de ce qui n’a jamais été réussi. Elles s’imprègnent de la lumière des victoires, des victoires sur l’Ennemie adorée, sur soi-même surtout. Ce n’est pas l’homme des records ou des simples exploits corporels – quoiqu’il en ait – qui a écrit ces lignes, les plus calmes, les plus hautes en qualité d’âme qui soient sorties d’un tête-à-tête conscient avec la mort : « Le vrai grimpeur, jugeant par ses habitudes, emporté par des sentiments d’altruisme et pensant simplement au salut de ses futurs compagnons, préférera que la loi de survie du plus apte ait libre carrière et le passe lui-même à son feu d’épuration ». Et ce n’est pas un simple acrobate non plus qui a pensé ces mots, si vastes, si purs, si profonds que, tout à coup, ils dépassent même l’immensité des monts et semblent résonner comme une leçon du Destin : « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Avec ceux de cette obédience, l’acrobatie sportive est encore imprégnée des éclairs mystiques de Whymper : un sommet est encore une âme – leur âme.
L’alpinisme est donc devenu un sport, avec tout ce qui vicie et magnifie le sport. Il a cessé d’être un amour et une religion. Est-ce la faute de l’admirable groupe de montagnards actuels devant lesquels nous nous inclinons ? En aucune façon. C’est la faute du siècle. Quand les hommes d’action et de bravoure dédiaient leurs besoins de conquête, de grandeur, d’exaltation d’eux-mêmes, de défi à la mort, d’appétit de souffrir aux expéditions lointaines, aux explorations africaines ou asiatiques, aux horizons maritimes inconnus, les coureurs de cimes participaient de cet état d’esprit, de ce courage pour ainsi dire philosophique. Tout a changé. Les héros du jour ne sont plus les Crampel, les Brazza, les Flatters, les Stanley, les Scott, le dernier des beaux chevaliers qui ont resplendi de la sublimité de Don Quichotte et qui s’estompe déjà, lui aussi, dans le passé. Les temps sont revenus des gladiateurs, des jeux du cirque et de l’audace pour l’audace. Les matelots de Jason ne chantent plus aux bastingages des navires qui s’en vont vers les mers fabuleuses et les toisons d’or des îles inconnues. Le fin du fin consiste à faire comme Gerbault le tour du monde sur une barque solitaire et silencieuse. Record. Les pionniers, poussés par leur foi et obsédés par une phrase des Écritures, ne mènent plus leur longue théorie de chariots sur les dangereuses pistes indiennes de l’Amérique hostile : une nation ahurie et enthousiaste contemple sur un autodrome perfectionné un être humain qui pendant une heure au volant d’une machine roule dans la mort à 385 kilomètres à l’heure ou dans l’air un aviateur qui, défiant toutes les lois physiques approche des 600 kilomètres. Record. Les boxeurs imposent leurs poings au monde délirant. Les équipes de football et de rugby traînent après elles les foules ferventes que ne soulèvent plus que les strophes musculaires des buts et des essais, et les joueurs de tennis au-dessus du filet s’envoient la gloire à la volée.
Comment les alpinistes seraient-ils demeurés ce qu’ils étaient autrefois ? Fatalement les uns devaient introduire dans leur matériel le chronomètre des records, et les autres, ivres, avec le même droit que leurs frères sportifs, de l’exceptionnel, de l’incroyable, du stupéfiant, de la performance, n’ayant plus à leur portée de cimes vierges à conquérir, comme leurs aînés, par les voies les meilleures, les plus accessibles, se ruent à l’assaut d’arêtes pour ainsi dire surhumaines et qui ont fait reculer les premiers conquérants, forcent des routes où il ne semblait pas que pût passer une créature terrestre, franchissent des cols auxquels les grimpeurs de jadis n’auraient même pas songé. On m’a conté quelques exploits contemporains auprès desquels les voltiges des trapézistes de cirque ne sont que jeux d’enfants. Moi-même, environ 1912, au cours d’une de mes dernières ascensions, j’ai vu à la jumelle travailler une équipe de néo-alpinistes dans une paroi à donner le frisson et que personne n’aurait eu l’idée d’aborder il y a vingt ans. Cette rapidité d’ascension, cette technique bien fixée, neuve et scientifique, cette indifférence à la magnificence et la somptuosité du péril dont les vieux faisaient leurs obscurs délices, cet automatisme presque, révèlent bien que les temps nouveaux sont venus de l’alpinisme sportif.
L’ère héroïque des Alpes s’ouvre le 8 août 1786, le jour où Balmat et Paccard atteignent le sommet du Mont-Blanc. Pour la première fois, les pas et la voix des hommes troublent le silence de ces chaos de rocs et de glaces. Les solitudes peuplées d’êtres féeriques et légendaires sont violées. Les fables vont désormais reculer devant les messagers de la réalité.
Balmat et Paccard ! Le vrai vainqueur du géant est en réalité Horace Bénédict de Saussure. C’est lui qui, hanté par la vue de la « Grande Montagne » qu’il a sans cesse devant lui de son Genthod, au bord du lac de Genève, obsédé par l’idée de poursuivre sur les hautes altitudes ses observations scientifiques, a lancé les hommes de Chamonix à l’assaut de ce massif dont le sommet pâle domine l’Europe. Il a promis à qui atteindrait la cime une bonne récompense. Personne dans la vallée ne songe à s’évader de son rayonnement. On combat les mystères et les défenses du monstre sous ses couleurs. Après chaque tentative, ceux qui sont entrés en lice lui expédient des nouvelles ou des courriers. C’est vers lui que se tournent tous les chercheurs de routes. Lui, d’ailleurs, n’est possédé par aucune passion sportive. Il reste pur de tout orgueil. Il est libéré de tout instinct de conquérant. Il ne tient pas le moins du monde à poser le pied le premier sur la cime vaincue. C’est un savant, uniquement un savant qui devine que ses instruments hissés à des hauteurs exceptionnelles, lui donneront d’intéressantes constatations. Et un poète aussi – qui en douterait après avoir lu ses admirables pages – qui pressent dans ce désert blanc d’admirables sensations neuves. Il ne demande qu’une chose : qu’on lui ouvre la voie. De Saussure est donc l’Initiateur, on dirait aujourd’hui l’Animateur, en somme, l’âme de la conquête du Mont-Blanc. À son appel, plusieurs équipes se mettent à l’œuvre. C’est l’équipe Balmat-Paccard qui réussit.
En apparence, rien de plus simple.
De l’équipe victorieuse, c’est Balmat, le guide, qui recueille la plus grande part de gloire parce qu’on admet que c’est lui qui a donné le plus grand effort et qui a inventé la route du sommet. Au moment même de la victoire ses concitoyens et bon nombre de ses contemporains ont accepté cette version. Eux qui avaient assisté à la lutte, ils n’ont pas mis en doute l’essentiel de ses récits. Ils ont transmis à leur postérité l’admiration de Balmat. Leurs descendants, fidèles à la tradition établie depuis 1786, ont perpétué le souvenir du vainqueur du Mont-Blanc par un médaillon de bronze sur le mur de l’Église de Chamonix et par un monument où il est associé à de Saussure sur une des places du bourg.
Est-ce là la stricte vérité ? Il y a un mystère du Mont-Blanc. Une énigme qui ne sera peut-être jamais déchiffrée, un secret qui ne sera peut-être jamais percé : Balmat et Paccard ont atteint ensemble et les premiers la plus haute cime d’Europe. Mais qui des deux, après vingt tentatives diverses et infructueuses, a eu l’idée d’essayer le chemin qui a mené à la victoire ? Qui des deux surtout, la route étant choisie, a conduit et soutenu la rude ascension de sa volonté ?
Depuis quelques années, la gloire de Balmat ne paraît plus aussi intacte ni sa statue aussi solide. Les polémiques qui se sont élevées de son vivant déjà – mais timides et sans grand écho – ont pris, dans l’histoire, plus d’ampleur. Y a-t-il lieu de le dépouiller de sa gloire ? Sans doute faut-il en plusieurs points réviser la légende. Mais, à notre avis, il faut réagir aussi contre la tendance qui voudrait l’anéantir complètement. Avant d’essayer de retoucher son histoire, pour en conserver des parties, pour en redresser d’autres, il est nécessaire de présenter l’homme tel que sa vallée natale a voulu le voir et en a transmis l’image à la postérité. Et puis, nous tenterons, après tant d’autres, d’attribuer à chacun ce qui lui revient.