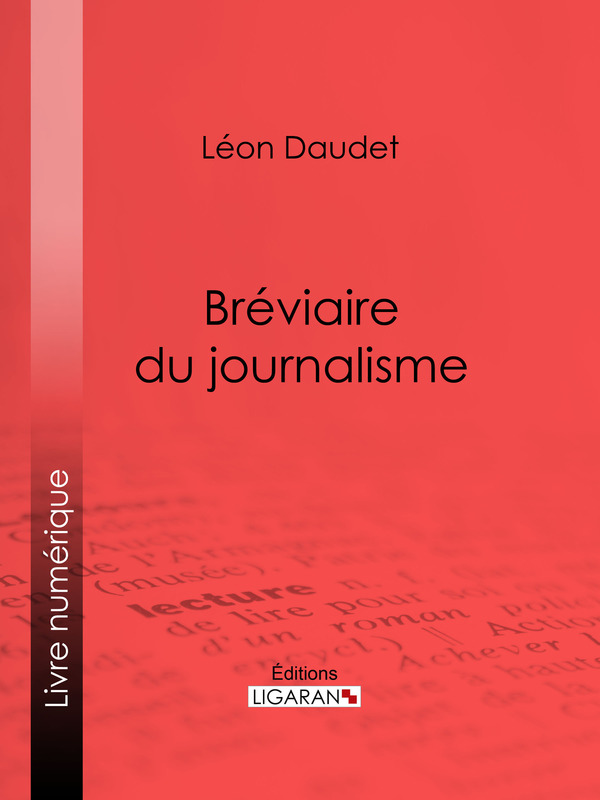
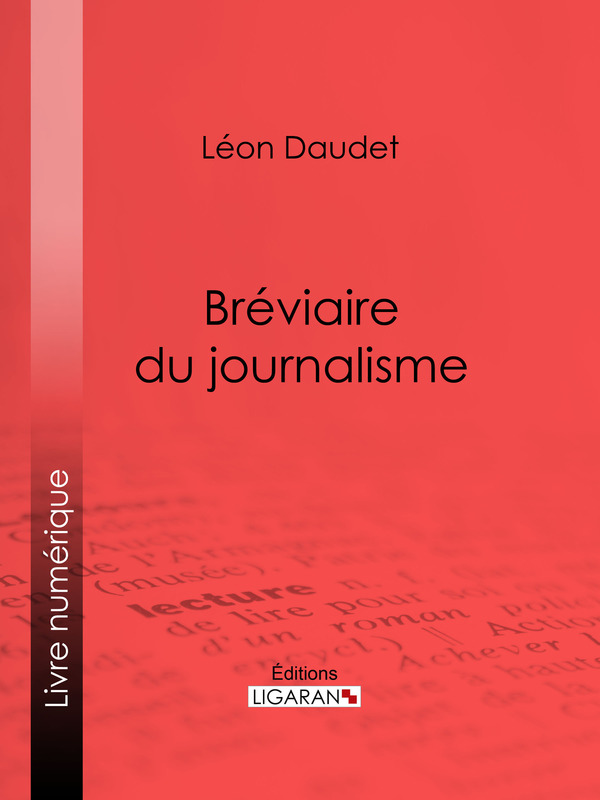

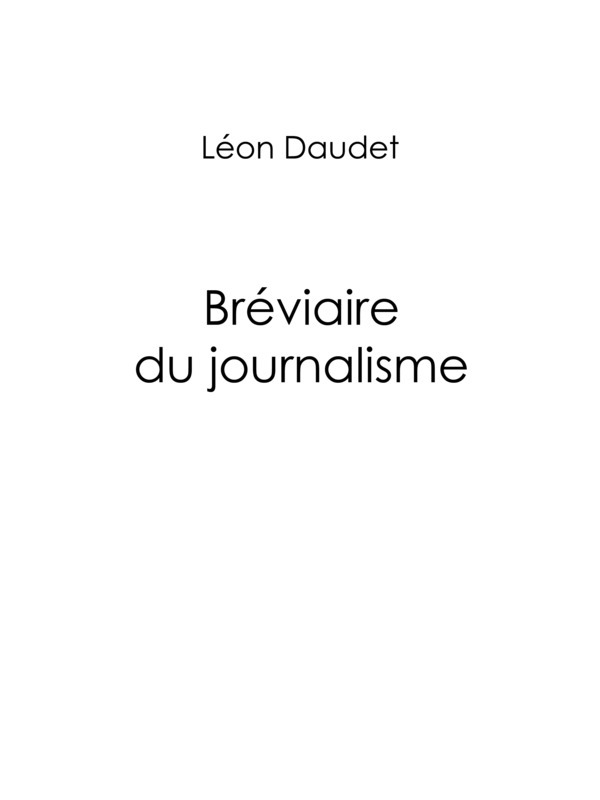
À mes collaborateurs de l’Action Française, affectueusement,
LÉON DAUDET.
Tel que vous me voyez, j’ai aujourd’hui (1935) quarante-cinq ans de journalisme dans la plume dont vingt-neuf ans d’article quotidien. Dans l’ensemble, mes « papiers » de l’Action Française, réunis, comporteraient, à eux seuls, plusieurs centaines de tomes, in-octavo, de 300 pages, lesquels, joints à mes quatre-vingt-sept romans et essais, feraient, au bas mot, une bibliothèque de six ou sept cents volumes imprimés, – en tenant compte des redites de la polémique journalière – sans y joindre mes collaborations antérieures à la Nouvelle Revue, au Figaro, à Germinal, au Gaulois, au Journal, au Soleil, à la Libre Parole. C’est affreux, c’est impardonnable, c’est invraisemblable ; mais c’est ainsi. J’ajoute que je me suis livré et me livre encore, à ces excès de l’imprimé avec : délices. Il n’est pas de métier plus passionnant.
Sauf en temps de crise et de drames, le journalisme est un jeu allègre, un sport intellectuel, nécessitant la mise en valeur de toutes les aptitudes du cœur et de l’esprit, ne connaissant ni répit, ni trêve, et qui exige l’usage, permanent et simultané, de la hardiesse et de la prudence.
Quand on lui demandait sa profession, Chateaubriand répondait fièrement : « journaliste ». Les journaux et pamphlets avaient fait la Révolution Française, combattus par les Actes des Apôtres de François Suleau, lequel fut assassiné, le 10 août, par la fille Terwagne dite « Théroigne de Méricourt », et les tricoteuses, sur la terrasse des Feuillants, aux Tuileries. Suleau, s’il était jamais canonisé, serait ainsi, avec Saint Paul et pour le temps moderne, le martyr de notre profession.
Je range parmi les journalistes, bien entendu, ceux qui écrivent couramment dans les périodiques, revues et hebdomadaires.
(1890-1914)
J’ai fait mes débuts dans le journalisme, entre 1891 et 1892, à la Nouvelle Revue de Mme Adam, au Figaro de Francis Magnard, et à Germinal de Maujan. Je venais d’entrer dans la famille de Victor Hugo, par mon mariage avec la petite-fille du poète et je me trouvais en relations intimes et étroites avec tout le milieu républicain. Avaient été témoins à mon mariage, pour ma jeune femme, Victor Schœlcher et Jules Simon, pour moi Edmond de Goncourt et mon maître le professeur Potain. Les intérêts politiques d’Édouard Lockroy, mon beau-père, firent que je me mariai civilement. Dans le même temps, des hostilités sourdes firent que je fus reçus seulement interne provisoire au concours de la Faculté, si bien qu’après huit ans d’études, dont six années de stage dans les hôpitaux de Paris, je plantai ma thèse là et j’écrivis mon quatrième volume les Morticoles, où je me libérai définitivement des mandarins de Faculté. Mon vieil ami Charles Nicolle, professeur au Collège de France, le génial chercheur que l’on sait, a raconté cela en quelques pages de son admirable biographie sur son frère Maurice Nicolle, dans les termes suivants :
« Il y avait, à ce renoncement – à la carrière de Faculté de Maurice Nicolle – une autre raison. Une injustice flagrante, inexcusable, venait de frapper Léon Daudet à son premier concours de l’Internat. Pas plus que je n’ai parlé de l’affaire de la médaille d’or, je ne parlerai ici de la matière de cet autre scandale. Maurice en fut révolté. Il se sentit à jamais touché dans son respect de la justice que tant d’injustices médicales n’avaient point encore éclairé. Il souffrit dans son amitié, dans les projets qu’il formait pour l’avenir de Léon. Il avait décidé, en lui-même, de cet avenir. Léon, une fois interne, serait entré à l’Institut Pasteur ; et qui sait, sans cet échec, si, malgré son tempérament fougueux, malgré l’influence de Drumont, de Barrès, de Maurras, le grand polémiste n’eût pas été un disciple fécond de la science pastorienne ?
Il n’est nul esprit instruit qui ignore aujourd’hui la comédie que représentent les concours médicaux. Trop de scandales en ont montré les ficelles. À côté des mérites et du labeur écrasant des candidats, on sait la part arbitraire qu’y prennent le jeu scénique, les caprices du hasard et les intrigues des coulisses. Nul ne réussit, pour ainsi dire, s’il lui manque une intelligence parmi les juges. Plus le concours est élevé, plus cette condition est nécessaire.
Le chef le plus influent de Maurice, je ne dis pas celui qui possédait le plus de science médicale, celui qui l’eût soutenu avec le plus de vigueur et qui l’eût imposé au concours du Bureau Central avec la facilité que donne la valeur d’un candidat de haut mérite, ce médecin autoritaire siégeait précisément, cette année-là, dans le jury de l’internat. Maurice lui avait parlé de Léon Daudet dont la valeur n’était pas contestable et dont les épreuves étaient bonnes. Ce fut ce juge qui mena la campagne contre lui. Impitoyable, il le desservit auprès d’autres juges, plus ou moins intéressés à l’échec, et forma la majorité qui prononça l’injustice. Maurice connut la manœuvre de la bouche de son maître. Il ne l’admit pas ; il brisa avec lui. C’était s’interdire la voie des concours. Mon frère conservait encore d’excellents chefs, sur le dévouement desquels il eût pu compter, Landouzy, Quinquaud, Lécorché, et bien des sympathies en dehors de ses maîtres directs. Il préféra la rupture et il obéit à l’ardeur qui l’entraînait vers la microbiologie. »
Le chef de Maurice Nicolle était le charlatan Albert Robin – ne pas confondre avec Charles Robin – sur le compte duquel je m’étais souvent exprimé avec liberté, et qui, de ce fait, m’avait voué une haine inexpiable. Je sus que, plus tard, il me brouilla, au sujet de l’affaire Dreyfus, avec Mirbeau. Je ne l’ai jamais considéré autrement que comme un jeteur de poudre aux yeux et un pauvre faiseur. Il n’est exactement rien resté de lui.
Mme Adam, qui maintint, pendant l’Entre-deux Guerres, le culte de la Revanche, avait groupé, dans la Nouvelle Revue, une foule d’écrivains de valeur et d’essayistes de choix. Visionnaire de la Patrie, elle avait discerné le jeu de Gambetta – aujourd’hui percé à jour – qui consistait à traiter sournoisement avec Bismarck, en ayant l’air de le combattre. Ses Mémoires, bien que réticents, sont, à ce point de vue, significatifs. Enjôlé par une fille de police, Léonie Léon, maîtresse elle-même du chef de la Sûreté de Napoléon III, Hyrvoix, qui procurait des femmes à l’Empereur, Gambetta, après la guerre, fit, avec sa maîtresse, le va-et-vient entre la France et l’Allemagne, où la belle Léonie élevait l’enfant, présenté comme son neveu, qu’elle avait eu d’Hyrvoix. Grévy, mis au courant des choses, lança la police de Sûreté Générale contre Gambetta, dont la vogue expira à Charonne, salle Saint-Blaise, lors de la fameuse réunion, où il menaça les « esclaves ivres » de les poursuivre « jusqu’au fond de leurs repaires ». Après la mort tragique de Gambetta, ses amis le vengèrent sur Grévy avec l’affaire Wilson, dite « du trafic des décorations ».
Tout jeune homme, j’entendis bourdonner à mes oreilles ces histoires, qui me passionnaient, et j’aurais voulu les écrire dans les journaux, qui n’en parlaient pas. Même le Tribullet, des familles bourgeoises, que dirigeait un nommé Harden-Hickey, s’abstenait de commentaires sur les relations de Gambetta, « l’apôtre de la Revanche » avec Henckel de Donnermack, et sa femme, la fille Thérèse Lachmann, dite « de Païva », qui avait certainement, dans ses services, la belle Léonie Léon, ancienne prostituée et maîtresse du policier Hyrvoix. En effet, l’ex-député boulangiste, mort récemment, Francis Laur, ami intime de Léonie Léon et auteur du livre révélateur, Le Cœur de Gambetta, avait été engagé, comme chimiste, sur la recommandation de la Païva, dans l’usine de produits chimiques d’Henckel, à Bédarieux !
L’Histoire est un puzzle, qui se complète peu à peu. Certains sortent du tombeau pour la gloire. D’autres pour la honte. Gambetta est de ces derniers. Lisez, pour plus de détails à son sujet, le Gambetta et la Défense Nationale, de Dutrait-Crozon. Le pitre loquace y est proprement disséqué, d’après des textes officiels.
Je me rappelle, de ce temps-là, une scène curieuse. Le professeur Charcot, grande figure en dépit de ses travers, dînait à la maison, en compagnie de Zola et de Drumont. Quelques jours auparavant avait paru, dans le Figaro, un article d’Ignotus (baron Platel), d’ailleurs imbécile, contre le maître de la Salpêtrière. Celui-ci déclara, l’œil sévère dans sa face dantesque, « c’est un malhonnête homme ». Drumont releva le propos. Les choses allaient se gâter, mais mon père fit une diversion habile et sauva, in extremis, la situation.
« Tu es un bon sujet, – me disait Gambetta en me tapotant la joue. – Nous veillerons sur toi. » Ce satisfecit m’agaçait. Je n’admettais, comme gardiens tutélaires, que mon père et ma mère. En revanche, j’aimais beaucoup Zola et j’admirais Drumont, son courage, ses propos embrasés. Sans connaître rien des juifs, j’adhérai à la ligue antisémite et je portai fièrement mon bulletin à Jacques de Biez, mystagogue des plus curieux, qui m’inscrivit sous le numéro 3. Je ne mis jamais les pieds au comité, ayant les comices et comités en horreur, ainsi que les commissions. On n’y parle jamais de la question pour laquelle on s’est réuni. En fait de conférences, celles seulement de l’Internat me sont apparues comme sérieuses. Quand je me levais de table pour m’y rendre, les amis de la maison, Geffroy en tête, me disaient : « Tu vas au bordel, hein, petit farceur ? » Je leur répondais : « Si c’était ça, je le dirais. En fait, je vais travailler. » C’était exact.
Si je vais au fond de ma mémoire, c’est de la Justice de Clemenceau que date ma vocation de journaliste. Elle était située faubourg Montmartre, en haut d’un escalier gluant, qui est celui de toutes les imprimeries. Nous allions là, mes copains, dont Maurice Nicolle, Maurice de Fleury et moi, au sortir des réceptions du jeudi de mes parents, avenue de l’Observatoire. Maurice Nicolle disait, en levant le médius de la main droite : « Pendant une heure et demie, chez toi, on s’enkyste. Mais la dernière demi-heure est épatante. » À la Justice nous retrouvions Geffroy, Müllem, Martel, Durranc, Sutter Laumann et souvent Henry Céard. Blagues, farces, caricatures par Pelletan. À minuit et demi, le patron arrivait, gouailleur, en habit, le cigare à la bouche. Il était brusque, enjôleur et charmant. Puis survenaient, couvert de plâtre, Rodin, et zébré de peinture Carrière, accompagné ou suivi de Raffaelli, gentleman correct, camarade délicieux.
Clemenceau était gentil, brusque, jovial, les mains dans les poches, le cigare à la bouche. Il proclamait le général Ferron « une espèce de Moltke », n’écoutait rien, improvisait des topos amusants sur toute espèce de sujets. Son inattention était prodigieuse. Sa spontanéité de même. Qui m’eût dit, à ce moment-là, qu’il sauverait un jour la Patrie m’aurait bien étonné. Mais mon père et Goncourt, qui l’aimaient, disaient de lui : « Il est le seul… » C’est-à-dire dans le monde politique. On le voyait aussi rue de la Faisanderie, chez son ami Ménard-Dorian, où il se montrait au naturel, d’une verve jaillissante, avec des yeux frottés comme des boutons de bottine, et un rire communicatif. Son aimable frère, Paul Clemenceau, ou son autre frère, Albert l’avocat, lui donnait la réplique. On s’amusait bien. De fort jolies femmes et jeunes filles ajoutaient à l’agrément de ces fêtes, qui se renouvelaient souvent.
Décidé à lâcher la médecine et ses pontifes injustes, je découvris ainsi le journalisme comme une carrière libre, divertissante, où l’on donnait son avis carrément, où l’on n’était ligoté en rien. J’enviais Geffroy, qui bataillait alors pour l’impressionnisme, Manet, Monet, Sisley, Pissaro, Renoir et les autres, et qui se serait fait tuer pour Rodin. Ce Breton bretonnant avait le sens des formes et de la couleur, comme celui de la langue française. L’épais Sarcey ayant écrit que Diderot était un « pornographe », Geffroy le moucha vertement, dans un article qui fit sensation. Les comptes rendus dramatiques de Martel étaient excellents, et ceux, musicaux, de Louis Müllem, beau-frère de Léon Cladel et pianiste hors ligne, les valaient. Ainsi la Justice était-elle devenue, à un moment donné, une prolongation des soirées du jeudi, rue de Bellechasse.
Cependant, je n’y fis pas mes débuts littéraires. Ceux-ci eurent lieu dans la France, que dirigeaient alors Lockroy et Millerand. J’y signai, du pseudonyme de « docteur Haerès », un papier sur Guillaume II, chef de guerre, qui me valut les félicitations de mon futur beau-père. Mais peu après, ayant publié au Figaro une « moralité » signée « un jeune homme moderne », qui eut du retentissement, je devins collaborateur périodique de Francis Magnard, directeur du puissant organe, et de Gaston Calmette, secrétaire de la rédaction.
Francis Magnard, d’origine belge, était un admirable directeur de journal. Présent à tout, curieux de tout, faux sceptique, anticlérical, porté aux choses de l’amour et de l’art et désireux d’en parler, il était accueillant aux débutants et méprisait les réputations toutes faites. On lui annonçait le secrétaire de l’Archevéché de Paris : « Que me veut ce ratichon ! Dites-lui d’attendre. » À Barrès et à moi : « Allez-y carrément ! Dites votre pensée, sobrement, mais entièrement ! Fichez-vous du reste ! Je me charge d’éliminer les mécontents et les envieux. » Lui-même pouvait être envieux, et il confessait un jour à mon père, au sujet de ce vice affreux : « Vous ne savez pas comme ça fait mal ! » Je le vois encore, en complet gris clair, la barbe soignée, l’œil indulgent : « Asseyez-vous là, mon petit Daudet et corrigez-moi ce début, qui traîne un peu. Je fais un tour dans le journal. Je reviens d’ici vingt minutes. Voici votre copie. Elle passera ce soir. »
J’obéis. J’avais devant moi les vingt sonnettes de la maison. Tout à coup, je me vis moi-même, directeur de journal, dans un fauteuil orienté de la même façon, la fenêtre à droite, une porte en face et l’encrier ouvert ainsi. Courte hallucination qui se réalisa, seize ans après, en 1908, de point en point. Mon bureau de rédacteur en chef de l’A.F.était moins luxueux que celui de Magnard. Mais il avait le même éclairage, la même orientation. Que les intersignes sont donc curieux !
Emporté, à l’âge dangereux, par une passion charnelle défendue, disons un « obex », dont j’ai connu un autre cas singulier, Magnard mourut et céda son fauteuil directorial à Fernand de Rodaya, qu’épaulait, comme administrateur, un rouquin, semé de taches de rousseur, Antonin Périvier. Les deux hommes se haïssaient. Calmette, ayant épousé Mlle Prestat, fille du président du Conseil d’administration du Figaro, demeurait secrétaire de la rédaction. Il répondait à tout et à tous « mais absolument, mon cher ami ». Nous nous étions liés d’amitié.
Deux épisodes, d’importance inégale, marquèrent, sous Rodays, ma collaboration au Figaro : l’arrestation du capitaine Alfred Dreyfus, accusé de trahison, et sa dégradation dans la cour de l’École Militaire (décembre 1894). La condamnation, en police correctionnelle, de Jacques Rosenthal dit « Jacques Saint-Cère », chargé, au Figaro, de la rubrique de la politique étrangère. Dans ces deux circonstances, je fus chargé de l’article et des considérations à côté.
La dégradation de Dreyfus m’a laissé un souvenir ineffaçable. J’y assistai auprès de Barrès, alors directeur de la Cocarde, journal du soir, et, comme moi, très excité. Le temps était brumeux et froid. Le condamné était impassible et comme absent de cette affreuse cérémonie. Il cria son innocence d’une petite voix blafarde, sans émotion, et personne n’eut alors le moindre doute quant à sa culpabilité. Clemenceau, Jaurès, déclarèrent qu’ils ne comprenaient pas qu’on ne l’eût pas fusillé. La campagne en sa faveur, assumée par Schœrer-Kestner, Bernard Lazare et Zola, ne devait commencer qu’à l’automne de 1897. Mon « papier » sur la dégradation me fut ultérieurement reproché avec colère par des confrères qui, sur le moment, étaient du même avis que moi.
Jacques Saint-Cère – ce pseudonyme était déjà tout un programme – avait ses libres entrées au quai d’Orsay et publiait, au Figaro, des notes de politique étrangère, qui avaient une grosse influence. Il était pro-allemand et il avait épousé la veuve de Robert Lindau, ex-compagne du romancier Sacher Masoch, qui a donné son nom à un vice, le masochisme. C’était un colosse mou, aux yeux noirs, à la barbe de jais, très jeteur de poudre aux yeux, très piaffeur, et qui recevait chez lui, et abreuvait de liqueurs rares, une foule de journalistes et de politiciens. J’ai toujours eu le flair – je ne sais pourquoi, – des agents allemands, ce qui devait me permettre, par la suite, d’écrire l’Avant Guerre (mars 1913) et de dénoncer le Bonnet Rouge, Caillaux, Malvy et Cie. Le procès du jeune Jacques Lebaudy, victime d’un nommé de Cesti et de Jacques Saint-Cère, qui l’avaient fait chanter odieusement, révéla l’indignité de Rosenthal, qu’on apprit, par la suite, avoir subi une condamnation à deux ans de prison pour vol. Ce fut un écroulement.
La soirée qui suivit ledit écroulement fut, au Figaro, impayable. Abel Hermant était là, muet, pareil à une boule de gomme désolée, car il était familier des réceptions du ménage Rosenthal, le plus innocemment du monde, bien sûr. Forain se tordait de rire. Comme on disait que Mme Rosenthal allait partir pour Berlin, il s’écria : « La v’là rapatriée ! » De Rodays et Périvier passaient de groupe en groupe, répétant « un homme à la mer ! » Dites « à la m… », rectifia Forain.
– Ce n’est pas tout ça, s’écria Rodays, comme frappé d’une idée subite. Qui va faire l’article ?… Daudet, voulez-vous vous en charger ?
– Certainement.
Ce papier, écrit à la diable, me valut les félicitations des deux directeurs du Figaro et de nombreux abonnés, nullement étonnés que cette canaille de Rosenthal leur eût servi, pendant des années, ses jugements et avis sur les problèmes les plus délicats de la politique étrangère. Le Figaro, dans l’aventure, ne perdit pas un lecteur. De même, par la suite, le Journal ne devait pas perdre un lecteur, ni un abonné, quand il fut mis sur la sellette dans la personne de son infortuné directeur Charles Humbert, sénateur, vice-président de la Commission de l’armée, étonnant paquet de gélatine et beaucoup plus bête et vaniteux que méchant. En revanche, le Figaro devait perdre, au propre et au figuré, de nombreuses plumes dans l’affaire Dreyfus, et par la collaboration du pustuleux Cornély, lesquelles plumes se retrouvèrent sur la peau du Gaulois, d’Arthur Meyer.
C’est ici l’occasion de dire quelques mots du journalisme d’actualité et d’information, forme très intéressante de la profession, où nous avons connu de véritables maîtres, un Talmeyr, un Bataille (chronique judiciaire), un Jules Claretie, aujourd’hui un Édouard Helsey, un Geo London, un Albert Londres, et dont le modèle achevé se trouve dans les Choses Vues de Victor Hugo.
Le journalisme dit d’information, aujourd’hui envahi par le fait divers et la photographie à outrance, est sorti du reportage, du télégraphe, du besoin d’observation sur place, de vitesse et de documentation, qu’ont développé les progrès mécaniques, multipliés encore, dans ces dernières années, par l’automobile, l’avion, la T.S.F. et la télévision. La terre est devenue une petite boule, où tout se sait – et aussi se déforme – dans les vingt-quatre heures. Cette connaissance des gens, des choses, des évènements se communique surtout par l’imprimé, par le journal, quotidien ou périodique, par la revue. Car la connaissance par l’ouïe et les ondes sonores ne laisse que des impressions fugitives et d’ensemble, donc moins amies de la mémoire que la connaissance par la vue et la lecture.
Dans chaque pays d’Europe, dans l’Amérique et les autres parties du monde, se sont fondées des agences d’information. La plus célèbre et l’une des plus anciennes est, chez nous, l’Havas. Celle-ci communique les nouvelles aux journaux, à l’aide de correspondances. Quelquefois ces correspondances sont tendancieuses, et il convient de les faire examiner avec soin, par un collaborateur réfléchi et compétent. Quand nous avons fondé l’Action Française, notre attention s’est portée tout de suite sur ce point délicat.
Quant à la politique intérieure, le gouvernement procède par des communiqués à la presse, soit officiels, soit officieux. La plupart du temps, nous n’en usons qu’avec circonspection et parcimonie, lesdits communiqués étant farcis de bobards et de mensonges, tendant à représenter les ministres du moment, mêmes ignares et canailles, comme des merveilles de sagesse et de prévision. Enfin, notre habitude, depuis le début de notre quotidien, étant de faire aux faits divers proprement dits, beaux crimes, beaux vols, etc., la portion congrue, nous échappions ainsi à la tutelle de la Préfecture de Police et de la Sûreté Générale, qui tend à faire, de ces deux établissements, les maîtres et tyrans de la presse parisienne d’information. Pendant des années, le petit préfet de police de Paris, Louis Lépine, a fait ainsi chanter son éloge par les journaux à grand tirage et à clientèle mêlée, alors qu’il faisait asperger d’eau froide les catholiques, hommes, femmes, vieillards et enfants, à Sainte-Clotilde et au Gros-Caillou, à l’occasion des fameux Inventaires. Ce qui n’empêcha pas les conservateurs imbéciles de faire entrer ce fantoche tartarinesque à l’Académie des Sciences Morales, en même temps que Millerand, chargé des dépouilles des congrégations (Combes dixit) ! Le duc d’Orléans disait des conservateurs « qu’ils avaient un nom qui commence mal ».
Mais l’information n’est pas tout. Il y a le commentaire de l’information, et l’adaptation de ce commentaire à la politique générale. C’est ici que Maurras devait inventer et composer une nouvelle rubrique, ignorée jusqu’à lui : la revue commentée de la presse. Maurras, chez nous, l’assuma d’abord, sous le pseudonyme de Criton, à l’intérieur du journal, alors qu’il faisait, en première page, l’article de direction politique générale. C’est ce qui me permettait de dire qu’à lui seul, avec quelques articles intercalaires, de Bainville et de moi, il eût pu faire tout notre quotidien. Par la suite, Maurras passa la plume à un collaborateur stylé par lui, Cellerier, tombé au champ d’honneur, Longnon, Gaxotte, Robert Havard. Depuis, la plupart des journaux d’information ont copié la Revue de la Presse de l’A.F. en la réduisant, par crainte de la polémique, à une simple classification énumérative. Or la polémique (de « polémos », guerre) est, avec la bonne foi, l’âme de la presse.
Dans les grandes questions politiques, qui commandent la paix et la guerre, l’information sur place est-elle, soit par les agences, soit par les correspondants, soit par les envoyés spéciaux, le meilleur moyen de savoir ? Je ne le crois pas. Elle est souvent indispensable, mais elle n’est pas tout.
Avant la guerre de 1914, sur tant de journalistes habiles et consciencieux envoyés en Allemagne, examinant de près les armements allemands, un seul eut la vision exacte du prochain avenir : mon vieux camarade Jules Huret. Il publia sur nos voisins de l’Est, un ouvrage, en deux volumes, dont plusieurs chapitres, consacrés aux usines de la Ruhr, que le Gouvernement de la République et l’état-major ne surent pas prendre en considération, et qui eussent dû commander notre réarmement. Vers la même époque, un économiste, M. Bruneau, publiait Les Allemands en France. Ni Huret, ni Bruneau, avec tout leur talent, n’allaient au bout de leur démonstration, qui était l’imminence de la guerre. En effet, la constitution de stocks d’armes et d’explosifs, garantis par un système de banques telles que la Dresdner Bank, la Disconto, la Reichsbank, ne laissait d’autre alternative à la fabrication d’armes et à la finance allemandes, que la ruine ou la guerre. Il fallait être d’une ignorance et d’une puérilité effroyables, comme Briand, Poincaré, Viviani, et autres pantins, pour ne pas apercevoir une nécessité aussi perpendiculaire.
Nous rendant compte de ce fait qu’il ne faut pas faire un journal de doctrine d’une constante sévérité, nous installâmes une rubrique légère, de petits Échos versifiés de première page, dont je me chargeai et que je signai « Rivarol ». Je procédais par distiques du genre de celui-ci :
ou de celui-ci :
Chaque jour j’adjoignais, à mon article de fond, quelqu’un de ces petits mirlitons, dont voulaient bien s’amuser nos amis, et qui distrayaient Jules Lemaître. De 1908 à 1914, le ton général de la prétendue « Grande presse », en présence des formidables évènements qui s’annonçaient, prêtait éminemment à la blague et nous ne nous privions pas d’en rire, « de peur d’être obligés d’en pleurer ». Du côté de l’Enseignement, Pierre Lasserre publiait sa Doctrine Officielle de l’Université, inspirée de la critique maurrasienne, et qui faisait justice de l’enseignement baroque des Monod, Durkheim et Seignobos. Alors Rostand passait pour un grand lyrique et le pitoyable Quo Vadis de Sienkiewicz faisait les délices d’un public ignorant et gisant. On pouvait dire, sans exagération, que « la France s’abandonnait ». Il y eut la cérémonie ridicule de la panthéonisation de Zola, où un vieil homme de notre profession, exalté, appartenant à la rédaction du Gaulois, Grégori, tira sur l’ex-capitaine et traître Dreyfus, venu là à contrecœur, un coup de feu d’ailleurs inoffensif.
Le journalisme parisien allait être marqué par deux évènements dramatiques : l’assassinat de sa maîtresse, la jolie petite actrice Lantelme, par Alfred Edwards, fondateur du Matin. L’assassinat de Gaston Calmette, devenu directeur du Figaro, par Mme Joseph Caillaux, femme du ministre des Finances.
Alfred Edwards, de physique hideux, de grandes et comiques prétentions, était un personnage important de la République, du fait qu’il avait fondé le Matin, quotidien officieux, lequel devint, par la suite la propriété d’un galant homme, M. Maurice Bunau-Varilla. Je n’ai jamais rencontré ce dernier, mais nous avons correspondu, pendant la guerre, au sujet d’Aristide Briand. On racontait, sur Edwards, des histoires scatologiques repoussantes et mon ami Henry Céard, qui l’avait vu de près, assurait que « ça finirait très mal ». Dépossédé du Matin, Edwards se lança dans le socialisme et fonda un quotidien, Le Petit Sou, qui, cette fois, tomba à plat. Après diverses aventures sentimentales, ce monstre physique et moral tomba amoureux d’une jolie fille, actrice de petit talent, du nom de Lantelme. Quand il eut fait sa facile conquête, il imagina de la promener, avec des amis, le long des fleuves et des canaux, sur un yacht spécialisé pour ce genre de sport monotone, et où l’on n’a même pas la distraction du mal de mer et de la cuvette. Un beau soir, la belle s’étant retirée un instant dans sa cabine, pour écrire à son amoureux, un jeune comédien de talent, Edwards accourut la rejoindre, surprit la lettre révélatrice, empoigna la pauvrette qui se sauvait, sous une avalanche de torgnoles, et la jeta tout bonnement à l’eau, où elle se noya. Ceci se passait dans les eaux allemandes du Rhin et à la veille de la guerre. Or les autorités allemandes, d’ordre supérieur, n’ouvrirent ni instruction, ni enquête. Ce qui nous donna beaucoup à penser. Edwards n’était pas Français. On le disait d’origine turque et naturalisé, ce qui ne l’avait pas empêché d’écrire à Barrès, qui lui avait mis le nez dans son ordure, qu’il était – ah mais ! – « trois fois Français ! »
Le fait qu’un pareil coco ait pu faire partie d’associations de presse, prononcer des allocutions, etc., démontre la veulerie ou, plus exactement, la vacherie des syndicats de journalistes, à la veille de la guerre. C’est pourquoi nous nous sommes soigneusement abstenus, Maurras et moi, d’entrer dans ces groupements, dits professionnels. On y est tout de suite ligoté par les nécessités d’une courtoisie qui n’a rien à faire avec la vérité. C’est ainsi que l’assassinat de la pauvre petite Lantelme fut rapidement étouffé et que nous fûmes à peu près les seuls dans la presse à en réclamer le châtiment.
C’est en mars 1914, à quelques semaines de la guerre, que Gaston Calmette, directeur du Figaro, fut assassiné par la seconde Madame Caillaux. Je tiens de Capus et d’André Beaunier, amis intimes de la victime – le plus charmant et le plus loyal des hommes – les renseignements inédits, ou à peu près, que je donne ici.
Ces tractations occultes de Caillaux, transmises entre Paris et Berlin en langage secret, mais interceptées et déchiffrées au quai d’Orsay, furent consignées dans une série de pièces dites « documents verts ». Trois hommes politiques en eurent connaissance, tous trois adversaires de Caillaux : Briand, Poincaré et Barthou. Ils résolurent de perdre Caillaux en les publiant, sans réfléchir que l’interception de messages chiffrés constituait un casus belli.
Figaro
LanterneFigaro
Ce jour-là nous travaillions, comme d’habitude, en face l’un de l’autre, à notre table en commun, Bainville et moi. Entra en coup de vent, notre informateur, le bon Leroy-Fournier, essoufflé : « Madame Caillaux vient d’assassiner Gaston Calmette. On l’a arrêtée. » Bainville, en souvenir de 1870, se contenta de murmurer « Victor Noir ». Toujours, en effet, quelque drame précède les grandes catastrophes, mais cette fois il devait y avoir deux marches sanglantes avant le lac de sang : la rue Drouot et Serajevo.
Figaro
Tel est, scrupuleusement rapporté, cet épisode du journalisme parisien. Plus tard ce déplorable Caillaux devait être arrêté par Clemenceau, incarcéré, puis, après la guerre, condamné par la Haute-Cour pour haute trahison (correspondance avec l’ennemi).
JournalGauloisJournalGaulois
JournalSuzannePetit JournalPetit ParisienMatin
Burgraves
Les Nuitsles Ennuis et les Âmes de nos plus notoires contemporains
Journal
JournalMatinPetit Parisien
Journalalter egoeJournalFigaro
Journal
GauloisGauloisGauloisFigaroFigaroJournal
Mes yeux ont vu
GauloisGaulois
la Police PolitiqueMagistrats et Policiers
Gaulois
Libre Parole
Libre ParoleA.FGauloisLibre ParoleJournalSoleil