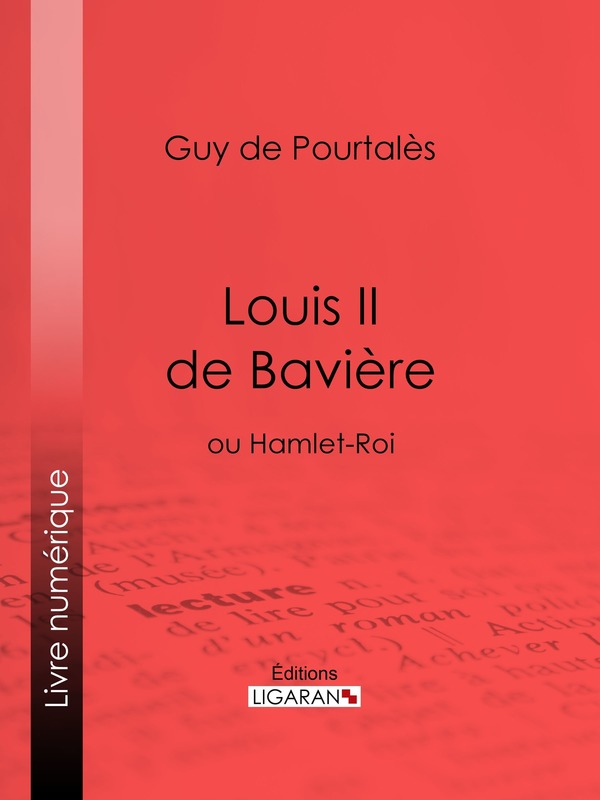
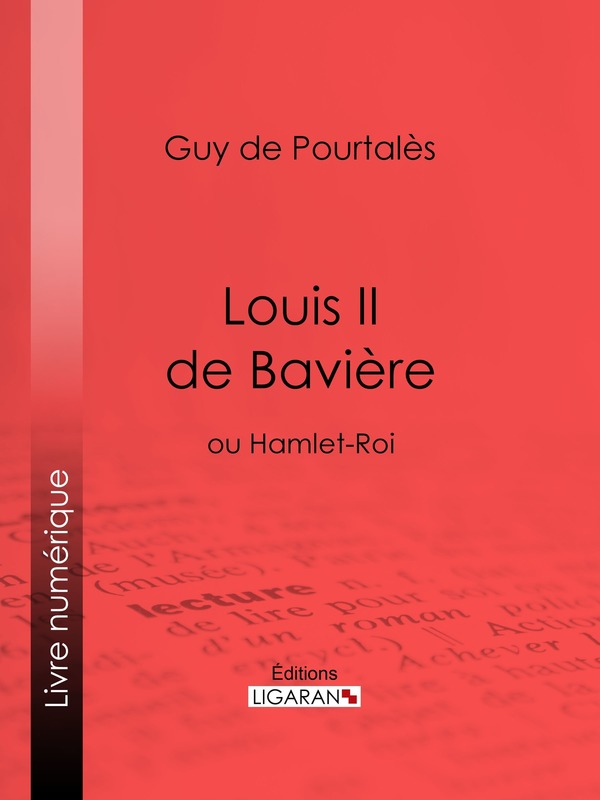

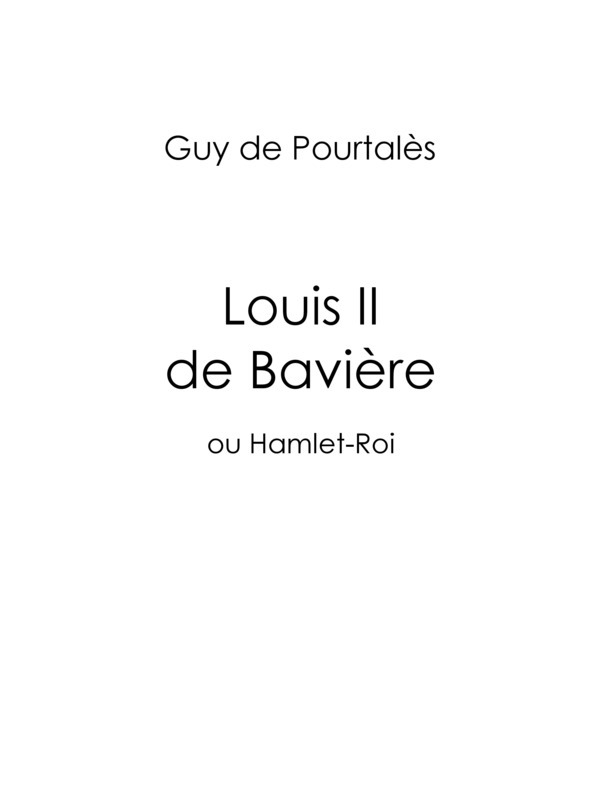

en grand-maître des chevaliers de l’ordre de Saint Georges.
(Photo Joseph Albert, 1866).
Dans l’Introduction à son excellente étude sur Louis II de Bavière, M. Jacques Bainville assure qu « il serait difficile de compter ce que doit la littérature à la légende de ce malheureux roi ». J’avoue n’avoir lu aucun des commentaires lyriques ou des romans fantaisistes qu’il a inspirés. Il paraît que l’auteur du Roi Vierge crachait sur les tapis de son appartement : cela m’a dispensé d’ouvrir le livre de ce poète. Je n’ai pas lu le Roi fou, ni les Rois de Jules Lemaître. Mon essai se fonde tout entier – quant aux faits – sur quelques ouvrages allemands : Kœnig Ludwig II und seine Welt, par M. Georg-Jakob Wolf ; Ich, der Kœnig, par M. Fritz Linde ; Kœnig Ludwig II und die Kunst, par Mme de Kobell, femme de M. de Eisenhart, lequel fut longtemps le secrétaire du cabinet royal. Ces volumes, auxquels on peut ajouter les souvenirs du dramaturge Karl von Heigel : Kœnig Ludwig II, ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte et les passages relatifs à Louis II dans la monumentale biographie de Wagner par Glasenapp, suffisent à donner une idée complète du sujet, Il y faut joindre : Chez Louis II, roi de Bavière, par M. Ferdinand Bac, un recueil de souvenirs et d’anecdotes très savoureux, et, naturellement, le travail approfondi de M. Jacques Bainville, qui offre un exposé historique de la question indispensable à connaître, ainsi que bien des aperçus ingénieux sur la politique de cette époque .
Le présent petit livre n’a point cette ambition. C’est un simple portrait. Mais, au cours de ces dernières années, il a été publié en Allemagne un certain nombre de documents nouveaux tirés des archives royales de Munich, ainsi que le fameux Journal Intime de Louis II (Tagebuch Aufzeichnungen von Ludwig II, Kœnig von Bayern, préfacé et commenté par M. Edir Grein, chez R. Quaderer, Liechtenstein, 1925), qui permettent de voir plus loin dans notre personnage. En m’appuyant sur ces données inconnues jusqu’ici, en faisant des recherches consciencieuses sur l’amitié de Louis II et de Wagner, en compulsant leur correspondance publiée ou inédite, en essayant enfin de reconstituer autour de ces deux figures centrales l’atmosphère morale et intellectuelle de l’époque où naissaient Tristan, Zarathoustra et les châteaux du roi Louis, j’ai tenté d’achever ma Trilogie Romantique. Et, en effet, ces trois figures de Liszt, Chopin et Louis II, me semblent montrer assez exactement les symptômes de cette longue et peut-être incurable maladie des hommes, qui s’appelle le romantisme. Pour ramasser tout cela en trois mots : Liszt, c’est l’amour ; Chopin, la douleur ; et Louis II, l’illusion.
Ceci demanderait un développement, j’en conviens. Le lecteur s’en chargera. Il s’apercevra peut-être alors que pour réaliste, évolué qu’il soit, et même guéri de toute fièvre romantique, il n’en a pas moins conservé dans son sang les toxines. Mais qui sait si ce n’est pas par nos maladies que nous sommes vraiment vivants ?
La beauté est différente pour chacun, puisqu’elle n’est en somme que la forme donnée aux choses par l’amour. La beauté n’a pas de critère. L’amour non plus. Ce sont de libres et changeants complices qui nous exaltent et nous tourmentent à leur gré. Mais sans eux que saurions-nous accomplir ? La forme que nous donnons aux choses par l’amour est la seule beauté qui ait pour nous un sens. C’est notre vérité. C’est notre droit. C’est aussi notre justification.
Chez Louis II de Bavière, la beauté fut l’unique forme de l’amour. Et si sa vie ne me paraît plus aujourd’hui qu’impuissance et folie, son drame me touche d’autant plus qu’il a été vécu pour l’illusion. Ce timide rougissant a eu pourtant des audaces de César, et dans la vieille Europe du XIXe siècle finissant, il est le dernier grand artiste portant couronne. Dès lors, Louis II prend visage poétique, valeur représentative. Il est exceptionnel comme un personnage de tragédie. Et c’est tout naturellement qu’en étudiant son histoire, je lisais constamment Hamlet pour Louis.
Shakespeare, qui plus que poète au monde eut le don de double vue, a déchiffré clairement ce destin royal, et il a tracé de lui un portrait que tout commentaire affaiblirait. Je le place ici comme une épigraphe à cette étude, et tel qu’il fut composé quelque deux cent cinquante années avant la naissance du prince de l’irréel.
« Ainsi, dit Hamlet, il arrive souvent chez certains hommes, que, par une tare de la nature en eux, telle une tare de naissance (dont ils ne sont point coupables puisque nature ne peut choisir son origine), par le développement excessif de quelque penchant qui renverse les murs et forteresses de la raison, ou par quelque habitude qui corrompt les façons usuelles, il arrive, dis-je, que ces hommes portant l’empreinte d’un seul défaut (livrée de nature ou étoile de fortune), leurs vertus fussent-elles par ailleurs pures comme la grâce, infinies autant qu’il est possible en l’humaine nature, ces hommes seront frappés du blâme général pour ce vice particulier. Un seul grain d’impureté fera de leur noble substance un objet de scandale. »
J’ai dédié les deux premiers récits de cette « histoire du cœur » à une âme en peine et qui se cherche. S’est-elle rencontrée parmi ces ombres ? Hélas, elle aura plus de peine encore à se trouver ici, puisqu’il s’agit de l’ombre de quelques ombres. Au moins puisse-t-elle reconnaître que si toute paix et tout amour demeurent insaisissables, l’illusion reste notre accès le plus esthétique vers la réalité.
N.B. – Outre les ouvrages indiqués plus haut, j’ai utilisé la traduction française des Œuvres complètes de Wagner par M. Prodhommme (Librairie Delagrave), et celle des Œuvres de Nietzsche par M. Henri Albert (Mercure de France). Les passages de la Correspondance de Nietzsche ou de Wagner que j’ai cités sont traduits par moi-même dans la plupart des cas, ainsi que tous ceux de Shakespeare. Enfin, je ne saurais assez recommander aux curieux du cas Wagner-Nietzsche, la lecture du passionnant ouvrage de M. Charles Andler : Nietzsche, sa vie et sa pensée (5 vol. parus, aux Éditions Bossard). Ce pur et profond chef-d’œuvre d’analyse philosophique, d’érudition et de compréhension humaine, m’a continuellement éclairé et guidé au cours de mes recherches.
Quelque trente ans après le séjour de Gœthe en Italie, qui inocula une suprême goutte de classicisme dans les veines du grand corps romantique allemand, un jeune prince de Bavière y débarquait à son tour et découvrait Rome. Non seulement Rome, mais Athènes dans Rome, l’Olympe éternel, les dieux, Homère, la beauté, son destin.
Devenu roi peu de temps après sous le nom de Louis Ier, il voulut faire de sa bonne capitale une nouvelle Athènes. Et frappant ce sol honnête et triste d’une canne d’or, il en fit jaillir des Propylées, un Parthénon, une Pinacothèque, une Glyptothèque en briques, qu’on recouvrit de ciment et qu’on veina au pinceau pour imiter le marbre. Puis il se maria, fut un époux fidèle, un père sévère, un monarque soigneux des deniers publics. Sa maîtresse unique restait la Grèce. Il la voyait partout. Il en imprégnait ses artistes, qu’il payait en couronnes de roses et de lauriers, mais achetait à l’étranger ses statues. Son règne se développait dans la paix et un hellénisme innocent. À un peintre qui avait fait du Rhin allemand un tableau allégorique, il disait : « Rhin vient du mot rinos. Le Rhin est un fleuve grec. » En 1832, il eut une grande joie : Othon, son fils encore mineur fut désigné par le congrès de Londres pour être roi des Hellènes. Mais cette joie dura peu. Les Grecs illuminèrent le Parthénon pour fêter l’arrivée du jeune Bavarois ; toutefois ils le chassèrent bientôt, ce qui n’enleva rien, du reste, à l’enthousiasme classique du roi Louis. Munich continua de se peupler de temples et de colonnes.
Cette vie se fût peut-être déroulée jusqu’au bout dans le calme et la bâtisse, si un incident d’une impertinence extrême n’était venu troubler à jamais son cours apollinien. Un soir de septembre 1846, comme elle travaillait dans son cabinet, Sa Majesté fut brusquement dérangée par un bruit inaccoutumé, des cris, une grande agitation. Un serviteur affolé vint alors lui apprendre que la danseuse espagnole qui devait débuter ce soir-là au théâtre, s’étant vu retirer la permission de paraître sur la scène royale, prétendait avec impudence arriver jusqu’au roi, et que, si elle n’avait été solidement empoignée, elle y fût ma foi parvenue ! Déjà le monarque roulait dans sa tête les divers châtiments que méritait semblable audace, lorsque, suivie d’un chambellan épouvanté, la danseuse parut. C’était une fille mince, brune, furieuse, étincelante. Le roi ordonna qu’on les laissât seuls. Il lui demanda son nom : – « Lola Montès. » Il la pria de se rajuster, car dans la bagarre son corsage avait été à moitié arraché. Elle préféra de rester le sein nu. Elle parla. Elle s’expliqua. Elle plaida. Or, le royal amateur d’art, qui avait tant caressé de statues, ne pouvait croire à la perfection de cette vérité palpitante. Il tendit la main ; elle la prit et la mit devant « le fait accompli. » (C’est ainsi que s’exprime un rapport de police). On voit qu’en cette affaire personne ne manqua d’à propos. Mais le roi était perdu.
Dès le lendemain, Lola dansait devant un public émerveillé et un prince asservi. Elle reçut des vers, qu’il signait « Louis. » Puis des bijoux, des toilettes, des lettres enflammées. Puis encore des bijoux, énormément de bijoux, une maison, un équipage, de l’argent. L’avare grisonnant se muait en prodigue. La caisse royale fut mise à sec en quelques mois. L’on s’en prit alors à celle de l’État. Le cabinet fut renversé. D’autres le remplacèrent qui s’écroulèrent à leur tour. Le roi s’en inquiétait peu, n’étant plus passionné que de chorégraphie. Ou bien il promenait sa maîtresse chez les peintres, pour lui apprendre les Beaux-Arts et faire faire son portrait. Toute l’année 47 se passa en folies. On voyait Lola Montès caracolant à cheval par les rues de Munich, se faisant saluer comme une reine et menaçant de sa cravache les passants insuffisamment empressés. Elle reçut le titre de comtesse de Landsfeld. Elle se battait avec les étudiants qui manquaient d’admiration pour tant de romanesque, ou bien, lorsqu’ils manifestaient sous ses fenêtres, elle leur vidait sur la tête des coupes de champagne. Lola pensait racheter ses excentricités en « libérant le peuple », et faisait copier à l’usage de son royal toutou le Code Napoléon. Mais lorsque celui-ci assistait aux séances de pose, chez Kaulbach, elle l’obligeait de se mettre à genoux et lui frappait le crâne à coups d’éventail pour lui enseigner l’humilité. Cela ne déplaisait qu’à moitié à ce sexagénaire compliqué, mais le courbaturait beaucoup. Pendant ce temps, les curés prêchaient en chaire contre la bête de l’Apocalypse, ou bien ils déclaraient qu’à Munich Vénus avait remplacé sur son trône la Sainte Vierge.
Cela devait mal finir. Un jour, la danseuse fut traquée par la foule. Elle se réfugia dans l’église des Théatins ; la troupe fut mobilisée pour la délivrer. Le sang coula. Le 12 octobre 1848, le roi Louis dut signer l’ordre de bannissement, et à peine « la diablesse » eut-elle quitté sa demeure sous un déguisement, que le peuple l’envahit et y brisa tout. Le roi parut, calma la populace, puis rentra au Palais et écrivit ces lignes : « Bavarois ! Des temps nouveaux commencent, différents de ceux prévus par une constitution sous laquelle j’ai gouverné pendant vingt-trois ans. Je résigne ma couronne au profit de mon fils bien-aimé, le Kronprinz Maximilien. »
Ainsi tombait le rideau sur ce prologue de tragédie, qui ressemble à une opérette. Maximilien allait régner. Et le petit Hamlet, son fils, avait trois ans, celui qui devait dire, comme l’autre : « Le siècle est détraqué. Oh ! malédiction d’être venu au monde pour le remettre en ordre ! »
Maximilien était très grand, très mince, avec une petite tête toute en front plantée sur un beau buste rond et fin. Les yeux profonds. Une jolie voix douce et haute de dame. Homme sage, sans génie, mais ferme, honnête, ardent à s’instruire et sans autre passion que celle-là. Sa femme, la princesse Marie de Prusse, était surnommée « l’ange » autant pour son visage de madone florentine que pour sa pureté de cœur et simplesse d’esprit. Mariée à dix-sept ans, elle était arrivée à Munich avec ses jouets et ses poupées quatre ans seulement avant Lola Montès. Elle apportait à cette cour de vieux garçons une fraîcheur naïve et le sang pathologiquement malade des maisons de Brunswick-Hanovre et Brunswick-Hohenzollern. Mais le vieux roi Pâris ne s’inquiétait pas des destins indéchiffrables. Il fit faire le portrait de sa bru pour sa galerie de beautés, où danseuses, filles du peuple, comédiennes et princesses réjouissaient ses loisirs de monarque éliminé.
Max prenait sa charge au grand sérieux, s’entourant de savants et de ministres. Une fois par semaine, le soir, réception au château, en habit et cravate noire. On se réunissait dans son cabinet, qui ressemblait à une chapelle, car il était fort pieux. Et même travaillé par les mystères de la théologie. C’est ainsi qu’il demanda une fois au professeur Jolly « si sa science ne lui permettait pas d’établir avec certitude que les seigneurs de ce bas monde auraient aussi dans l’autre une situation privilégiée ». Messieurs les savants se regardèrent, burent leur « demi » de bière et ne se gênèrent point pour répondre : « Sire, ce sont là des problèmes que vous ne comprenez pas. » Quant à la reine, elle écoutait du mieux qu’elle pouvait les lectures de poètes, mais priait doucement qu’on remplaçât partout le mot « amour » par celui d’« amitié. » Pendant ce temps, le petit Louis, leur fils, jouait sur le parquet à construire des maisons. Ce qui plaisait au grand-père. « Les Wittelsbach, disait-il, ont cela dans le sang. »
Quelques années s’en vont. Louis et son cadet Otto grandissent sans aventures et se développent sans joie. Princes soigneusement couvés, ils écoutent leurs professeurs et s’ennuient. Un seul plaisir à l’horizon : la campagne et les grands châteaux en Bavière. Principalement celui de Hohenschwangau, le Haut pays des cygnes, où est peinte sur les murs l’histoire du chevalier Lohengrin : adieux au burg du Saint Graal ; l’empereur entend sonner la trompe du chevalier ; la victoire du héros dans le tournoi ; les noces de Lohengrin et de la duchesse de Bouillon.
Heures d’immenses rêveries devant ces fantasmagories exactes. « Heures perdues ! » s’écrie son maître. « Pourquoi ne vous faites-vous pas lire quelque chose, Altesse, au lieu de vous ennuyer à ne rien faire dans cette pénombre ? » – « Oh ! je ne m’ennuie nullement. J’imagine de belles choses et m’en amuse. »
On cherche à distraire violemment cet enfant trop concentré. Inutile. Il aime le silence au profond duquel il entend tout à coup des voix. Quelles voix ? Il écoute. Il s’arrête d’écrire ou de jouer. Il voudrait comprendre et désigne l’endroit d’où sont parties les paroles d’un compagnon invisible.
Le docteur de la Cour, Gietl, est témoin de ces faits et il prend des notes. « Enfance trop solitaire – puberté – on ne sait… » Le père gronde et ne croit pas aux revenants ni aux esprits parleurs. On met les enfants à la diète. On les affame presque. On double les devoirs. Le père exigeait qu’ils eussent une culture « universelle ». Ils tremblaient devant ce régide pédant, qui s’érigeait en professeur des réalités royales et bavaroises.
Mais, bien que remarquablement doué et intuitif, Louis est un élève médiocre. Des maîtres tels que Liebig, le chimiste, et le célèbre théologien Döllinger, n’arrivent guère à l’instruire. C’étaient pourtant ses seuls amis. Pas de jeunesse autour des princes, aucun camarade de leur âge n’est admis. Et quand tout ne marche pas selon son gré, le père à la voix suave n’hésite pas à infliger de sa main des châtiments corporels. Jamais d’argent de poche, ou du moins si peu que rien : une douzaine de goulden par mois, à dix-sept ans.
Ce sont là des détails, mais qu’il importe de connaître. Car c’est au cours de ces années préparatoires que se décident les travers, les habitudes, les éloignements, les tendresses et les cruautés qui bientôt pousseront ces âmes encore muettes et impuissantes à se venger sur les autres – et sur elles-mêmes – des compressions, des blessures d’orgueil, des égoïstes douceurs qui les ont lentement instruites. La première fois qu’on remit au prince Louis une petite bourse, à sa majorité, il voulut acheter toute la vitrine d’un bijoutier. Il ne comprit jamais que les cinq ou six pièces d’or qu’il possédait n’y suffissent point. Dès lors, il renonça pour toujours à approfondir cet ordre de choses.
D’ailleurs, l’argent n’est-il pas qu’une simple convention ? Et les sentiments d’affection filiale ? (Il n’osait qu’à peine y songer). Et le pouvoir ? Et la couronne ? Et la vie ? (Autant d’abstractions). Qu’est-ce qu’il y a de vraiment vrai, de nécessaire, de personnel, de bon, dans cette usine quotidienne de devoirs où chaque quart d’heure est d’avance réglé et haï ? Eh bien, voici : l’unique réalité, c’est le rêve ; l’unique bonheur, la solitude ; le seul amour, ces élans sourds, profonds, remplis d’une sensualité agissante qui vous jettent la bouche tendue vers les hommes et les femmes qu’on voit dans les livres, ou sur les tableaux, ou sur les tapisseries. Le chevalier aux cygnes, la belle duchesse, les nuages au couchant, les forêts, le cor des gardes-chasses, le chant d’un pâtre, seules choses authentiquement vivantes et qui relient les grandes vérités de la poésie aux fantômes de la réalité. Et aussi la pêche au brochet, à l’aube, dans les lacs. Et encore, et toujours ce poème de Lohengrin qu’il avait lu en cachette, à treize ans, qu’un musicien avait, paraît-il, composé et qu’il savait par cœur d’un bout à l’autre sans aucune faute de mémoire, lui qui ne pouvait se mettre une page de grammaire dans la tête.
Or, en 1861, l’Opéra de Munich afficha Tannhäuser et Lohengrin. Louis, en tremblant, demande à son père d’y pouvoir assister. La permission accordée, l’adolescent y va avec le seul comte de Leinfelder, son aide-de-camp. C’est la première fois qu’il entend une mesure de la musique de Wagner. Tel est son saisissement, que l’aide-de-camp, notant les réactions du prince, observe d’inquiétantes transes, qu’on croirait douloureuses. « Par exemple, écrit-il, lorsque Tannhäuser revient au Vénusberg, le corps du prince fut secoué de spasmes véritables. C’était si violent, que je redoutai un instant une crise d’épilepsie. » Mais la musique n’est pas la cause première de ce bouleversement. C’est le poème, les idées, les symboles derrière lesquels s’ouvre tout un monde insoupçonné. Louis ne peut plus songer qu’à cela, et quelque temps après, il vole sur le piano de son oncle un livre de Wagner : L’œuvre d’art de l’avenir. Quelle pâture ! Quel programme ! Le mot avenir surtout gagnait comme une maladie cette sensibilité en peine de refoulement.
« L’œuvre d’art est un acte de vie », lisait-il. (Dans quels mensonges avait-il donc été élevé ?) Le peuple seul est porteur des grandes nécessités de la vie et de l’art. Il est la force efficiente de l’œuvre d’art, qui est une création en commun. « Un seul peuple a réussi jusqu’ici cette communauté dans le vouloir artistique : le peuple grec ; aussi devons-nous faire de l’art hellénique l’art humain en général. » ( – Tiens, tiens, mon grand-père est donc le seul qui ait vu clair ?) « L’homme doit être considéré comme son propre objet et sujet artistique. Mais son orgueil, la toute-puissance de ses sensations physiques et même les sentiments de son cœur tomberont dès qu’ils se manifesteront à l’homme intelligent, parce que sentiments et sensations communs à toute l’espèce. Il ne peut vouloir que l’universel, le vrai, l’absolu, sa propre absorption, non dans l’amour de tel ou tel objet, mais dans l’amour en général. Ainsi l’égoïste devient communiste, l’Un devient Tout ; l’homme devient Dieu ; et l’artifice, l’art. » Or, la musique est le cœur de l’homme. Son langage, l’art des sons. « La musique est l’amour du cœur dans la plénitude de son bouillonnement ; elle est l’amour qui ennoblit la volupté et humanise la pensée abstraite. » – « Dans le royaume de l’harmonie il n’y a ni commencement ni fin, de même que l’ardeur intime de l’âme n’est elle-même qu’aspirations, élans, langueur, expiration, c’est-à-dire mort. Mais mort sans mort, à cause d’un éternel retour sur soi-même. » Et le poète ? Quel abaissement dans sa recherche présente des réalités pratiques ! « Le besoin véritable de notre temps ne se manifeste qu’en vue de l’utilité la plus stupide. Il n’y a que des appareils mécaniques, mais non des créations artistiques qui lui soient adéquats. » Un seul moyen d’en sortir : « la rédemption dans l’œuvre d’art de l’avenir. Des arts purement humains, sans égoïsme ; la rédemption de l’homme utilitaire par l’homme artiste. » Alors seulement le mondain racheté poussera du fond du cœur la parole que Beethoven plaça comme une couronne au sommet de son œuvre : « Joie, soyez embrassés, ô millions d’êtres ! » Tel sera le langage de l’œuvre d’art de l’avenir.
Ah ! il était bien le maître attendu, celui qui proclamait une telle espérance.
En 1863, Louis atteignit sa dix-huitième année et sa majorité. Cette même année vit l’affaire du Schleswig-Holstein, qui agita fort toute la Bavière. Malade et fatigué, le roi Maximilien était parti pour l’Italie, où il pensait se reposer longuement. La politique le rappela dans sa capitale, car le peuple tout entier voulait qu’il prît en main la cause du Schleswig indépendant. Il n’osa point tenir tête à l’Autriche ni à Bismarck. La lutte qu’il soutint contre lui-même et sa conscience, brisa cette majesté fragile. Après trois jours de maladie, le 10 mars 64, sans souffrances et sans inquiétudes, Maximilien expira.
Ce fut dans toute l’Allemagne de la stupeur. À Munich, la foule consternée remplissait les rues et le Palais Royal. La grosse cloche Benno, de la Frauenkirche, sonnait un glas incessant. Le 14 mars eurent lieu les funérailles. Le peuple entier regarda défiler le cortège funèbre : princes, ambassadeurs, délégués, généraux et cavalerie. Puis vint le catafalque. Toutes les têtes se tendirent pour voir passer le nouveau roi, cet enfant qu’on disait sauvage, énigmatique, à peine formé.
Or, dans un silence énorme, s’avançait derrière le corbillard un jeune dieu, le visage levé, grave, mais comme souriant. Un inconnu, mais que chacun se rappelait avoir vu. Vu où ? Vu quand ? Ils cherchaient à se souvenir. Et tout à coup le savaient, se frappaient le front, riaient d’avoir trouvé. Non, ce n’était pas un roi véritable, un roi de chair comme les autres. C’était un prince de conte de fées, un roi de légende, un poète que les dieux de l’Olympe envoyaient sur la terre en signe d’amitié au fidèle peuple de Munich. Et déjà tous ces cœurs d’hommes, tous ces regards de femmes rayonnaient d’amour.