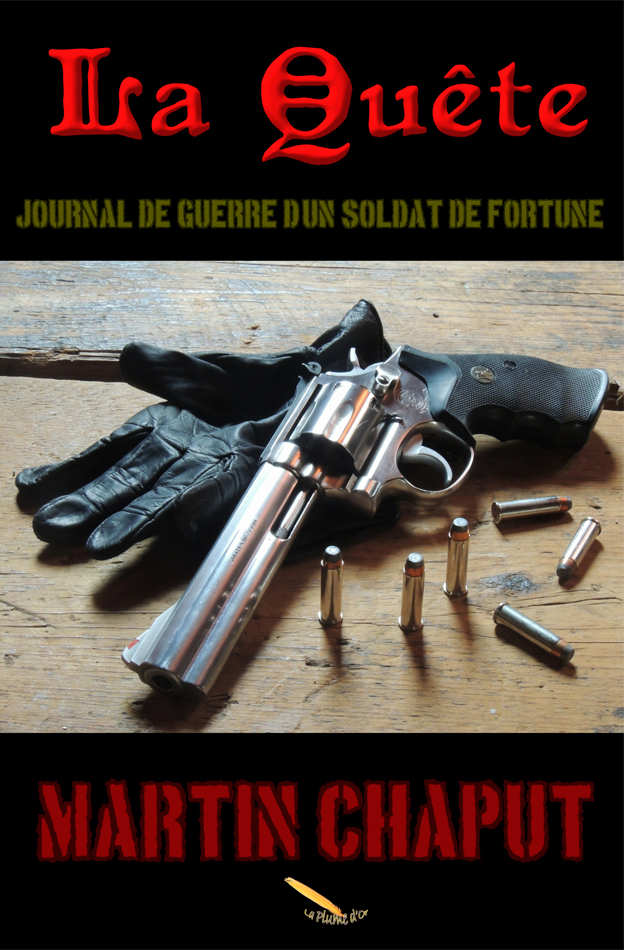
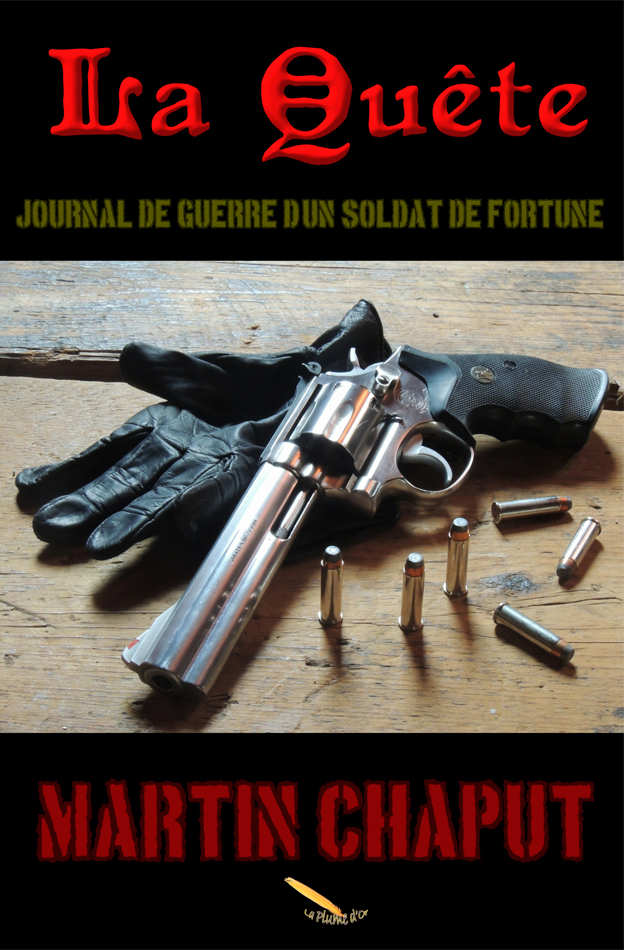
Table des matières
REMERCIEMENTS 6
1ère PARTIE 7
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT I 8
FLASH-BACK I 12
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT II 26
FLASH-BACK II 36
FLASH-BACK III 41
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT III 48
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT IV 54
FLASH-BACK IV 59
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT V 65
FLASH-BACK V 71
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT VI 82
FLASH-BACK VI 90
ÉPILOGUE 98
2e PARTIE 99
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT I 101
FLASH-BACK I 107
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT II 112
FLASH-BACK II 128
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT III 135
FLASH-BACK III 138
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT IV 147
FLASH-BACK IV 155
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT V 165
FLASH-BACK V 170
PREMIÈRE LIGNE DE FRONT VI 179
FLASH-BACK VI 183
ÉPILOGUE 195
LA QUÊTE
JOURNAL DE GUERRE D’UN SOLDAT DE FORTUNE
Martin Chaput

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Chaput, Martin, 1969-
La quête
Publié en formats imprimé(s) et électronique(s).
ISBN 978-2-924594-69-8 (couverture souple)
ISBN 978-2-924594-70-4 (PDF)
ISBN 978-2-924594-71-1 (EPUB)
I. Titre.
PS8605.H365Q47 2017 C843'.6 C2017-941032-6
PS9605.H365Q47 2017 C2017-941033-4
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada (FLC) ainsi que celle de la SODEC pour nos activités d’édition.
![]()

Conception graphique de la couverture: Martin Chaput
Martin Chaput 2017
Dépôt légal – 2017
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISBN 978-2-924594-69-8 (couverture souple)
ISBN 978-2-924594-70-4 (PDF)
ISBN 978-2-924594-71-1 (EPUB)
Tous droits de traduction et d’adaptation réservés. Toute reproduction d’un extrait de ce livre, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
Imprimé et relié au Canada
1ere impression, mai 2017
En souvenir de Pascale Chenoix, mon Européenne.
Les premières lignes de ce roman datent de 1999 et son écriture s’est échelonnée depuis lors, jusqu’aux derniers ajouts et corrections réalisés en 2014. De par son contenu, cet ouvrage est le reflet de nombreuses périodes sombres rencontrées au cours de ces années. En ce sens, plusieurs personnes ont contribué, par le biais de leurs encouragements, de leur support et même, de leur inspiration, à mener ce projet littéraire à terme. De tous ces gens, ma mère Ghislaine reste celle qui m’aura permis de bénéficier d’un appui inconditionnel de tous les instants. Même chose en ce qui concerne ma sœur Brigitte et ses deux enfants, Karl-Olivier et Ariane, qui par leur présence et leur attention, ont aidé à alléger certains moments difficiles. Je me dois aussi de mentionner Sue Hélène Young-Chaput, qui est et demeurera ma fille d’âme et de cœur. Un grand merci aussi à Frank Petrillo, qui a su me redonner confiance à une époque où il ne m’en restait plus beaucoup. Pour ce qui est du support, personne ne le symbolise mieux que Rudy Provencher, mon frère d’armes de tous les combats. Avec bien sûr Cédric Filiatrault, mon premier lecteur, qui a su, grâce à ses conseils et ses encouragements, m’aider à réaliser cette œuvre. Un merci, aussi, à Éric Coulombe, Alex Poulin, Éric Béliveau, Pascal Thibeault ‘’Liberty’’, Alain ‘’Psycho’’ Lamy, Jean ‘’L’aïeul’’ Bélisle, Mathieu ‘’Le kid’’ Carbone et Gianni Berreta, pour leurs nombreux encouragements, et à Mylène Marcelais, ma douce pornstar, qui a su rendre de bonnes idées encore meilleures. Enfin, pour l’inspiration, je voudrais adresser des remerciements très spéciaux à mes deux Couzes; d’abord, à Éric Lacharité, avec qui j’ai partagé une aventure extraordinaire à l’autre bout du monde, et ensuite, à Stéphane ‘’Stuff’’ Chaput, mon ami, mon frère, en souvenir de moments épiques souvent peu racontables (hormis dans ces pages), qu’on se remémore tout de même avec plaisir à chacune de nos rencontres, devant un verre de divin nectar. Enfin, merci à la maison d’édition La Plume D’or et à sa directrice Marie-Louise, pour m’avoir permis de réaliser ce projet avec autant de latitude.
Quand il n’y a plus rien de vrai
À part l’oubli et bien sûr la mort
La corruption qui a tout sali, tout défait,
Nous mène à la seule vraie réalité, sans remords
Même désillusionnés, nous ne vendrons pas nos âmes
Eut assez de vendre nos bras armés, nos poings
Amour, confiance, loyauté, que des cendres
Ne reste que la guerre vers l’enfer, jusqu’à la fin
Notre seule force, c’est notre haine
Qui nous tiendra éveillés jusqu’à notre dernière heure
Un revolver comme allié pour maintenir notre règne
Une bouteille de scotch pour nous réchauffer le cœur.
- Ronin
Le fossoyeur
Tout ce qu’il veut c’est la douleur
La douleur et la haine
Oui la haine
Mais jamais la peur, la peur est pour l’ennemi
La peur et les balles.
- Le corbeau, de J. O’Barr
− Vas-y, creuse le ton trou, mon ostie de gros sale!
Le vent automnal se lève et une violente bourrasque fait virevolter les feuilles mortes tapissant le sol. La brise est froide, glaciale, comme le ton de ma voix qui vient de briser le silence absolu de la nuit. Ma voix est pleine de menaces sous-entendues, résonnant telle une macabre mélopée funèbre. Les phares d’un véhicule, stationné plus haut, diffusent une faible lueur blafarde, qui repousse les ténèbres au-delà de la petite clairière, tout en faisant étinceler le canon chromé de mon revolver. Je regarde intensément l’homme qui est en face de moi et pendant quelques secondes, je remarque tous les signes de sa détresse. Il tremble et respire avec difficulté, tandis que son corps grassouillet tout crispé est recroquevillé sur le manche d’une pelle. Cet outil semble être la seule chose qui l’empêche de tomber sur le sol, comme les béquilles d’un estropié. Ses yeux sont fermés, des gouttes de sueur perlent sur son front. C’est notre nouvelle victime. Il est bien habillé, le salaud, avec un beau complet à plusieurs centaines de dollars. Dans la vie de tous les jours, il devait être tout un monsieur; il devait en brasser des affaires. Mais ici, isolé dans la nuit noire, à la merci de mon doigt sur la détente d’un revolver, il n’est plus rien, juste un autre morceau de bidoche. Tout en le tenant en joue, j’ai une étrange pensée; je me dis que dans le fond, je ne devrais pas être là. Le problème, c’est que je ne me rappelle pas où je devrais être. C’est un peu le même genre de sentiment que je ressens chaque fois que je pars en guerre, et ça me met toujours en colère. Puis enfin, je me répète que tant qu’à être ici, je ferais mieux d’en finir au plus vite. J’abrégerais ainsi mon semblant de torture, tout en faisant de même pour cet imbécile. Mon visage, qui tout ce temps affichait l’impassibilité d’une statue de granite, prend soudainement les traits d’un masque grimaçant. Mes mains gantées de cuir se crispent sous l’effet d’une rage volcanique dont je suis moi-même l’instigateur. Pareil au suicidé qui s’immole en s’aspergeant d’essence, les violents sentiments que je cultive si bien en moi me brûlent soudainement de toutes leurs flammes. Jamais je n’aurais dû venir ici. « Fuck! C’est ce que je me dis chaque fois! » D’un coup brutal, je frappe le gros homme au front avec la crosse de mon arme. Le bruit sourd de l’impact résonne dans la nuit sombre et, tombant sur le sol, ma victime émet un long gémissement de douleur.
− Dépêche-toi, gros chien! De toute façon, tu vas le creuser ton ostie de trou, t’as pas le choix! Maintenant, il s’agit juste de savoir si tu vas le faire rapidement sur tes deux jambes, ou plus lentement en pleurant dans ton sang avec un trou de balle dans un genou.
Sur ces mots, j’abaisse le canon vers ses jambes. Il les replie sous lui, dans un réflexe de défense. Entre les ombres noires qui m’entourent, il me semble encore entendre l’écho de ma voix, rageuse, haineuse. Pourtant, ce n’est pas lui que je déteste; je ne le connais même pas. Je déteste simplement le fait d’être ici et celui d’avoir dû enterrer mes souvenirs. Je déteste Dieu, aussi, même si je ne crois pas en lui. Pourtant, il m’arrive d’y croire. Oui, c’est vrai, je crois en Dieu quelques fois et, dans ces moments-là, j’y crois seulement pour pouvoir le haïr. Un filet de sang commence à couler du crâne cabossé de ma victime, en même temps que ses joues s’inondent de larmes. Un long sanglot de désespoir sort de sa gorge, exprimant toute la terreur et le désarroi qui remplissent son être. C’est le moment qu’il choisit pour y aller d’un geste d’ultime recours. Il me fixe de ses yeux humides et me supplie silencieusement, à la mesure que s’enchaînent nos regards. Il implore ma grâce en cherchant en moi une parcelle d’humanité. «Criss de con! Regarde, vas-y voir tout au fond de moi! Va scruter avec la force de tes derniers espoirs. Regarde bien, regarde comme c’est noir, vide, pareil à un gouffre abyssal! Vas-y, jette-toi, si tu oses, dans ce puits de néant, là où il n’y a rien, à part le froid et mon secret. Tu vois tout, maintenant; oui, c’est la seule chose que tu peux voir, la seule chose dont je me rappelle encore, la seule vérité qui tienne. Je n’ai plus rien, en dedans, je suis mort ». Je lui souris d’un air féroce et il baisse les yeux en sanglotant de plus belle, encore plus désemparé qu’avant. Il sait maintenant qu’il est perdu. J’entends des pas derrière moi. C’est le Tueur qui s’avance lentement. Depuis notre arrivée dans le boisé, il était resté silencieux. Il n’aime pas voir le sang couler inutilement; lui non plus n’aime pas que ça traîne en longueur. Le voilà donc forcé d’y aller de sa grande subtilité, qualité évidemment non partagée. De plus, c’est son tour, ce soir. Il passe à ma hauteur, puis se penche vers l’homme toujours au sol en lui mettant délicatement une main sur l’épaule. Sa voix s’élève, calme et sereine; on pourrait presque y percevoir une pointe de compassion.
− Écoute, mon ami, fais ce qu’il te dit. Creuse et en même temps, réfléchis. Réfléchis à une façon de te sortir de la merde. On ne sait jamais… il y a sûrement quelqu’un dans le monde qui t’aime assez pour t’aider à trouver une partie de l’argent que tu dois. D’autant plus que tu en dois pas mal, beaucoup trop et depuis très longtemps. T’en as crossé, du monde, mon ami, et dernièrement, ce n’étaient pas les bonnes personnes. Pour le moment, contente-toi de creuser et pense à trouver de l’aide. Je ne sais pas… ta mère, ta femme, ta maîtresse… n’importe qui avec de l’argent. On a un problème et ça prend une solution, alors creuse et réfléchis très fort.
Cela dit, le Tueur bouge la main et tâte doucement la poche arrière de son pantalon.
− J’ai mon cellulaire juste là. Alors, lorsque tu seras sûr d’être capable de trouver quelqu’un d’assez serviable pour sauver ton gros cul, on l’appelle et on règle ça. Donc ce soir, pour être heureux, mon copain et moi, ça nous prend un beau trou et ensuite, l’argent.
L’homme se relève tout en essuyant du revers de sa main tremblante le sang qui dégouline toujours sur son visage. Puis il se met à creuser avec l’entrain d’un homme qui croit encore à ses chances de survie. Après plusieurs minutes, il s’arrête et se retourne en faisant bien attention d’éviter mon regard pour finalement, hésitant, faire face au Tueur.
− Je... je crois que je sais qui pourrait me... me…
La voix est faible, sans force et suppliante, mais ses yeux sont maintenant secs. Il ne pleurniche plus, il est rempli d’espoir. De la main, le Tueur arrête son flot de bégaiements.
− Parfait mon ami, on est près de la solution. Maintenant, juste pour faire plaisir à mon compagnon, finis de creuser ton trou.
Le gars reste là, bouche bée, sans vraiment comprendre, puis semble vouloir argumenter. J’avance aussitôt d’un pas, histoire de le motiver un peu. Le canon de mon revolver passe d’un genou à l’autre; puis, de mes yeux, je cherche son regard. C’est long, faut en finir; il fait noir et j’ai froid, tellement froid. Désemparé, il baisse la tête pour se remettre au travail, comme si sa vie en dépendait. Le Tueur, les mains dans les poches, se recule pour s’adosser à un arbre, tandis que moi, mon .357 au poing, je supervise la tâche. Minute après minute, on n’entend que le son de l’acier de la pelle pénétrant le sol, accompagné du souffle rauque de la respiration sifflante de notre victime avec, en bruit de fond, les hurlements violents du vent qui se perdent dans les ténèbres de la nuit. Le temps passe et la fosse s’agrandit, tout en devenant plus profonde. Alors que le Tueur me regarde de ses grands yeux tristes, je lui fais signe de la tête. Il grimace en s’avançant devant moi. Le silence se fait soudainement autour de nous, jusqu’à ce que ses paroles au ton mélancolique résonnent dans la clairière.
− C’est beau, mon ami, je pense que tu as assez réfléchi pour avoir trouvé une bonne solution à notre problème… et le trou est parfait.
Le Tueur se retourne vers moi, pour me fixer longuement d’un regard résigné. Du regard de celui qui est déjà perdu et qui néanmoins, voudrait trouver un moyen d’éviter de faire un pas de plus dans les profondeurs de l’abîme. Inconsciemment, je crois qu’il me demande d’arrêter tout de suite ce qui est censé suivre. Mais je reste là, impassible, comme une statue de glace trônant au centre d’un enfer de froid. Après un court soupir, il redevient lui-même; sa voix s’élève sans émotion, claquant comme le bruit sec d’une détonation.
− Oui, parfait, ce trou; juste au goût de mon copain. Je vais te laisser faire ton coup de téléphone, maintenant.
Le regard tout à coup rempli de reconnaissance, notre homme lâche la pelle pour sauter d’un bond hors de son trou. Sûrement qu’il se voit déjà chez lui, devant un bon cognac, en cherchant le réconfort, après sa nuit cauchemardesque, dans les bras de sa femme, de sa mère ou de sa maîtresse. Il nous regarde en souriant nerveusement, comme s’il voulait nous faire comprendre, par ce soudain excès de bonne humeur, qu’il nous pardonne notre cruauté de tortionnaires. Il s’imagine sûrement qu’on va le laisser aller et oublier ça. C’est donc devant ce visage blême teinté d’espoir que le Tueur se décide de finir le travail. Mon partenaire est une sorte de psychopathe doté d’une sensibilité extrême. Il n’aime pas faire de mal aux gens sanglotants et désespérés. Moi, je le laisse faire à sa façon; un condamné creuse toujours plus vite son trou avec une petite lueur de salut devant les yeux. Tandis que je recule de plusieurs pas, il fouille de la main l’arrière de son pantalon. Là où est censé se trouver son cellulaire. Mais, de derrière son dos, c’est un 9mm automatique qu’il fait apparaître. L’armant aussitôt d’un geste vif du poignet, il le pointe directement sur le front de la victime qui reste là, abasourdie, son sourire imbécile encore sur les lèvres. Comme il essaie d’entamer une phrase…
« BANG! »
Le revolver lui coupe la parole en tonnant dans la nuit. Sa tête explose en une pluie de sang et de cervelle, qui va jusqu’à souiller mes bottes de ses éclaboussures, tandis que son cadavre tombe lourdement sur le sol. Puis, tout redevient silencieux. Je m’avance vers le corps qui lentement, rougit la terre de son sang. Sans trop savoir pourquoi, sans émotion, je fixe ses yeux qui sont demeurés ouverts. Je le fixe, comme il l’avait fait précédemment avec moi, trouvant dans son regard probablement la même chose qu’il avait trouvée dans le mien, la mort. Ma mort, c’est celle de l’âme; je suis un zombie qui respire. Mais sa mort à lui, avec une balle dans la tête, est plus réelle et définitive. Je vois le néant tout au fond de ses yeux, comme si d’un regard impassible, il embrassait l’éternité. Un regard vide qui, avant tout, me rappelle vaguement quelque chose d’autre. Comme une étrange impression de déjà-vu. Un souvenir lointain émanant de cette scène de champ de bataille. Du coup, l’épaisseur des murailles de mon amnésie semble légèrement s’effriter, me rappelant ces jours d’avant la noirceur de mon mercenariat. Ces jours où j’avais encore de la vie en moi, ou je cherchais la vérité. Les images défilent sans que je puisse les contrôler. Des bribes de souvenirs et de fantasmes obsessionnels qui semblent s’être transformées en visions cauchemardesques occupent soudainement tout l’espace de mon esprit. Plus rien n’existe, mis à part ce que je vois dans les yeux du mort. D’abord, le souvenir lointain de m’être déjà plongé dans ce même regard funeste, en d’autres temps et en d’autres lieux. Je vois la clairière être remplacée par une plage de cailloux labourée par les vagues du large. Les yeux du mort me ramènent au-delà des océans, dans les vieux pays, jusqu’au royaume des Francs. Je vois cette terre de mes aïeuls qu’on appelle Normandie, avec un nom ressortant de ma mémoire emprisonnée: Dieppe.
Dieppe, 19 août 1942
Restant à la fois dur, pur
Avec une solitude de givre
Qui glacerait les plus brûlants crématoires de l’enfer
Et toute une existence
Se résumant à cette seule phrase
Je suis toujours en guerre.
- Ronin
La brume du matin vient de se lever et semble avoir avalé tout l’univers qui m’entoure, tel un ogre affamé. Néanmoins, j’aperçois une plage sur laquelle meurent les vagues de la mer, le tout en noir et blanc, comme une scène d’un vieux film que j’ai déjà vue et qui se jouerait encore dans ma tête. De ce fait, ce paysage étrange ne me semble point inconnu. Il me rappelle quelque chose de lointain, comme un rêve à demi oublié, ou plus probablement un cauchemar. C’est la plage de Dieppe que je revois à travers un autre de mes fantasmes maladifs. Une bruine fine tombe et va finir sa course sur les galets qui jonchent le sol. La plage de cailloux disparaît lentement sous l’eau écumante, puis réapparaît, en suivant les relents des vagues de la mer qui s’agitent derrière moi. Soudainement, tout s’enflamme, tel un formidable brasier; la terre tremble violemment, perforée par de terribles explosions qui rejettent dans tous les sens, pierres, boue et eau bouillonnante. Le bruit du tonnerre résonne douloureusement à mes oreilles, au point de m’en faire presque éclater les tympans. J’écarquille les yeux devant le spectacle hallucinant de milliers de projectiles meurtriers qui viennent du mur de brouillard pour s’abattre comme une pluie de morts, de la plage jusqu’à la mer. Je reste là, un peu confus, même si je vois le tout sans émotion, en simple spectateur, comme devant la vision d’un rêve dont on a la certitude qu’il finira dans les secondes qui suivent. Je recule malgré tout devant ce barrage de mitrailles, pour ressentir une légère anxiété lorsque mon pied glisse sur la lisse surface des galets, donnant ainsi une certaine réalité à cette vision de mirage. Juste comme j’arrive à la mer, je sursaute, bousculé par une foule d’hommes casqués aux vêtements de couleur kaki qui passent à ma hauteur sans me regarder. C’est comme si la mer, qui vient mourir vague après vague sur la plage, avait soudainement régurgité toute cette masse hurlante de soldats. Ces derniers, le corps penché et la tête rentrée entre les épaules, se jettent hors des péniches de débarquement pour se lancer à l’assaut de la brume cracheuse de balles. J’entends, à travers cette cacophonie, le bruit des projectiles faisant éclater le revêtement des embarcations qui viennent de transporter une génération d’hommes à leurs tombeaux. J’en viens même à percevoir le son des impacts de l’acier qui pénètre la chair et fracasse les os. Simultanément, en arrière-plan, sonne une chorale morbide composée de hurlements de douleur, d’agonie et de désespoir. Puis, je vois les soldats qui, pas à pas, trébuchent, tombent, pour enfin s’assoupir sur la grève de galets. Le vent, d’une violente bourrasque, balaie le nuage de brume qui s’évanouit comme par magie, laissant, tout en face de moi, une véritable vision d’apocalypse. Il y a des cadavres à n’en plus finir, entremêlés dans des barrières de barbelés avec, un peu partout, des casemates et des nids de mitrailleuses qui crachent la mort dans un déluge de feu et de fer. Canonnades, jets de mortier, explosions, détonations, le tout bien assemblé dans un vacarme infernal et délirant, comme l’apothéose d’une ode lyrique en hommage au grand Lucifer. Derrière les lignes de fortifications protégeant la ville, on ne peut voir que le mouvement furtif des soldats ennemis qui, bien à l’abri dans leur repaire, continuent leur travail meurtrier. Sur la plage, les corps s’amoncellent en lignes et en piles, par centaines, puis par milliers, fauchés avant même d’avoir pu tirer un seul coup de fusil. Ce massacre reste un chef-d’œuvre d’orchestration, où chaque note amène un homme dans l’abîme. À la fois distant et estomaqué, je marche parmi eux comme au milieu d’un mauvais rêve, passant entre les cadavres et les blessés agonisants, tandis que des dizaines de projectiles me traversent sans me toucher. Ce qui n’est visiblement pas le cas pour mes compagnons de plage, les rafales d’aciers sectionnant leurs membres, les éclats d’obus déchiquetant leurs corps. Tous des fils, des maris, des pères de famille, assassinés et trahis par leur patrie, envoyés à des milliers de kilomètres de leurs foyers respectifs pour mourir comme du bétail à l’abattoir. Un soldat au visage d’enfant pleure, étendu sur le sol. Je me penche sur lui, plus par curiosité que par compassion, mon regard impassible confrontant la douleur et la peur dans le sien. J’approche mes mains des siennes et avec surprise, je ressens quelque chose d’étrange en moi. Comme si une brume ténébreuse se resserrait lentement tout autour de mon cœur pour tenter de l’étouffer. Sentiment d’impuissance? Tristesse? Nos doigts réunis essaient de retenir les entrailles qui veulent sortir de son ventre ouvert, avec la vie qui s’échappe de lui en un fleuve de sang. Enfin, il meurt en me regardant dans les yeux, tout en appelant sa mère. Je vois tout en noir, en gris et en rouge, à cause du sang coagulé qui luit sur les galets et des milliers de cadavres qui gisent immobiles, abandonnés là par leurs compagnons d’armes, forcés de retraiter devant un ennemi invincible. Je reste seul avec les morts, errant parmi eux comme une âme en peine, voyant la marée prendre leurs corps un à un. Une marée teintée de leur ultime sacrifice, héroïque autant qu’inutile. Confronté à ce carnage, je revois l’image d’un liquide sombre éclaboussant le sol boueux, où se mélangent des parcelles de cervelles grisâtres.
***
Cela vient de la tête éclatée du cadavre de la clairière, que je fixe encore dans ses grands yeux ouverts. Je ressens alors le même sentiment que devant l’adolescent agonisant. C’est un malaise étrange et je ne sais pas comment analyser cette émotion. Je n’ai rien ressenti depuis un long moment, je suis resté trop longtemps sans humanité. Je laisse donc le néant me remplir de nouveau, balayant tout malaise en moi. Ce néant si sécurisant, si familier, qui tourne et tourbillonne en prenant tout. Tout, sauf les visions. Elles sont comme imposées à mon esprit et m’entraînent, malgré moi, encore plus creux dans les profondeurs de ma mémoire.
Dieppe, 9 septembre 1994
Le délire continue, avec mes pensées qui violent ma volonté, faisant ressortir du puits sans fin de ma conscience des scènes de mon passé que j’avais volontairement oubliées, laissant de ce fait ces troublantes hallucinations pour revenir à une lointaine réalité.
Le paysage était en couleur, cette fois-ci, aux teintes vives et lumineuses. Je roulais en automobile sur une petite route de campagne au cœur d’un pays étranger. Je me souviens de cet endroit, de ce périple au royaume des Francs. Le chemin était long et monotone, jusqu’à ce que mon compagnon de voyage, tout sourire, reprenne la parole avec un autre de ses propos loufoques. Je le revois, tête rasée, avec une petite barbichette garnissant le bas de son visage légèrement arrondi. C’est mon cousin, mon frère. Couze, comme je l’appelle. Un ami de toujours avec qui j’ai grandi, bien qu’il vivait à l’extérieur des ghettos où j’habitais. Une personne avec qui je sais avoir partagé de nombreuses aventures, bien que, pour le moment, je ne me rappelle d’aucunes. Le ciel devint grisâtre, avec des nuages qui s’amoncelaient rapidement sous le vent, pour ne laisser percevoir, qu’à quelques endroits, des pointes d’un bleu très foncé, comme s’il se faisait l’oracle annonçant l’arrivée d’une tempête prochaine. Le chemin nous mena jusqu’au milieu de champs isolés, face à une croix de pierre rongée par les années, avec, tout à côté, une énorme pancarte qui semblait beaucoup plus récente: TOMBE DE GUERRE DU COMMONWEALTH, DIEPPE, CIMETIÈRE DE GUERRE CANADIEN. Nous avons tourné à gauche sur un sentier étroit, bordé d’une forêt d’un côté et d’une grande terre cultivée de l’autre. Chemin reculé au bout de nulle part appelé RUE DES CANADIENS, où nous nous sommes arrêtés, devant l’entrée du cimetière. Solennels, mon compagnon et moi sommes sortis de la voiture sans rien dire, laissant les portières se fermer en claquant dans le silence absolu. Nous avons pénétré dans ce sanctuaire du dernier repos pour aussitôt perdre, une fois à l’intérieur, cette impression que nous étions encore dans un endroit oublié. Tout était impeccable, ici, du gazon d’un vert parfait fraîchement coupé, jusqu’aux bosquets finement taillés. Il y avait aussi une multitude de fleurs qui égayaient ces centaines de croix blanches au granite immaculé. Des gens se souvenaient et respectaient, mais le silence en vint à être écrasant. J’étais surpris face au mutisme de mon Couze, qui de nature toujours gaie et enjouée, n’avait encore tenté aucune remarque amusante. Le visage grave, nous déambulions en silence parmi les pierres tombales. Finalement, je pris le temps qu’il fallait pour lire tous les noms des morts enterrés ici, espérant toujours me les rappeler. Tous ces guerriers à qui j’espérais tellement ressembler. La phrase sur les armoiries de ma douce contrée revint soudainement à mon esprit. JE ME SOUVIENS; cette phrase, c’était là qu’elle devait prendre tout son sens. Gravée sur le granite en lettres de sang. Je me la répétai encore et encore, au-delà du temps, comme si avec ces mots, je voulais illuminer mon âme avalée par les abîmes de l’oubli.
Nous avons continué d’errer de tombe en tombe, non sans remarquer que les soldats, pour la plupart, étaient plus jeunes que nous.
***
Malgré ma mémoire rendue volontairement vacillante, je me rappelle, sans savoir pourquoi, certains des noms aperçus sur les pierres:
SERGENT SUPPLÉANT M. LAPOINTE, LES FUSILIERS MONT-ROYAL, LE 19 AOÛT 1942, ÂGE 31, MORT EN HÉROS POUR LA PATRIE, LAISSANT UNE FEMME ADORÉE ET UNE PETITE-FILLE CHARMANTE, QUE DIEU LES BÉNISSENT.
PRIVATE G.A. DANFORTH, SOUTH SASKATCHEWAN REGIMENT, AUGUST 19TH, 1942, AGE 27, GONE BUT NOT FORGOTTEN, BRAVE SOLDIER.
SOLDAT R. BOULANGER, LES FUSILIERS MONT-ROYAL, 19 AOÛT 1942, 18 ANS.
Oui, je me souviens encore, sans comprendre pourquoi. Je me souviens aussi d’une autre sépulture, celle d’un soldat inconnu gravée à jamais dans mon esprit:
A SOLDIER OF THE SECOND WORLD WAR, A CANADIAN REGIMENT, AUGUST 19TH, 1942, KNOWN UNTO GOD.
Se rappeler est le seul véritable hommage qu’on peut encore leur faire. Même si, dans mon cas, je sens que me rappeler serait l’équivalent d’une condamnation en enfer.
***
Étonnamment, à la fin de notre visite, le soleil vint surplomber ce terrain verdoyant semé de centaines de croix, avec un ciel d’un bleu sans tache où toute trace de nuages en était venue à disparaître.
Nous sommes repartis, sur une route achalandée au milieu d’une cité inconnue, à la recherche de je ne me rappelle plus quoi, comme si ce voyage dans les vieux pays était une quête dont je n’ai plus le souvenir. Je me rappelle seulement que Dieppe n’était qu’une escale de notre long pèlerinage.
Nous suivions donc les panneaux routiers, qui nous ont guidés au seul endroit où il était logique de se rendre après notre mélancolique visite de ce début d’après-midi. Là où, de toute façon, le destin nous aurait assurément menés, de gré ou de force. Comme si chacune des âmes des guerriers aux restes ensevelis dans ces champs nous criaient de passer par là:
− Allez voir et, avec l’aide du destin, vous comprendrez que nos sacrifices ne furent pas vains.
Avec cet appel énigmatique en tête, nous sommes arrivés à la plage de Dieppe.
Elle différait légèrement de ce que j’avais vu, auparavant, dans mon cauchemar de feu et de sang. Elle ne portait plus les traces des nids de mitrailleuses et des barrières barbelées. Le tout était maintenant remplacé par un joli parc au beau gazon, lui aussi frais coupé, avec plein de gens souriants qui profitaient des largesses du soleil pointant toujours à l’horizon.
Nonchalamment, nous avons traversé cette foule entourée d’enfants qui criaient et riaient, puis j’eus l’étonnante surprise de me sentir lentement imprégné de leur joie de vivre. Sentiment étrange et loin d’être désagréable. C’était peut-être ce que les fantômes des soldats voulaient que l’on voie, voulaient que l’on ressente. Au premier pas sur les galets, je fus submergé par la même émotion qu’au cimetière, ayant encore l’impression de fouler le sol d’un endroit sanctifié. La mer était là, tout au bout, avec sur elle le vent froid qui amenait à nos narines la forte odeur salée du large. Les vagues étaient hautes et venaient s’abattre avec fracas sur la berge couverte de petites pierres qui roulaient en tourbillonnant avec l’eau. Tout en marchant, mon Couze recommença à faire le con en se moquant gentiment des gens que nous croisions. Ses grimaces et ses mimiques étaient toujours accompagnées de commentaires appropriés. Il faisait le singe, tel le dernier des imbéciles. On riait aux éclats, pour enfin en arriver à avoir l’air de ce que nous étions, deux jeunes touristes mal élevés en vacances. Le cœur léger, nous marchions gaiement vers les vagues bruyantes qui semblaient rire avec nous. Tout était devenu comme si j’avais déjà oublié les fantômes et les événements sanglants d’hier qui soudainement, ne semblaient plus avoir aucune emprise sur moi. Mais le destin, dans son étrange perversité, s’employait à ce que je me souvienne pour toujours de cet endroit, surtout de ses drames.
Des cris de détresse venant du large m’ont alors fait tressaillir. Je figeai sur place, mes sens en alerte. Cherchant du regard, j’aperçus, à quelques centaines de mètres dans la Manche, une jeune fille en difficulté qui flottait tant bien que mal en retenant une autre personne. Leurs corps suivaient les mouvements irréguliers du remous des flots. J’étais séparé d’eux par les vagues qui, hautes de plusieurs étages, coup après coup, venaient mourir à mes pieds. Le cri résonna encore, désespéré.
Dès lors, apparut à côté de moi une forme de brume blanchâtre qui en une fraction de seconde, prit l’apparence de ce qui semblait être un officier de la dernière guerre.
Un peu surpris, maintenant comme alors, je me demande si cette vision appartient vraiment, comme le reste, au fil de mes souvenirs réapparus, ou s’il s’agit encore d’une parcelle de mes fantasmes hallucinatoires qui se mélange à cette histoire. Pourtant, ces souvenirs semblent si réels dans ma mémoire.
Revolver à la main, il me fixa d’un regard mauvais. Son béret était légèrement de travers et son uniforme kaki, trempé et sali de boue, était troué de dizaines de balles. Pendant que son visage reflétait une évidente exaspération, de sa main libre et dans un geste impérieux, il me pointa la mer, comme il l’avait assurément fait à ses hommes une cinquantaine d’années auparavant. Puis, d’une voix forte et autoritaire, il hurla à mes oreilles:
− Go, go, go!
Au même moment, je crus entendre, en bruit de fond, des explosions et des détonations; à moins que ce ne fut le fracas d’une autre vague venue mourir sur le littoral? J’avançai d’un pas et arrêtai, hésitant. Mon détachement égoïste était si grand, que sans même une parcelle de peur ou d’anxiété, je me demandai froidement pourquoi je devrais risquer ma vie pour des inconnus. Oui, j’hésitai encore, malgré les hurlements redoublés de l’officier. J’hésitai, jusqu’à ce que j’aperçoive, du coin de l’œil, mon Couze qui avait déjà dévêtu le haut de son corps pour se jeter sans réfléchir dans les flots menaçants. Lui qui n’avait jamais de sa vie approché le danger ou connu la fureur de la bataille, il flirtait probablement pour la première fois avec la mort. Sans regarder derrière, ce garçon tranquille au corps frêle défia seul les hautes vagues. Il confronta ces géantes de quatre mètres pour être aussitôt avalé par elles. Le résultat de l’affrontement était plus que prévisible. Je sentis mon cœur se serrer, comme s’il était cruellement pressé dans un étau. Heureusement, à mon plus grand soulagement, mon Couze réapparut en culbutant sur les galets après avoir été violemment recraché par les flots. Il resta immobile, couché de tout son long, pour enfin commencer à toussoter en se relevant difficilement. Puis, indomptable, poussé par son cœur de lion, il se lança à nouveau vers le large.
Je me souviens du sentiment que j’ai alors ressenti. Il s’accompagnait d’une chaleur qui me brûlait le visage jusqu’au point d’en rougir. Ce sentiment, j’aurais aimé ne l’avoir jamais ressenti. La honte. Moi qui, déjà en ces temps lointains, étais vétéran d’une multitude de combats. Moi qui, si souvent, en pure bravade, affirmais être un des compagnons favoris de la grande faucheuse avec qui j’entretenais même une certaine intimité, j’étais honteux de rester là sans bouger, pendant que mon Couze affrontait seul le danger.
Je voyais la fille tout au loin qui se débattait toujours contre la marée mortelle en retenant son compagnon. Je voyais l’officier qui gesticulait à mes côtés en hurlant, tandis que mon Couze se lançait encore à l’assaut. Je pense que ce n’est pas nécessairement la peur qui m’a paralysé, mais une profonde apathie qui avait toujours été présente en moi. Apathie si généralisée qu’elle enrayait toute humanité. Devant cette masse d’eau tourbillonnante, avec les cris de détresse qui à mes oreilles, résonnaient plus fort que les hurlements du fantôme, mon corps se surchargea violemment d’adrénaline. Ma vision s’embrouilla, le tout étant comme si j’étais pris dans une de mes frénésies guerrières et que je ne contrôlais plus rien de ma personne. Le visage grimaçant, je me lançai à mon tour à la rescousse des deux personnes prisonnières des eaux. Du coin de l’œil, malgré mon esprit devenu fiévreux, j’aperçus une dizaine de badauds figés sur place, comme je l’étais moi-même quelques secondes auparavant. Évitant toute action qui mettrait en danger leur précieuse existence, ils regardaient la scène la bouche ouverte, en essayant de se convaincre de leur inutilité et de leur impuissance. Gardant toute mon attention sur cette gigantesque masse d’eau qui me faisait face, je me jetai contre elle en même temps que mon compagnon. Aussitôt, je fus pris dans sa redoutable accolade. Je retins mon souffle tout en fermant les yeux, pendant que la vague puissante et froide passa avec force par-dessus mon corps. J’essayai de me débattre, mais en vain; j’étais entraîné vers le fond en tourbillonnant. L’eau salée pénétrait ma bouche et mon nez, laissant un goût affreusement désagréable qui, lentement, m’étouffa, au point de me faire suffoquer. L’eau remplaçait l’air dans mes poumons; je me noyais. Pourtant, je ne ressentais rien. Pas de panique ni de crainte; seul un étrange et réconfortant sentiment d’indifférence possédait tout mon être. C’est ainsi que je m’abandonnai à mon sort, seul, pris dans les griffes de la mort noire et glacée. D’un coup, la lumière revint, avec le dur contact du sol rocheux sur lequel je roulai douloureusement. Je venais d’être recraché par la mer et repoussé de la froide étreinte de la grande faucheuse. En proie au pire des malaises, je vomis bruyamment du liquide salé tout en remarquant, avec un certain éclair de joie à l’esprit, que mon Couze, sain et sauf, était occupé à faire la même chose. Je me relevai donc et, sans réfléchir, me relançai obstinément à l’assaut. Au loin, j’entendais la voix brisée de mon compagnon qui me criait d’attendre, qu’on ne pouvait pas réussir et qu’il allait chercher du secours. Ses paroles se perdirent derrière les hurlements de la jeune fille que je voyais toujours au loin. Elles se perdirent derrière le fracas intimidant des vagues vers lesquelles j’accourus tête baissée. Mon élan fut soudainement brisé par une gerbe d’eau qui m’emprisonna les jambes jusqu’aux genoux. Forte de sa prise, elle me souleva dans son mouvement pour me projeter vers le ciel à une vitesse vertigineuse. Comme la vague se brisa sur la plage, je touchai encore durement le sol, mes côtes prenant tout le choc de l’impact contre les galets. Ma respiration se coupa en même temps que la douleur embrasa mon être. Je me relevai difficilement, mais recommençai néanmoins à respirer avec plus d’aise, tout en sentant du sang chaud couler le long de mes flancs blessés. Je ne voyais plus mon Couze, il n’y avait que cet amoncellement de passants qui s’était encore agrandi et qui observait le tout comme un spectacle sans frais. Probablement qu’ils regardaient la scène de la même façon qu’ils avaient toujours regardé leur vie, c’est-à-dire sans implication, en simples et misérables spectateurs.
L’officier était toujours là, me gratifiant d’une sorte de sourire flegmatique et levant le poing en signe d’encouragement. Sa voix se faisait maintenant presque doucereuse à mon oreille.
− Way to go lad.
Ses traits se durcirent lorsqu’il pointa à nouveau du doigt les deux personnes en détresse, puis il disparut. Sa forme spectrale se défit sous une violente bourrasque de vent, pareil à la brume du matin qui retraite devant la brise.
À bout de souffle, je m’avançai lentement dans la Manche avec, cette fois, la surprise de ressentir une certaine crainte.
Ce drame venait de réveiller en moi quelque chose depuis longtemps endormi. Je ne sentais plus ce vide à l’intérieur, ce vide si profond et sans fin que je ressens encore aujourd’hui. Oui, à cette date, j’étais peut-être déjà un mercenaire, mais je venais de me rendre compte que j’étais vraiment différent des gens ordinaires. Je ne ressemblais en aucun point à ces spectateurs enchaînés à leur médiocre existence pour qui j’avais un immense dédain. Contrairement à eux, j’avais la force de me lever contre le destin, en faisant fi de ces pensées fatalistes qui ne sont que pour les couards. Je ressentais un profond soulagement devant cette différence que je constatais entre le commun des mortels et moi. Comme le garçon qui a toujours détesté sa famille, au point de la renier, pour enfin se rendre compte qu’il ne leur appartient pas, qu’il a été adopté. Néanmoins, il y avait cette crainte nouvelle qui à ce moment précis, était venue m’étreindre les entrailles. Elle venait uniquement du fait que cette dernière révélation avait ressuscité en moi une petite parcelle d’espoir, de vie, une faible flamme que j’avais maintenant peur de perdre au fond de ces eaux froides et noires. J’avais peur, mais ce sentiment m’indiquait qu’enfin, j’étais vivant. Dans le fond, il n’y a aucune bravoure à risquer la mort comme déjà je l’avais fait, avec des sentiments disparus, ensevelis sous l’indifférence. La mort est presque facile quand on considère n’avoir rien à perdre. Le vrai courage, c’est mon Couze. Le vrai courage, c’est lorsqu’on affronte la mort avec le sentiment d’être bien vivant. Je venais donc de trouver en moi quelque chose de précieux. N’était-ce pas en partie ce que j’étais venu faire de ce côté de l’Atlantique? Chercher et trouver un sens, un espoir… n’était-ce pas cela l’essence même de ma quête?
Avec une certaine hésitation, j’avançai encore de quelques pas dans l’eau. J’étais affaibli, à bout de souffle, la fièvre rouge de la bataille m’avait quitté, ne laissant en moi qu’un soupçon d’énergie qui servait à peine à me garder debout. J’étais soudainement convaincu que le prochain assaut serait mortel pour moi. Les vagues semblaient devenir de plus en plus hautes, de plus en plus puissantes. Pourtant, rien ne me retint pour mon dernier élan. Bien décidé, s’il le fallait, à mourir comme j’aurais dû vivre, en combattant pour quelque chose de plus valeureux que la couleur des billets de papier. Comme je me lançai vers l’avant, une solide poigne me retint par l’épaule. Surpris, je me retournai pour faire face à un grand gaillard qui m’interpella avec un fort accent français.
− Reste ici, ça va aller. Prends le filin.
Il me tendit une corde qu’il enserra aussitôt autour de sa taille et enleva son chandail sur lequel je pus clairement lire en lettre noire; POMPIER, DIEPPE. D’autres personnes se rassemblaient autour de nous, vêtues du même accoutrement. Celui qui m’avait arrêté s’assit sur le sol pour chausser des palmes de plongée, avant de se lancer tête première dans les vagues écumantes. Nous retenions tous la corde qui était attachée à lui, moi en tête de la ligne, tandis que je me demandais si cette dernière intervention, qui m’avait assurément sauvé la vie, me réjouissait où me décevait. Toute mon attention se fixa ensuite sur le pompier qui, après une nage rapide, rejoignit enfin les deux personnes en difficulté. Il les empoigna, et dès qu’il nous fit un signe de la main, on commença le remorquage.
La mer s’agitait de plus en plus, comme si elle voulait garder ses victimes sous son emprise. Les vagues devenaient plus violentes et s’acharnaient contre nous. Je me faisais jeter sur les galets à chaque relent, mais je me relevais aussitôt après, malgré la fatigue, les bosses et la douleur, pris par l’importance de la tâche. Un rapide coup d’œil vers l’arrière me permit d’apercevoir mon Couze qui, en véritable compagnon d’armes, avait pris sa place sur la ligne de corde. Je réalisai alors que l’arrivée providentielle des pompiers lui était assurément due. À la force de nos bras, le trio encordé se rapprocha lentement. Ils n’étaient plus qu’à une dizaine de mètres, lorsque, comble de malheur, toute tension quitta le câble que nous tirions. Le bout s’était détaché. Sur la plage, on se regarda tous sans mot dire, décontenancés, appréhendant le pire. Heureusement, la mer se fit tout à coup magnanime et décida d’abandonner ses proies, qu’elle rejeta à l’aide d’une formidable vague qui tomba sur la plage dans un gigantesque bouillon d’écume. Quand le pompier et un corps totalement inerte furent projetés sur la gauche, tous se ruèrent vers eux. C’était ce que je m’apprêtais à faire, lorsque je remarquai la jeune fille dans l’autre direction. Elle n’avait pas pu se libérer de l’emprise des eaux. Seule, et à bout de force, elle semblait être sur le point de se faire entraîner vers le large par le courant. Comme si la mer avait quand même décidé, malgré sa soudaine pitié, de garder une victime pour son sacrifice au démon des profondeurs. Cette fois, sans même réfléchir, je me dirigeai vers elle en courant. Alors que chacune de mes enjambées étaient retenues par les flots, la crainte d’être assailli par une autre de ces gerbes d’eau tourbillonnante n’était pas sans m’envahir. Rapidement immergé jusqu’à la taille, je me retrouvai néanmoins juste au côté de la fille en détresse. Je l’agrippai par le bras, sans rien dire, sans remarquer un seul des traits de son visage, ni même la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Je la soutins ainsi jusqu’à la terre ferme, où une équipe médicale arriva aussitôt pour la prendre en charge. Ils s’occupèrent d’elle et la massèrent vigoureusement sous une couverture chauffante, pour lui éviter de souffrir d’hypothermie. Je vis le pompier français, épuisé, une palme en moins, avancer sur les galets en compagnie de ses collègues qui le soutenaient. Un peu plus loin, à quelques mètres de la berge, le cadavre de l’autre rescapé flottait toujours sur l’eau. Je m’approchai donc pour aller le récupérer. Rendu tout près, j’attrapai son bras et soulevai sa tête; sa peau était glacée et affreusement blanche. Je pris son corps devenu d’une mollesse extrême, tel un pantin désarticulé, dont les muscles et les nerfs ne retenaient même plus les os. Tandis que je le transportais, mon regard resta figé au sien. Ses yeux grands ouverts, vides et exorbités, fixaient le néant comme s’ils embrassaient l’éternité. Je me plongeai dans ce regard de mort; il faisait noir, il faisait froid. Tout au fond de ses yeux, je voyais le reflet du ciel qui s’était couvert d’un gris orageux. Du coup, le décor s’obscurcit rapidement, marquant la fin de mes visions pour me retrouver sous une lumière vacillante éclairant faiblement les branches dégarnis des arbres de la clairière.
***
Je suis de retour dans le boisé, à la sombre réalité du présent, debout juste au-dessus d’un autre cadavre, avec des parcelles de sa cervelle sur mes bottes. Je n’aurais pas dû me perdre ainsi dans son regard de macchabée. Le fait de revoir mon passé à travers les yeux d’un mort ne m’amènera rien de bon. Mes souvenirs, tout comme ces étranges sentiments que j’ai commencé à ressentir, sont si profondément ensevelis en moi, qu’il serait mieux de les laisser là où ils sont. Il ne faut jamais violer son sanctuaire d’antan, de crainte d’y réveiller des démons.
− Hey, vas-tu attendre qu’il pourrisse sur place avant de l’enterrer?
La voix impatiente du Tueur vient briser le flot obscur de mes pensées. Déjà, les sentiments perçus à travers mes bribes de souvenirs ont fait surgir la confusion la plus totale dans mon esprit. Le mécontentement s’y rajoute avec ses paroles qui résonnent toujours à mes oreilles. Ses paroles qui me forcent à faire face à la sordide réalité du moment. Une violente colère émerge du chaos qui me tenaille. Je sais que je ne devrais pas être là, mais je suis damné. Même si ce n’est pas au Tueur que j’en veux, pendant un instant, tout autour de moi devient rouge et j’ai soudainement envie de l’abattre.
« Clic! ».
Le bruit résonne dans la nuit comme une féroce menace de mort. La main rageusement crispée sur la poignée, je viens d’armer le chien de mon revolver. La haine possède chaque fibre de mon corps, m’aveugle. J’ai envie de sang, j’ai envie de parsemer cette clairière de cadavres. J’aperçois la crainte sur le visage du Tueur lorsqu’il recule d’un pas en levant les mains, tandis qu’en moi, je combats la sombre pulsion de lever mon .357 vers sa tête et de la lui faire exploser d’un seul petit mouvement du doigt.
− Aïe, aïe, aïe! Tabarnak, excuse-moi, mais j’veux juste pas qu’on passe la nuite icitte, OK. Relaxe, mon chum, relaxe…
La brume rouge, qui était si dense il y a quelques secondes, se dissipe lentement devant mes yeux. Il ne peut pas savoir ce qui se passe en moi. Il ne connaît pas mes guerres, ne connaît pas mon enfer. Je n’ai donc pas à lui faire payer le prix de mes tourments. Ma rage se change presque soudainement en une jubilation perverse lorsque je me dis que, de toute façon, lui et moi, on fait la meilleure des équipes. Je suis le seul à tolérer ses étranges extravagances et lui, le seul à pouvoir travailler avec mon caractère imprévisible sans que cela n’use ses nerfs pour autant. Je baisse la tête en rentrant mon arme dans ma ceinture, prends la pelle et, à l’aide de cet outil, pousse le cadavre dans le trou fraîchement creusé. Le corps touche le fond avec un bruit sourd et sa tête mutilée disparaît enfin dans l’assombrissement de la fosse. Je n’aurai plus à confronter son regard; il ne me reste plus qu’à oublier ses yeux de mort et surtout, oublier ce que j’ai vu au-delà.
Le Tueur me fixe avec un air contrarié, tout en laissant échapper un long soupir de soulagement, mêlé, peut-être, à une certaine exaspération.
− Ciboire, tu m’inquiètes vraiment, toé, des fois.
« Tchack ».
Le bruit de la lame de la pelle pénétrant le sol résonne dans la petite clairière, s’entremêlant avec le son de la voix de mon compagnon. Ce dernier, mot après mot, retrouve sa gaieté habituelle. Cette candeur est aussi déplacée qu’étrange. Son visage, malgré l’intonation de sa voix, me semble néanmoins toujours d’une tristesse à faire pleurer.
− Te rends-tu compte… Les Canadiens y’ont pas perdu à soir?
Il attend quelques secondes, espérant engager la conversation ou simplement attirer mon attention. Il adore ce genre de verbiage pendant les instants les plus sombres, contrairement à moi qui préfère le silence de la tombe, pour ainsi dire. De plus, en ce moment, je suis trop concentré à ensevelir le corps, à ensevelir mes souvenirs. Le son de l’acier labourant la terre devient la seule réponse à son radotage.
« Tchack ».
Loin d’être découragé par mon mutisme, l’autre continue.
− Y’ont pas perdu, criss, c’est sûr, parce qu’y’ont pas joué.
Puis il se met à rire à gorge déployée, avec un gloussement semblable au son d’un cochon que l’on égorge. Son hilarité est forcée, d’autant plus qu’il se moque, pour une des rares fois, de son équipe préférée. Ma dernière crise de rage l’a sûrement remué plus qu’il ne le laisse paraître.
« Tchack ».
Il s’assit au pied d’un arbre, sort une cigarette et laisse aller l’inlassable mouvement de ses mâchoires, d’une voix empreinte d’un enthousiasme simulé.
− Pourtant, y’ont un bon coach. Y’a de l’’’’’’’